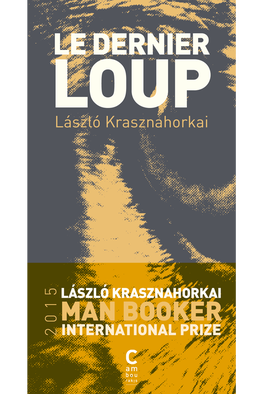La littérature à loup y es-tu de Lazlo Krasznahorkai
Dans la lignée des personnages de Thomas Bernhard, le narrateur solitaire et obsessionnel de cette novella s’est noyé dans la mélancolie et l’angoisse face au vide de l’époque, face au spectacle d’une humanité qui lui apparaît comme saturée de vanité et de mépris. En une seule phrase de soixante-dix pages, le souffle admirable de la littérature.
« Il se mit à rire, mais pas vraiment de bon cœur car son esprit était occupé par des questions du genre : quelle est la différence entre la vanité des choses et le mépris, et à quoi cela se rapporte-t-il, d’après lui, cela se rapportait clairement à un tout émanant de tout et de partout, or si quelque chose s’appliquait à tout et émanait de partout, il était difficile de déterminer ce tout et ce partout, tout cela pour dire qu’il rit, mais seulement du bout des lèvres, à cause de cette vanité et de ce mépris qui gangrenaient sa vie, il ne faisait rien, absolument rien de ses journées, traînait à droite à gauche, passait des heures assis au Sparschwein en compagnie d’une bouteille de Sternburger, et tout autour de lui était saturé de vanité et de mépris, parfois, il s’apaisait, parfois, il cessait d’y penser, et se contentait alors de regarder dans le vide, totalement hébété, ou bien passait de longues minutes à contempler une fissure ou une tache sur le plancher du bar, pour lui le plus simple était, sitôt levé, de se rendre au bistrot du coin, d’y commencer et d’y finir sa journée, pas pour s’enivrer, non, il n’en avait pas les moyens, plutôt par habitude, et comme un jour il avait, optant pour le moins cher, dit : « Sternburger, bitte », depuis on lui servait toujours cette boisson … »
Ancien professeur devenu traîne-misère, passant désormais l’essentiel de ses journées dans un bar d’un quartier crasseux de Berlin, le narrateur du «Dernier loup», qui fut autrefois un professeur de philosophie reconnu (en tout cas il le prétend), raconte au barman hongrois du misérable rade dans lequel il est échoué, comment il a reçu de la part d’une Fondation inconnue et à sa grande surprise une invitation à séjourner en Estrémadure, afin d’écrire « quelque chose » sur cette région, comment il a accepté l’invitation et entrepris ce voyage.
L’homme n’a plus rien à voir avec le professeur d’autrefois, « qui, ne sachant pas encore que la pensée était finie, écrivait des livres, des livres illisibles gorgés de phrases lourdement déficientes mues par une logique déprimante et une terminologie suffocante ». László Krasznahorkai commence par mettre ses personnages à terre, comme le notait Claire Devarrieux à propos de «La mélancolie de la résistance», pour évoquer, encore et toujours, la condition humaine. Dans la lignée des personnages de Thomas Bernhard, le narrateur solitaire et obsessionnel de cette novella s’est noyé dans la mélancolie et l’angoisse face au vide de l’époque, face au spectacle d’une humanité qui lui apparaît comme saturée de vanité et de mépris.
Dès la réception de la lettre de cette étrange fondation, l’homme semble se dédoubler, comme si l’invité et le narrateur étaient deux personnes distinctes, non superposables. Une fois sur place, traité comme une personnalité illustre, craignant d’être démasqué comme un imposteur, il est paralysé, impuissant à s’exprimer et à avouer leur méprise à ses hôtes aux petits soins pour lui. Accompagné d’un guide et d’un interprète, il arpente le territoire à la recherche d’un sujet.
Région située au sud-ouest de l’Espagne, littéralement en dehors du monde comme le note le narrateur, l’Estrémadure est un vaste territoire aride et vide. L’homme se reconnaît dans ce paysage sec et ondoyant, plantés de chênes verts qui se dressent de façon éparse à une grande distance les uns des autres à cause de la chaleur, paysage encore épargné par l’aliénation désastreuse de la modernité qui lui semble-t-il fait écho à son âme. Déchéance et mélancolie de l’homme mutent subtilement à l’évocation de ce paysage, comme si un lien fragile et rompu de l’homme à la nature avait été renoué.
Son sujet lui est finalement donné par une phrase lue dans un journal scientifique et dont la tournure littéraire l’a frappé : « c’est au sud du fleuve Duero qu’en 1983 a péri le dernier loup ». La destruction comme élément de l’histoire contemporaine – incarnée par le vide et la médiocrité de la ville moderne et par la chasse aux animaux sauvages, jusqu’au dernier d’entre eux – est placée au cœur de ce court récit qui forme une évocation poignante de la perte du rapport à la nature et aux animaux. Le récit du garde-chasse Jose Miguel évoquant l’intelligence des loups oubliée des hommes, et leur survie bien au-delà de la funeste date, fait écho aux histoires d’Ernest Thompson Seton.
Publié en 2009, superbement traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly pour les éditions Cambourakis en 2019, cette novella en une phrase happe le lecteur en une seule phrase fluviale de près de soixante-dix pages, parcourue de courants multiples, digressive et répétitive suivant les flux de la pensée obsessionnelle du narrateur, revenant sur ses pas, intégrant les changements de son environnement et toujours sous tension, avec la maîtrise et le talent d’un Claude Simon.
Avec ce monologue d’un homme qui malgré le barman, le guide et l’interprète est absolument seul, comme si tout dialogue était impossible, László Krasznahorkai se place sous le double signe de la désillusion absolue et du manque de fiabilité de l’homme, forcément faillible, et partant de son récit.
Également non fiable, indécidable, et pouvant toujours être réinventé en ses variations infinies, la fiction apparaît comme le seul refuge souhaitable après la catastrophe ; le narrateur laisse ouverte la porte à la fin de l’histoire, non sans une pointe d’ironie, et l’envie au lecteur de relire cette novella et tout Krasznahorkai, encore et encore.
Lazlo Krasznahorkai - Le Dernier loup - éditions Cambourakis
Hugues Charybde
l’acheter ici
Lazlo Krasznahorkai