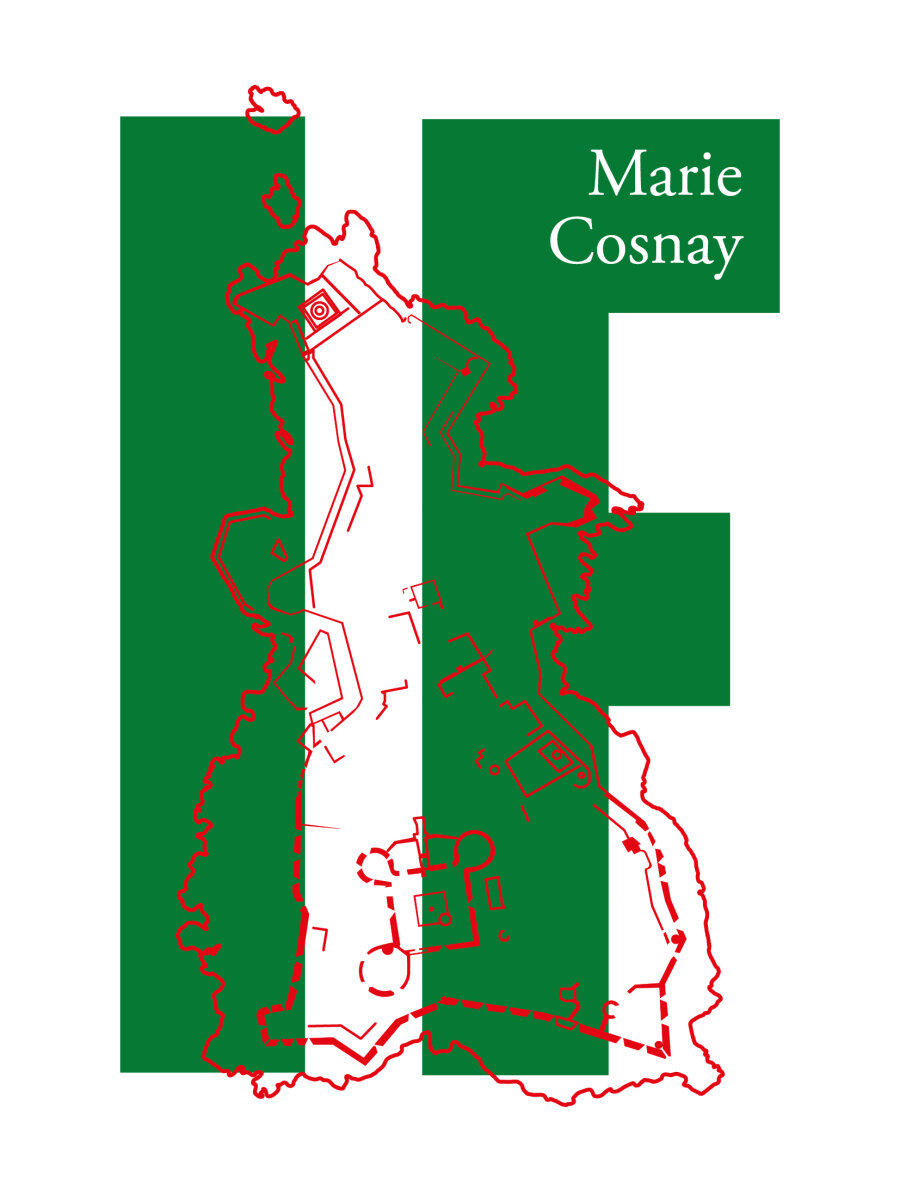If, ou l'imaginaire algérien de Marie Cosnay
Quête en pointillés d’une identité aussi fugace que toutes les fictions dont on recouvre ce que nous sommes, recomposition d’une enfance par l’appropriation (entre reconstitution et invention, moi et la part de l’autre que je sais accueillir) d’une filiation dont il ne reste qu’un nom, à peine une image comme celle de cette île d’If d’où s’élance le récit.
Dans une langue trouée, saturée de cahots et de fulgurances, militante aussi tant elle exprime une haute colère pour l’incompréhensible saloperie des affaires des hommes, Marie Cosnay invente un pays, l’Algérie, comme un idéal territoire de l’imaginaire : un lieu d’où partir, d’où inventer d’impossibles retours.
Il est un vrai plaisir à retrouver l’œuvre de Marie Cosnay, de suivre à nouveau, après le très beau Épopée, ses cheminements de traverses comme autant de questionnement sur nos capacités à accueillir l’autre, à devenir autre, hôte, dans la perpétuelle altération de la fiction poursuivie par ses récits si singuliers. Plaisir donc de retrouver une voix, disons même une résistance face aux fausses évidences de la réalité, de ses pièges et autres horreurs. If (il faut sans doute toutes les alternatives contenues dans ce titre qui ne désigne pas que l’île de Monte-Cristo et les souvenirs impossibles, sans appartenance qui s’en dégagent) fait de cette langue une militance. Certains s’en souviennent sans doute, notre jeunesse fut agitée (amusement et ironie) par ce slogan, et son espoir pas entièrement perdu : « toi plus moi, un autre monde est possible ». La langue de Marie Cosnay s’empare de cette réticence à prendre le réel seulement dans ces données factuelles, dans le confort de ces certitudes reconstruites : « Je résistais. Je ne croyais pas, par exemple, qu’on puisse jamais trouver ce qu’on cherchait. »
Le vase de la fiction est brisé, le temps disparaît en boucles à répétition, le corps épuisé sous les éléments ou motifs des années d’avant, malgré l’épuisement ou avec ou en fonction même de l’épuisement, doit aller chercher les éléments ou les motifs, les faire surgir, tant bien que mal, ce sera toujours ça.
La conjonction « ou » comme programme de cette fiction plurielle en quête de corps, d’un visage de l’exil à travers une fausse autobiographie, la poursuite d’un nom et de l’histoire que l’on pourrait retracer ou lui inventer ou lui rêver ou lui abandonner comme un dédoublement de ce temps obstinément refusé comme linéaire. Une poésie (on oserait même ressortir une po-éthique) de la résistance qui advient dans l’invalidation d’images qui, malgré tout, survivent. Celles proposées dans If sont frappantes, belles comme une île fortifiée, une vision de cette enfance qui ne serait pas tout à fait celle de l’autrice (tout est inventé ou il s’agirait d’une « vraie » enquête à la recherche des origines du père du père de son fils – cela importe-t-il vraiment tant que subsiste ce qui revient ?) : dans la prison de l’île d’If, communards et rapatriés d’Algérie, à un siècle d’écart, se seraient croisés. Un peu à la manière dont Épopée jouait des codes du polar pour nous plonger dans une quête d’identité dont il ne restait qu’un présage, If montre que les boucles temporelles, la prise en charge d’une histoire qui jamais ne nous appartient tout à fait, est la façon la plus efficace, la plus intransigeante, de faire comprendre que « bientôt nous serons à notre tour les gros couillons de l’Histoire. »
Ce sont eux, les salauds de l’Histoire, les idéaux immuables. Ce n’est pas grand-chose d’autre, être un salaud : c’est suivre des idéaux immuables, oubliant les corps, croyant que chacun des gestes qu’on fait n’est pas un geste qu’on fait.
Par raccord, par vision, Marie Cosnay plonge, dans de saisissants fragments, dans une autre histoire de la guerre d’Algérie. Que fait un homme, algérien, engagé dans la police au temps de l’horreur. Au fond, il s’agirait pour l’autrice, comme d’ailleurs pour Frédérique Germanaud dans Dos au soleil, de donner corps à la mémoire, incarner la facilité à se « tromper de grandiose ou se tromper dans le grandiose, nous tous, vaincus des affaires des hommes. » Avec un art très sûr du montage, ressassement et ellipses, Marie Cosnay met en scène sa si incarnée poursuite déceptive de Mohamed Bellahouel et de toutes les identités qu’il a revêtues. Ce refus du linéaire, ce mélange même des lieux, devient la seule façon de donner à voir l’histoire d’un pays, l’attachement qu’il crée dans les mots de l’autrice, dans ce sentiment paradoxal d’un exil répété. Un mystère qui flotte autour de toutes ces pages, une sorte de décomposition du roman familial qui finit par donner vie (celle des fantômes et autres revenants convoqués par la littérature comme une vie bien plus vraie que celle que nous vivons) à ce personnage de Mohammed Bellahouel, à l’autre comme l’appelleront ses enfants, à chacune de ses métamorphoses. La quête de la précision s’en trouve oblitérée, à peine plus que la vérification d’une intuition. Mais il me plaît d’imaginer Marie Cosnay et Adlène Meddi discuter, à Alger, des morts et de la façon de s’emparer, malgré tout, de leur récit. Celui, aussi, d’un soulèvement continu, des idéaux qui restent auxquels les immondes affaires des hommes se chargent de donner corps.
Si nous ne craignions que notre propos soit trop long, trop désordonné surtout, il faudrait aussi évoquer la manière dont If est avant tout le récit d’une enfance qui n’existe pas, qui n’appartient à personne, qui serait la même dans sa capacité à y déployer son imaginaire, à y déplier ses fictions. Le temps non linéaire auquel s’accroche l’autrice serait celui de l’enfance, de la résistance qui gît au fond de tout récit : cette certitude que les héros jamais ne meurent. Ou ils continuent « à dire le secret qu’on a pas. »
Partagé du site La Viduité le 22/01/2020
Marie Cosnay - If - éditions de l’Ogre