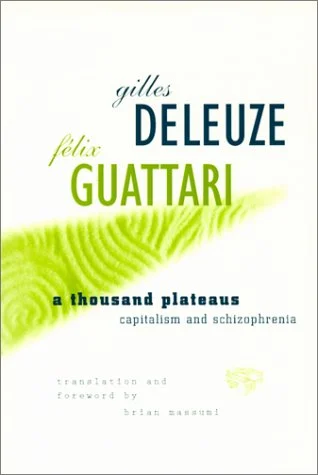Quarante ans après, Mille Plateaux au sommet ! Pourquoi Deleuze et Guattari, les duettistes du gai-savoir, n’ont rien perdu de leur influence
Un monument heureux de la philosophie contemporaine de combat, qui n’a rien perdu de sa puissance et de sa pertinence 40 ans après sa publication, malgré les efforts réguliers menés à son encontre.
Nous avons écrit L’Anti-Œdipe à deux. Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde. Ici nous avons utilisé tout ce qui nous approchait, le plus proche et le plus lointain. Nous avons distribué d’habiles pseudonymes, pour rendre méconnaissable. Pourquoi avons-nous gardé nos noms ? Par habitude, uniquement par habitude. Pour nous rendre méconnaissables à notre tour. Pour rendre imperceptible, non pas nous-mêmes, mais ce qui nous fait agir, éprouver ou penser. Et puis parce qu’il est agréable de parler comme tout le monde, et de dire le soleil se lève, quand tout le monde sait que c’est une manière de parler. Non pas en arriver au point où l’on ne dit plus je, mais au point où ça n’a plus aucune importance de dire ou de ne pas dire je. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Chacun connaîtra les siens. Nous avons été aidés, aspirés, multipliés.
Mon premier contact avec « Mille plateaux », en 1985, avait été compliqué et décisif. J’étais déjà relativement familier du travail de Gilles Deleuze en historien, critique et inspiré, de la philosophie : j’ai mentionné ailleurs à quel point je m’étais appuyé, en classe préparatoire, sur son « Nietzsche et la philosophie » – mais c’était alors largement aussi vrai de sa « Philosophie critique de Kant » (1963) ou de son « Spinoza – Philosophie pratique » (1981). C’est deux ans plus tard, pour un mémoire traitant d’organisation paranoïaque, dans le cadre d’un cours de « Psychanalyse et organisation » animé par Gilles Amado et Paul-Laurent Assoun, que je m’étais plongé dans « L’Anti-Œdipe » (1972) d’abord, dans « Mille plateaux » (1980) ensuite, les deux tomes du monumental « Capitalisme et schizophrénie » écrit en collaboration avec Félix Guattari.
Il ne s’agissait plus là de la quête, même largement vouée à l’échec (à titre personnel !), d’une vision d’ensemble, la plus cohérente possible, de l’évolution de la philosophie, de Kant jusqu’aux ramifications contemporaines, par le truchement d’un explorateur avisé, mais de tout autre chose. Peu d’ouvrages auront eu pour moi autant d’impact personnel sur ma compréhension des modes de formation et d’action des sociétés et des politiques au cœur du capitalisme tardif (avec certainement une partie du corpus de Giorgio Agamben rassemblé dans les différents tomes de son « Homo sacer »). Texte ample et foisonnant (avec ses 600 pages intenses), on comprend à la lecture comme (encore mieux) à la relecture plus de trente ans plus tard pourquoi son impact fut aussi important (au point d’engendrer alors de véritables phénomènes de « mode lexicale », en philosophie comme en journalisme « intellectuel », effets de mode bien entendu potentiellement dommageables à terme), et pourquoi aussi il est rapidement devenu une cible privilégiée de la révolution conservatrice (et de sa reconquête gramscienne, souvent quasiment avouée, des cœurs et des esprits) à partir, au bas mot, de 1985-1986. On saisit aussi cruellement comment, appliquant avec force et courage son ambition déclarée de création de concepts – sans doute le principal héritage nietzschéen (et spinoziste !) chez Deleuze – , il s’exposait sans cligner des yeux aux détournements malicieux, aux abus de langage plus ou moins bien intentionnés, et à la caricature parfois vicieuse. En ce sens, lire et relire « Mille plateaux », se replonger périodiquement dans sa singulière richesse et dans son audace syncrétique – et en tirer toujours et encore quelques conséquences -, c’est bien faire acte de résistance intellectuelle face à toute une « nouvelle philosophie » à la volonté rance bien visible, aux amalgames friables et complaisants, et à la capacité presque sans limites désormais de flatter nos réflexes issus de la moelle épinière plus que du cerveau, des appétits de nos estomacs plus que des élans de nos cœurs.
Un livre n’a pas d’objet ni de sujet, il est fait de matières diversement formées, de dates et de vitesses très différentes. Dès qu’on attribue le livre à un sujet, on néglige ce travail des matières, et l’extériorité de leurs relations. On fabrique un bon Dieu pour des mouvements géologiques. Dans un livre comme dans toute chose, il y a des lignes d’articulation ou de segmentarité, des strates, des territorialités ; mais aussi des lignes de fuite, des mouvements de déterritorialisation et de déstratification. Les vitesses comparées d’écoulement d’après ces lignes entraînent des phénomènes de retard relatif, de viscosité, ou au contraire de précipitation et de rupture. Tout cela, les lignes et les vitesses mesurables, constitue un agencement. Un livre est un tel agencement, comme tel inattribuable. C’est une multiplicité – mais on ne sait pas encore ce que le multiple implique quand il cesse d’être attribué, c’est-à-dire quand il est élevé à l’état de substantif. Un agencement machinique est tourné vers les strates qui en font sans doute une sorte d’organisme, ou bien une totalité signifiante, ou bien une détermination attribuable à un sujet, mais non moins vers un corps sans organes qui ne cesse de défaire l’organisme, de faire passer et circuler des particules asignifiantes, intensités pures, et de s’attribuer les sujets auxquels il ne laisse plus qu’un nom comme trace d’une intensité. Quel est le corps sans organes d’un livre ? Il y en a plusieurs, d’après la nature des lignes considérées, d’après leur teneur ou leur densité propre, d’après leur possibilité de convergence sur un « plan de consistance », qui en assure la sélection. Là comme ailleurs, l’essentiel, ce sont les unités de mesure : quantifier l’écriture. Il n’y a pas de différence entre ce dont un livre parle et la manière dont il est fait. Un livre n’a donc pas davantage d’objet. En tant qu’agencement, il est seulement lui-même en connexion avec d’autres agencements, par rapport à d’autres corps sans organes. On ne demandera jamais ce que veut dire un livre, signifié ou signifiant, on ne cherchera rien à comprendre dans un livre, on se demandera avec quoi il fonctionne, en connexion de quoi il fait ou non passer des intensités, dans quelles multiplicités il introduit et métamorphose la sienne, avec quels corps sans organes il fait lui-même converger le sien. Un livre n’existe que par le dehors et au-dehors. Ainsi, un livre étant lui-même une petite machine, dans quel rapport à son tour mesurable cette machine littéraire est-elle avec une machine de guerre, une machine d’amour, une machine révolutionnaire, etc. – et avec une machine abstraite qui les entraîne ? On nous a reproché d’invoquer trop souvent des littérateurs. Mais la seule question quand on écrit, c’est de savoir avec quelle autre machine la machine littéraire peut être branchée, et doit être branchée pour fonctionner. Kleist et une folle machine de guerre, Kafka et une machine bureaucratique inouïe… (et si l’on devenait animal ou végétal par littérature, ce qui ne veut certes pas dire littérairement ? ne serait-ce pas d’abord par la voix qu’on devient animal ?). La littérature est un agencement, elle n’a rien à voir avec de l’idéologie, il n’y a pas et il n’y a jamais eu d’idéologie.
Le professeur Challenger (créé par Arthur Conan Doyle dans « The Lost World » en 1911, joué ici par Wallace Beery dans le film d’Harry O’Hoyt, en 1925)
La structure en plateaux (non pas mille, en première approche, mais treize, dont les ramifications fractales, toutefois, multiplient très largement les possibilités combinatoires et exploratoires) invite à une lecture pouvant se permettre une part d’aléa, d’aller et retour, d’allées de traverse, même, mais il importe en revanche de ne pas sacrifier les positions respectives de l’introduction (le rhizome) et de la conclusion (les règles concrètes et les machines abstraites). On peut saisir dès les premières pages qu’il y aura là manifeste politique, manifeste philosophique et manifeste littéraire, et que tout cela, au fond, désignera bien la même chose.
Nous ne parlons pas d’autre chose : les multiplicités, les lignes, strates et segmentarités, lignes de fuite et intensités, les agencements machiniques et leurs différents types, les corps sans organes et leur construction, leur sélection, le plan de consistance, les unités de mesure dans chaque cas. Les stratomètres, les déléomètres, les unités CsO de densité, les unités CsO de convergence ne forment pas seulement une quantification de l’écriture, mais définissent celle-ci comme étant toujours la mesure d’autre chose. Écrire n’a rien à voir avec signifier, mais avec arpenter, cartographier, même des contrées à venir.
Les mots aux nouvelles significations issus de cette puissante forge à concepts, entre 1976 et 1980 (certains plateaux avaient été publiés en revue en amont de l’émission de la somme provisoire), auront pour beaucoup d’entre eux connu la fortune langagière : rhizome, déterritorialisation, nomadisme ou ligne de fuite, par exemple, tels que mis en scène par Deleuze et Guattari, sont, à un certain moment, pour ainsi dire passés dans le langage courant (ou en tout cas dans un certain langage courant). Pas toujours à bon escient : nombre d’entre eux auront aussi été tour à tour galvaudés ou détournés (dans ce processus permanent de lutte autour du langage si bien slammé par le D’ de Kabal de « Casus belli »), pour tenter, en toute innocence ou non, d’en amoindrir progressivement la portée. Même si ce phénomène étalé sur deux ou trois dizaines d’années mériterait certainement une analyse en soi, ce n’est sans doute au fond pas très grave : « Mille plateaux », dans son ensemble infiniment robuste, souple et endurant, s’appuie davantage sur ses mécaniques et ses machines (machines de guerre et machines abstraites plutôt que machines désirantes, qui étaient largement l’objet de « L’Anti-Œdipe ») que sur ses mots proprement dits, quand bien même linguistique et langage y tiennent une place centrale. Pendant que certains vocables, fanions ou étendards, auront rempli subrepticement leur fonction annexe d’appâts ou d’épouvantails, les concepts eux-mêmes, portés par leur subtils agencements, auront peut-être eu l’occasion d’avancer plus furtivement.
Richard Giblett, Mycelium Rhizome, 2008
Nous sentons bien que nous ne convaincrons personne si nous n’énumérons pas certains caractères approximatifs du rhizome.
1° et 2° Principes de connexion et d’hétérogénéité : n’importe quel point d’un rhizome peut être connecté avec n’importe quel autre, et doit l’être. C’est très différent de l’arbre ou de la racine qui fixent un point, un ordre. L’arbre linguistique à la manière de Chomsky commence encore à un point S et procède par dichotomie. Dans un rhizome au contraire, chaque trait ne renvoie pas nécessairement à un trait linguistique : des chaînons sémiotiques de toute nature y sont connectés à des modes d’encodage très divers, chaînons biologiques, politiques, économiques, etc., mettant en jeu non seulement des régimes de signes différents, mais aussi des statuts d’états de choses. Les agencements collectifs d’énonciation fonctionnent en effet directement dans les agencements machiniques, et l’on ne peut pas établir de coupure radicale entre les régimes de signes et leurs objets. Dans la linguistique, même quand on prétend s’en tenir à l’explicite et ne rien supposer de la langue, on reste à l’intérieur des sphères d’un discours qui implique encore des modes d’agencement et des types de pouvoir sociaux particuliers. La grammaticalité de Chomsky, le symbole catégoriel S qui domine toutes les phrases, est d’abord un marqueur de pouvoir avant d’être un marqueur syntaxique : tu constitueras des phrases grammaticalement correctes, tu diviseras chaque énoncé en syntagme nominal et syntagme verbal (première dichotomie…). On ne reprochera pas à de tels modèles linguistiques d’être trop abstraits, mais au contraire de ne pas l’être assez, de ne pas atteindre à la machine abstraite qui opère la connexion d’une langue avec des contenus sémantiques et pragmatiques d’énoncés, avec des agencements collectifs d’énonciation, avec toute une micro-politique du champ social. Un rhizome ne cesserait de connecter des chaînons sémiotiques, des organisations de pouvoir, des occurrences renvoyant aux arts, aux sciences, aux luttes sociales. Un chaînon sémiotique est comme un tubercule agglomérant des actes très divers, linguistiques, mais aussi perceptifs, mimiques, gestuels, cogitatifs : il n’y a pas de langue en soi, ni d’universalité du langage, mais un concours de dialectes, de patois, d’argots, de langues spéciales. Il n’y a pas de locuteur-auditeur idéal, pas plus que de communauté linguistique homogène. La langue est, selon une formule de Weinreich, « une réalité essentiellement hétérogèneé. Il n’y a pas de langue-mère, mais prise de pouvoir par une langue dominante dans une multiplicité politique. La langue se stabilise autour d’une paroisse, d’un évêché, d’une capitale. Elle fait bulbe. Elle évolue par tiges et flux souterrains, le long des vallées fluviales, ou des lignes de chemin de fer, elle se déplace par taches d’huile. On peut toujours opérer sur la langue des décompositions structurales internes : ce n’est pas fondamentalement différent d’une recherche de racines. Il y a toujours quelque chose de généalogique dans l’arbre, ce n’est pas une méthode populaire. Au contraire, une méthode de type rhizome ne peut analyser le langage qu’en le décentrant sur d’autres dimensions et d’autres registres. Une langue ne se referme jamais sur elle-même que dans une fonction d’impuissance.
Le loup-garou du vase étrusque de Cerveteri
Pour esquisser ou encourager un certain usage du monde, il faut bien qu’il y ait à l’œuvre un usage particulier des sources. Ce qui concourt puissamment à la fois à l’extrême malléabilité de « Mille plateaux » et à son extrême capacité de résistance aux assauts, c’est sans doute notamment la variété proprement rhizomique, précisément, des matériaux mis à contribution dans chacun des treize plateaux de combat, et la prolifération des échos potentiels que cette variété même entraîne. Que ce soit sur les « petits » (en nombre de pages) plateaux (« Un seul ou plusieurs loups ? », qui finit de régler leur compte à certaines obsessions freudiennes et à leur rôle involontaire de leurres politiques, « Trois nouvelles, ou Qu’est-ce qui s’est passé ? », qui propose une fructueuse heuristique du statut du secret, « Visagéité », qui x, ou encore « Le lisse et le strié », qui propose une lecture neuve des espaces et de ce qui peut ainsi s’y produire, à partir de plusieurs modèles analogiques), ou sur les beaucoup plus vastes étendues de « Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible » (le plateau qui fournit la clé prioritaire – mais bien entendu pas la seule – de lecture pour « entrer » dans « Les furtifs » d’Alain Damasio, sur lequel on reviendra nécessairement), ou bien de « Traité de nomadologie : la machine de guerre », dont la lecture éviterait à tant de commentateurs contemporains la confusion permanente entre machine étatique et machine militaire, les mobilisations conceptuelles, qu’elles soient à dominante analogique ou analytique, impliquent aussi bien le professeur Challenger du « Monde perdu »(1911) d’Arthur Conan Doyle – à propos de géologie de la morale (les jeux de mots potentiellement signifiants ne sont certes pas étrangers à Gilles Deleuze et à Félix Guattari !), le Michel Foucault de « Surveiller et punir » (1975), le H.P. Lovecraft de « Démons et merveilles » (1919-1933), le Lénine de « À propos des mots d’ordre » (1917), l’Elias Canetti de « Masse et puissance » (1960), la Michèle Lalonde de « Speak White » (1968), ou le Claude Lévi-Strauss de « La pensée sauvage » (1962), que le « Penthésilée » (1808) de Heinrich von Kleist, le « Mythe et pensée chez les Grecs » (1965) de Jean-Pierre Vernant, le Paul Virilio de « Essai sur l’insécurité du territoire » (1976), le Carlos Castaneda de « Histoires de pouvoir » (1974), le Paul Klee de « Théorie de l’art moderne »(1924), le Gilbert Simondon de « Du mode d’existence des objets techniques »(1958), ou le Michel Serres de « La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce » (1977).
Éclectisme et syncrétisme sont ici les maîtres-mots, tout au long des 600 pages et de leurs treize plateaux, où les trilles du chant du pinson peuvent jouer un rôle aussi décisif que les caractéristiques de l’étrier du cavalier nomade, où une réflexion sur les mots d’ordre et les slogans de combat peut jouxter une incise sur l’idéologie et l’infrastructure, où les variations entre english et black english, avec les revendications des « langues majeures » vis-à-vis de prétendues « langues mineures », où la topographie des déserts de sable et de leurs imaginaires adjacents peut rencontrer les origines mythiques de l’idée de croisade. On saisit à chaque pas chez les deux auteurs l’intensité de leur lecture vorace, boulimique, pour exhumer les études et traités, les essais et romans, qui illustrent ou confirment des intuitions, des correspondances, des résonances.
Il y a un cas particulièrement important de transcodage : c’est lorsqu’un code ne se contente pas de prendre ou recevoir des composantes autrement codées, mais prend ou reçoit des fragments d’un autre code en tant que tel. Le premier cas renverrait au rapport feuille-eau, mais le deuxième au rapport araignée-mouche. On a souvent remarqué que la toile d’araignée impliquait dans le code de cet animal des séquences du code même de la mouche ; on dirait que l’araignée a une mouche dans la tête, un « motif » de mouche, une « ritournelle » de mouche. L’implication peut être réciproque, comme dans la guêpe et l’orchidée, la gueule de loup et le bourdon. J. von Uexküll a fait une admirable théorie de ces transcodages, en découvrant dans les composantes autant de mélodies qui se feraient contrepoint, l’une servant de motif à l’autre et réciproquement : la Nature comme musique. Chaque fois qu’il y a transcodage, nous pouvons être sûrs qu’il n’y a pas une simple addition, mais constitution d’un nouveau plan comme d’une plus-value. Plan rythmique ou mélodique, plus-value du passage ou de pont, – mais les deux cas ne sont jamais purs, se mélangent en réalité (ainsi le rapport de la feuille, non plus avec l’eau en général, mais avec la pluie…).
Explorant avec volontarisme (comme le fera Fredric Jameson, depuis un autre coin du terrain de jeu, dans ses « Archéologies du futur ») la parenté qui relie, par l’expérience de pensée, la science-fiction et la philosophie, repensant et balisant l’État dans le capitalisme tardif cinq ans avant la floraison cyberpunk, décryptant les lignes de l’Empire quinze ans avant Michael Hardt et Antoni Negri, « Mille plateaux » constitue une formidable illustration de son propre propos machinique et libérateur. Il n’est évidemment pas fortuit, bien au contraire, que l’une des plus puissantes trilogies souples du roman contemporain, celle construite par Alain Damasio en vingt ans, avec « La Zone du Déhors » (1999), « La Horde du Contrevent » (2004) et « Les Furtifs » (2019), en constitue une exceptionnelle transposition romanesque, et comme la démonstration de son intact pouvoir heuristique et décapant, auprès d’un public qui refuse désormais de se laisser abuser par les promoteurs de l’absence d’idéologie, dont on ne sait que trop à présent ce que contiennent les coffres prétendument neutres. Comme l’explicite lumineusement la redoutable conclusion des « Mille plateaux », « Règles concrètes et machines abstraites », cette récapitulation générale qui révèle que chaque excursion apparente, chaque pli fractal, jouait un rôle précis dans cette vaste démonstration exploratoire : usant du moléculaire contre le molaire chaque fois que nécessaire, nous pouvons produire de nouveaux agencements, résistants, imprévus, mobiles, ne se laissant pas si aisément appréhender par tout ce qui, encore et toujours, refuse la différence et revendique l’ordre efficace et servile.
Le nombre nombrant, nomade ou de guerre, a un premier caractère : il est toujours complexe, c’est-à-dire articulé. Complexe de nombres à chaque fois. C’est même par là qu’il n’implique nullement de grandes quantités homogénéisées, comme les nombres d’État ou le nombre nombré, mais produit son effet d’immensité par sa fine articulation, c’est-à-dire par sa distribution d’hétérogénéité dans un espace libre. Même les armées d’État, au moment où elles traitent de grands nombres, n’abandonnent pas ce principe (malgré la prédominance de la « base » 10). La légion romaine est un nombre articulé de nombres, de telle manière que les segments deviennent mobiles, et les figures géométriques, mouvantes, à transformation. Et le nombre complexe ou articulé ne compose pas seulement des hommes mais nécessairement des armes, des bêtes et des véhicules. L’unité arithmétique de base est donc une unité d’agencement : par exemple, homme-cheval-arc, 1 x 1 x 1, suivant la formule qui fit le triomphe des Scythes ; et la formule se complique dans la mesure où certaines « armes » agencent ou articulent plusieurs hommes et bêtes, ainsi le char à deux chevaux et à deux hommes, l’un pour conduire et l’autre pour lancer, 2 x 1 x 2 = 1 ; ou bien le célèbre bouclier à deux poignées, de la réforme hoplite, qui soude des chaînes humaines. Si petite soit l’ « unité », elle est articulée. Le nombre nombrant est toujours sur plusieurs bases à la fois. Encore faut-il tenir compte aussi des rapports arithmétiques extérieurs, mais contenus dans le nombre, qui expriment la proportion des combattants parmi les membres d’un lignage ou d’une tribu, le rôle des réserves et des stocks, des entretiens d’hommes, choses et bêtes. La logistique est l’art de ces rapports extérieurs, qui n’appartiennent pas moins à la machine de guerre que les rapports intérieurs de la stratégie, c’est-à-dire les compositions d’unités combattantes entre elles. Toutes deux constituent la science de l’articulation des nombres de guerre. Tout agencement comporte cet aspect stratégique et cet aspect logistique.
Gilles Deleuze et Félix Guattari - Mille Plateaux - éditions de Minuit ,
Charybde2 le 18/06/19
l’acheter ici