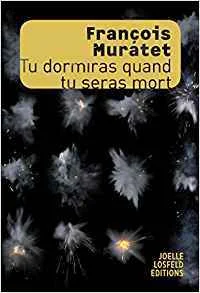Tu dormiras quand tu seras mort : L'Algérie vue de la guerre par François Muratet
La guerre d’Algérie, sur le terrain, toujours plus complexe qu’il n’y paraît vu de loin.
On était à la fin de l’année 1959 et le général président avait décidé de mettre le paquet pour terminer la guerre en Algérie. Ça voulait dire balancer du muscle et du plomb, retourner chaque caillou du djebel, napalmer les caches et exterminer la vermine hors-la-loi. Bref, montrer que les temps avaient changé, qu’un dur était aux commandes, qu’on avait fini de zigzaguer entre la causerie déboutonnée et le coup de poing dans la tronche, et moi je voulais être de la fête avant qu’il ne soit trop tard. Comme les seconds rôles ne m’intéressaient pas, j’avais fait l’école des élèves-officiers de réserve et je rêvais d’actions héroïques, décisives. C’était il y a un an et j’étais un gamin, j’imaginais monter à l’assaut de positions rebelles avec mes gars, analyser des cartes en disant, le doigt pointé sur un talweg. « Les fells sont là ! », accepter les missions dangereuses qu’un colonel à la mâchoire carrée et aux yeux bleus m’aurait données en sachant que moi seul, avec mes gars bien sûr, pourrait les mener à bien.
Contrairement à beaucoup de jeunes de ma génération, je pensais que la France devait montrer de quoi elle était capable en Algérie, c’était une question d’honneur, de fidélité, de grandeur, d’héritage. Se bousculaient dans mon esprit les images de Vercingétorix, Du Guesclin, d’Artagnan, celles aussi des grognards de Napoléon et des résistants de la Seconde Guerre mondiale, et surtout des hommes de Londres, comme mon père l’avait été, les fidèles du Général, la jeune garde des soldats dévoués à une cause immense, celle de la patrie, alors même qu’elle était rabaissée par le maréchal collabo. Combattre comme eux, risquer ma vie, la perdre au combat comme mon père avait perdu la sienne, ça me donnait la chair de poule rien que d’y penser. Je me disais que ce n’était pas possible que des bougnoules puissent résister à notre armée. Il n’y avait qu’à voir la branlée qu’ils avaient prise en Égypte pendant la guerre de Suez. Avec de Gaulle, ça allait être vite torché.
Commando de chasse en Algérie
Si la guerre d’Algérie n’a sans doute pas inspiré en France, plus de cinquante ans après les accords d’Évian, autant de fictions et d’études que la guerre du Vietnam aux États-Unis, il n’en reste pas moins que, bien au-delà du colossal succès, à l’époque, des « Centurions » (1960) et des « Prétoriens » (1961) de Jean Lartéguy, et de l’enthousiasme critique porté par les films de Pierre Schoendorffer (enthousiasme plus mitigé d’ailleurs, in fine, pour celui portant plus particulièrement sur l’Algérie, « L’honneur d’un capitaine » en 1982), ce conflit colonial qui ne fut jamais officiellement une guerre continue avec bonheur d’inspirer les romanciers qui osent s’attaquer, avec un peu de recul désormais, à sa redoutable complexité, au-delà des emportements des vingt premières années ayant suivi l’indépendance algérienne. Les lignes de clivage politique ont été particulièrement marquées ici, et il reste souvent fort délicat de porter de la nuance là où l’anathème domine souvent encore : que l’on songe par exemple aux accueils parfois houleux faits au Mehdi Charef du « Harki de Meriem », ou plus récemment au Kamel Daoud de « Meursault, contre-enquête ».
– Repos, lieutenant. Car vous êtes lieutenant, voici votre nomination.
J’ai pris le document qu’il me tendait. Un papier à en-tête du ministère de la Défense, un arrêté que je n’arrivais pas à lire tellement ça se bousculait dans ma tête. C’était trop rapide, comme promotion. Normalement, c’est quoi, deux ans ?
– Asseyez-vous. Ça, c’était la mauvaise nouvelle.
Il a tiré sur son cigare.
– La bonne, la voici : vous partez en Algérie.
Il me tendait un autre papier, une feuille de route, tout en exhalant une grosse bouffée qu’il a chassée d’un revers de la main. Et il a ri en voyant ma tête.
– Le haut commandement a besoin d’hommes, là-bas. Les tâches de renseignement sont primordiales dans la guerre contre les bandes du FLN. J’ai pensé que ça vous ferait du bien d’aller voir le djebel.
Il riait encore. Je regardais la feuille de route, la nouvelle était un coup de tonnerre. Cela avait-il un rapport avec sa fille ?
– Vous ne dites rien, lieutenant ?
Harkis en Algérie
Jeune appelé, officier de renseignements ambitieux et patriote, fils d’un défunt héros de la France libre, André Leguidel se retrouve affecté en Algérie alors que s’ennuyant au sein des Forces Françaises en Allemagne, il ne l’espérait plus. C’est sur place qu’il va découvrir, en plus de certaines vérités jusqu’alors cachées le concernant personnellement, à travers une curieuse mission d’infiltration interne, dans laquelle, déguisé en simple soldat, il va devoir s’assurer de la loyauté d’un sous-officier français d’origine algérienne (qui n’est pas pied-noir, le vocabulaire officiel brillant là encore par ses palinodies), soupçonné par une partie de la hiérarchie et admiré par les autres, que derrière le décor du patriotisme et de la grandeur de la France, bon nombre de réflexes conditionnés, impérialistes ou simplement racistes, grouillent – et pas toujours là où on les attendrait.
Déjouant avec ruse les attentes immédiates de son protagoniste comme celles de sa lectrice ou de son lecteur, François Muratet nous offre ainsi à la fois une superbe tranche de roman de guerre « de terrain », digne par exemple des ambiances de « La 317ème section », le roman fondateur de Pierre Schoendorffer, en 1963, et une investigation de la complexité des rapports socio-politiques, une fois ramenés à un (petit) groupe humain, comme l’avaient fait à leur manière, et avec leurs propres angles, Olivier Martinelli dans « L’ombre des années sereines », Mehdi Charef dans « 1962, le dernier voyage », Perrine Le Querrec et Lalie Walker dans « Le chant des dunes », ou encore Francis Zamponi dans « Mon colonel ». Et si elle est brutale, la belle citation de Joseph Conrad à propos des guerres coloniales qui figure en exergue du roman, avec sa sourde évocation subtilement anachronique de « L’art français de la guerre »d’Alexis Jenni, prend tout son sens lorsque le roman atteint son régime de croisière, dans le djebel. Quinze ans après « La révolte des rats », c’est avec un bien beau roman, publié chez Joëlle Losfeld en mars 2018, que l’auteur met fin à ce long silence littéraire.
François Muratet
François Muratet - Tu dormiras quand tu seras mort - éditions Joëlle Losfeld
Charybde2 le 15/06/18
l'acheter chez Charybde ici