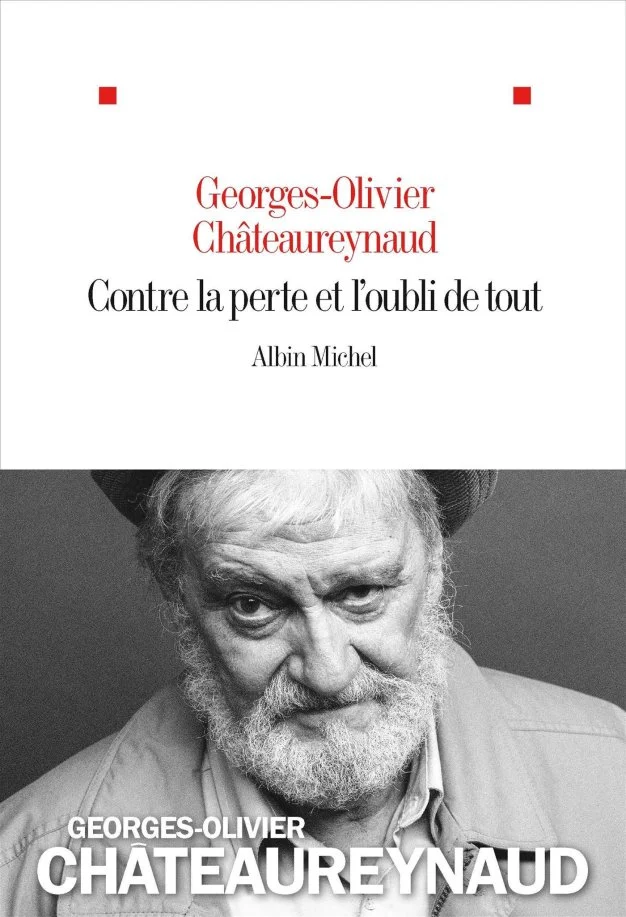Châteaureynaud voyage en simple passager du train du fantastique
Belles réflexions sur un art personnel de lire et d’écrire le fantastique, ou même la littérature d’imaginaire dans son ensemble.
Publié fin août 2018 chez Albin Michel, « Contre la perte et l’oubli de tout » se présente en recueil critique et autobiographique, dessinant par touches éclectiques comme l’esquisse gouailleuse d’un art d’écrire, art de l’imagination qui étendrait ses racines aux frontières entre les genres littéraires, espace cher s’il en est à Georges-Olivier Châteaureynaud (distingué aussi bien par le prix Renaudot – pour « La Faculté des songes » – et le prix Goncourt de la nouvelle – pour « Singe savant tabassé par deux clowns » – que par le Grand prix de l’Imaginaire – pour « L’Autre rive »), et tout particulièrement à la lisière du fantastique et de ses territoires multiples.
Je ne me suis autorisé, en entreprenant cette réflexion sur le fantastique, que de la qualité de simple usager du fantastique. Pour moi le fantastique est comme un train que j’emprunterais presque chaque jour. Dans ce train, je lis et j’écris des histoires. Il est naturel qu’au fil du temps le décor et les aménagements du wagon, la physionomie des passagers, leur allure et leurs propos, mais aussi les paysages qui défilent à la fenêtre, me soient devenus familiers. C’est donc d’une longue fréquentation de la ligne que sont nées ces considérations.
Je revendiquais il y a un instant la qualité de simple usager du train du fantastique… Pas si simple que cela, puisque, en ayant écrit moi aussi, c’est comme si j’avais peu ou prou contribué à alimenter la motrice. Mais pourquoi celle-là, vieille loco pittoresque crachotant vers le ciel des bouffées de vapeur désuète, sous les caténaires de la modernité ? C’est qu’il m’est apparu qu’elle seule desservait ma destination. Si la fiction a répondu à la plupart des questions que je me posais devant l’existence – car c’est à cela que servent l’art et la littérature, il me semble -, elle l’a fait dans la langue du fantastique plutôt que dans celle du réalisme.
C’est en effet le fantastique, sous beaucoup de ses formes, qui se taille la part du lion parmi ces 200 pages : pénétrant essai liminaire (« Le fantastique malentendu »), jolie mise en application pratique de quelques principes d’actualisation évoqués dans l’essai (« Histoire de l’abribus hanté »), copieuse et passionnante « revue » de textes et d’auteurs permettant tous, peu ou prou, d’illustrer ou de renforcer le propos théorique (« Le fantastique bien entendu »). Ainsi Marcel Aymé et sa malice, le machiavélique « L’invention de Morel » d’Adolfo Bioy Casares (qualifié de « Mon roman de Damas » par l’auteur), le trop peu lu à son goût (et ses mots pour le dire donnent bien envie, en effet, de s’y ruer) Noël Devaulx, André Hardellet vu « au seuil du jardin », l’étonnant nouvelliste estonien Mehis Heinsaar, la « Forêt forteresse » de Michel Host, l’immense « Epépé » de Ferenc Karinthy (on peut aussi entendre l’auteur en parler en détail ici, lors d’une soirée à la librairie Charybde), Jean Lorrain et ses « morbidités », Marcel Schneider surtout et son impressionnant (semble-t-il, car il s’agit pour moi d’une autre découverte) condensé d’essence ultime du fantastique, entre autres, sont convoqués, analysés et mis à contribution d’une manière qui donne réellement, s’il en était besoin, envie de les lire ou relire, encore et encore.
Hubert Haddad
Les articles proposés dans le reste du recueil sont au fond davantage des ajouts ponctuels ou des contrepoints à l’ossature fournie par l’essai sur le genre fantastique et par ses commentaires directs : réflexions à propos d’un auteur ami cher dont l’oeuvre résonne fondamentalement avec celle de Georges-Olivier Châteaureynaud (« Quatre romans d’Hubert Haddad »), parmi lesquelles les pages consacrées à « Palestine »(2007) se distinguent tout particulièrement, élégants musardages à propos d’un maître du roman gris, d’une insularité de pleine terre et d’une extraordinaire mécanicienne (« Trois réalistes : Pascal Garnier, Marie-Hélène Lafon, Annie Saumont »), d’hommages et d’anecdotes significatives puisées dans une jeunesse enfuie mais bien présente (« In memoriam : Élie Delamarre-Deboutteville, Bernard Privat, Voler Gracq » ou « Quartier Latin (Une jeunesse au temps du Général) »), ou réflexions sur les apports spécifiques d’un travail particulier, celui de l’intervention directe des auteurs au sein des cursus de lettres, dans l’enseignement secondaire principalement (« La manière et l’art (Sur les ateliers d’écriture) »).
Borgès
J’entretiens avec la poésie des rapports apaisés, depuis que, vers l’âge de vingt-trois ans, j’ai fini d’en écrire. Elle m’était, sinon un tourment, un inconfort, tandis que la prose, la prose narrative, inventer et raconter des histoires, m’apparut après quelques tâtonnements un exercice à la fois plaisant et aisé, simple comme bonjour.
Non que j’aie jamais ignoré le sérieux de ce jeu d’enfant, la fiction. Rien de plus adulte que lui. Sous couvert de divertissement il engage tout l’être, sur les fragiles fondations duquel les fictionnaires, romanciers et nouvellistes, édifient des citadelles présomptueuses, le plus souvent vouées à une ruine proche ou lointaine. Mais il faut qu’elles tiennent au moins quelques années debout, et pour cela leurs bâtisseurs doivent s’astreindre à soumettre leur spontanéité d’invention au contrôle d’un esprit critique aussi intransigeant que possible. Cet écartèlement entre imagination et rigueur, entre inspiration et métré, me convenait. Il me comblait et me sauvait. Il me contraignait à faire sans cesse en moi la part du réel, tout en ménageant celle, irréductible, de sa transgression. Le « fantastique », puisque c’était ma pente, n’était pas sans entretenir avec la poésie quelques liens. D’une certaine façon, en écrivant des histoires de ce genre, je ne prenais vis-à-vis d’elle qu’un peu de champ.
Maniant aussi bien la forme longue que la forme courte, s’intéressant aussi bien au passé de la littérature qu’à son futur, Georges-Olivier Châteaureynaud aurait certainement beaucoup à dire : son article consacré à la nouvelle nous laisse donc quelque peu sur notre faim (« Worst-sellers ? (Sur la nouvelle) »).
Les deux derniers articles (« Des rapports apaisés avec la poésie » et « L’inconscient romancier ») témoignent certes du rapport de l’auteur à la poésie et à une certaine forme de critique littéraire héritée des années 1960 et 1970, et contiennent plusieurs fulgurances appréciables, mais sont sans doute un peu gâchés, toutefois, par leur trop grande brièveté, et par la perception d’un ressentiment (ou de quelque chose s’en approchant) à l’égard de celles et ceux ne partageant pas la passion un rien exclusive de l’auteur pour la narration per se et pour le récit roi.
Georges-Olivier Châteaureynaud - Contre la perte et l’oubli de tout, éditions Albin Michel
Charybde2 le 5/12/2018
l’acheter chez Charybde ici
Georges-Olivier Châteaureynaud