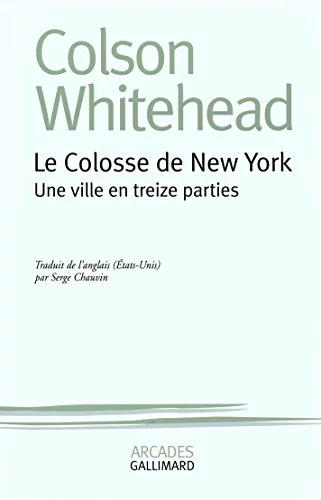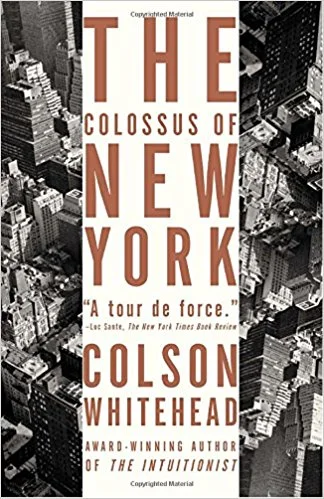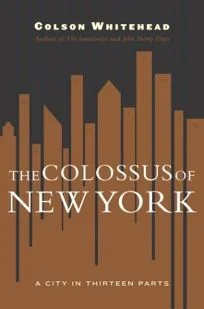Après Pérec sur Paris, Colson Whitehead embraye sur l'essence de New york
Tenter de sentir l’essence d’une ville, New York, en treize tableaux fiévreux et subtilement ironiques.
Les livres d’histoire et les documentaires culturels s’acharnent à vous offrir des « faits » sur New York. Comme quoi Canal Street fut jadis un canal. Et Bryant Park un réservoir. Tout ça, c’est de l’esbroufe. Je suis allé à Canal Street, et la seule fois que j’y ai vu couler une rivière c’était parce que les canalisations avaient sauté. N’écoutez pas ce que les gens vous racontent sur le New York d’antan : si vous n’avez pas vu la chose de vos propres yeux, elle ne fait pas partie de votre New York, et elle pourrait aussi bien être dans le New Jersey. À part l’histoire des Hollandais achetant Manhattan pour vingt-quatre dollars : il y a, il y aura toujours des gens pour se vanter d’avoir « flairé l’occase ». (« Les portes de la ville »)
C’est en 2003, quatre ans après la parution de son premier roman remarqué, « L’intuitionniste », et treize ans avant la double consécration de son sixième, « Underground Railroad », par le National Book Award et par le Pulitzer, que le journaliste du Village Voice Colson Whitehead proposait cette méditation incisive, en treize tableaux, sur la nature intime de New York (où il a vécu quasiment toute sa vie), et au-delà, sur l’essence même d’une ville, et de ce qui la lie ou non à ses habitants.
Impossible de faire ses adieux dignement. C’était votre dernier trajet dans un taxi à damier, et personne ne vous a prévenu. C’était la dernière fois que vous alliez manger des crevettes Lake Tung Ting dans ce restaurant chinois vaguement louche, et vous ne vous doutiez de rien. Si vous aviez su, vous auriez peut-être fait irruption derrière le comptoir, serré la main à tout le monde, sorti l’appareil photo et ordonné au personnel de prendre la pose. Mais vous ne vous doutiez de rien. Il y a des points de bascule méconnus, un nombre fini de fois où l’on déverrouille la porte d’un appartement. Et à un certain moment, vous vous êtes trouvé plus près de la dernière fois que de la première, et vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas que, chaque fois que vous franchissiez ce seuil, vous lui disiez adieu. (« Les portes de la ville »)
Le premier tableau, « Les portes de la ville », plus long que tous les autres, dessine en quelque sorte le programme rêveur et une partie de l’approche que veut mettre en œuvre ce « Colosse de New York », avant de plonger dans la matière vibrante, par une arrivée en bus (2 : « Gare routière »), alors que la fin sera celle d’un départ en avion (13 : « JFK »). Entre temps, Colson Whitehead aura exploré dans un curieux mélange de fièvre descriptive et d’ironie méditative les agitations perpétuelles et les peurs fantasmées ou bien réelles qui les accompagnent (3: « Matin », 5 : « Métro », 10 : « Heure de pointe »), le rapport local à quelques espaces mythiques à fort impact psychologique (4 : « Central Park », 7 : « Broadway », 8 : « Coney Island », 9 : « Pont de Brooklyn », 12 : « Times Square »), voire le résultat toujours étonnant de conditions météorologiques particulières (6 : « Pluie »), matériau géographique et humain dont il opère la synthèse juste avant l’envol (11 : « En ville »).
Le matin, les rues appartiennent aux livreurs de pain et aux bennes à ordures. Les agents de l’hygiène caracolent vers les trottoirs en quête de trouvailles, de trésors cachés, et hissent la mie mâchée et les miettes qu’ont laissées les livreurs de pain, quelques jours plus tôt. On livre et on ramasse. Des gloutons de douze tonnes mastiquent le trottoir et rotent aux fenêtres en rafales mécaniques. On aurait bien besoin d’un coq. On n’a droit qu’à un cocorico hydraulique. Les meules de tabloïds se dressent. Les poubelles vidées dérapent jusqu’à leurs points d’ancrage au coin des rues. Les commerçants relèvent les grilles métalliques qui protègent des cambrioleurs des marchandises indignes d’être volées. Tout ce grincement de métal, c’est la machine du matin qui déploie tous ses engrenages pour nous mobiliser et nous secouer. Un coup d’œil au réveil, pour vérifier le sommeil qu’il nous reste. Il y a encore le temps. En bas, ils livrent et ils ramassent. Nous avons tous des itinéraires à respecter pour faire tourner la ville. (« Matin »)
Tendre et irrévérencieux, féroce et joueur, poète d’un quotidien ingrat et d’une métropole féroce, Colson Whitehead observe, regroupe, traduit et interprète ces milliers de mouvements physiques ou purement intérieurs pour établir en treize touches un portrait de New York qui n’est sans doute pas psychogéographique à proprement parler (même si la dérive des sentiments et des impressions joue ici un rôle indéniable), mais peut-être plutôt celui d’une création collective, unissant la ville elle-même et la variété de ses habitants dans une trame historique toujours renouvelée, par laquelle les lieux ne peuvent in fine exister que dans l’esprit et la pratique de celles et ceux qui les fréquentent, les voient et même, consciemment ou inconsciemment, les pensent.
Le premier jour de printemps, en quête d’antidote, ils veulent tous aller au parc, sans se rendre compte de l’impératif biologique. Tout le monde a la même idée. Après tout, ça fait un bail. Pendant de longs mois ils ont attendu ça, ils ont bravé la gadoue et porté des gros pulls. Alors ça craque en eux, une brindille sous le pied : le Parc. Le seul endroit qu’on a oublié de bitumer. Mais ça viendra. Patience. (« Central Park »)
Utilisant une écriture soigneusement sonore (qui me semble particulièrement bien rendue par la traduction de Serge Chauvin, publiée dans la collection Arcades de Gallimard en 2008) qui ne l’empêche jamais de glisser plus ou moins subrepticement quelques précieuses arrière-pensées ou quelques doses de venin songeur, Colson Whitehead nous offre une contribution atypique et fort attachante à la transformation de la matière journalistique apparemment évidente en littérature profondément et intelligemment humaine.
Colson Whitehead 2017
Bâtissez plus gros, plus beau. Plus brillant, plus percutant. Les immeubles grandissent, et nous enfouissent toujours plus bas dans leur course au sommet. On fait la course jusqu’au ciel, le dernier arrivé est un canard boiteux, tout juste bon à abriter des cabinets d’avocats. Tout là-haut, au grand QG de la multinationale du divertissement, les décideurs dictent vos rêves. Ici-bas, les vendeurs des rues fourguent des brûlures d’estomac, mais au moins ils portent des gants, en vertu des règlements sanitaires. Un homme distribue des prospectus, et on l’évite comme s’il tenait une liasse de virus, et non des pubs pour des prothèses à prix réduit. L’ancien pickpocket deale désormais des tickets de haute altitude pour des spectacles de Broadway défraîchis. Le représentant en ampoules, dont c’est la première visite, pivote tout joyeux en disant : On sait maintenant quoi faire de nos ampoules colorées. Tout le monde a quelque chose à vendre. Je vous ai parlé de l’office de bienvenue ? Le bureau de recrutement des Forces armées des États-Unis a un local de rêve, idéalement situé au milieu d’un chaos où chacun est une armée à lui tout seul. Protégez vos frontières. Réveillez votre instinct de conservation. Allez tâter du joystick. Les experts s’accordent à dire que les jeux vidéo améliorent la coordination entre la main et l’œil. Les délinquants juvéniles grappillent des pièces pour les machines, cherchent au fond de leurs poches des mensonges à raconter aux flics et aux parents. Les gamins des banlieues résidentielles s’échangent des alibis. Puisque vous êtes là, les petits, profitez-en pour apprendre quelques trucs du monde des adultes. Apprenez qu’on n’a jamais assez d’alibis. (« Times Square »)
Colson Whitehaed, Le Colosse de New-York, éditions Gallimard, collection Arcades
Charybde2, le 6/09/17
l'acheter ici