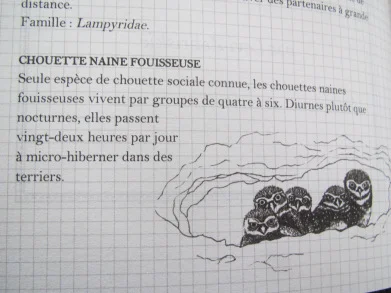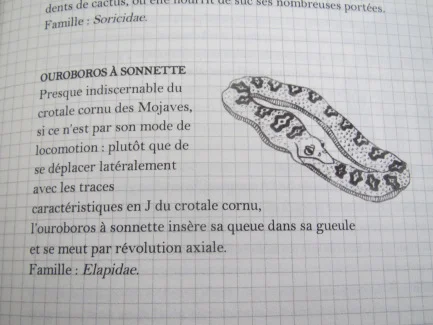Or, gloire et citron ou les storytellings politiques fabulés de Claire Vaye Watkins
L’affrontement généralisé des storytellings politiques, sociaux et intimes, déguisé en bizarre fable post-apocalyptique et écologique.
Elle n’aurait pas dû faire entrer le chien de prairie dans la bibliothèque. Luz Dunn le savait à présent, mais c’était la première bestiole vivante qu’elle voyait depuis longtemps et son apparition l’avait déstabilisée. Elle s’était réveillée un peu avant midi, après un rêve ambitieux qu’elle comptait bien réaliser : essayer toutes les robes de la maison. Elles tapissaient comme un plumage le dressing de la grande chambre, une gamme complète de coloris exquis, chaque spécimen absolument hors de prix – alors imaginez celles que la starlette avait mises dans ses bagages… Dans son rêve, Luz les portait toutes en même temps, ses seins incrustés de strass et noyés de poussière d’argent, ses fesses brodées d’allées de sequins cuivrés, ses hanches s’évasant en un panache de satin plissé, une barbe à papa de tulle pâle flottant jusqu’à ses pieds. Bien entendu, dans le monde languissant du réveil il fallait s’en tenir à une chose à la fois.
C’était important d’avoir des projets, disait Ray, même frivoles. Les vents brûlants de Santa Ana balayaient le canyon de leurs invisibles particules qui rendaient fou, et Ray pensait qu’elle ferait bien de trouver de quoi s’occuper les mains. De ne pas tant dormir. Parmi ses projets à lui, il y avait creuser la fosse d’aisances et siphonner l’essence des voitures de luxe abandonnées un peu partout dans la région.
Luz, chicana, ex-starlette hollywoodienne un peu particulière, puisqu’elle fut l’emblème, de son enfance à son adolescence, de la grande campagne publicitaire californienne visant à lutter contre la sécheresse qui menaçait alors de plus en plus, et Ray, ex-militaire vétéran d’une de ces guerres impériales visant à préserver la paix dans le monde et les intérêts des puissants, filent tous deux le parfait amour (ou presque) dans les vestiges encore occasionnellement luxueux d’une Los Angeles abandonnée des dieux et du gouvernement fédéral, depuis que la sécheresse absolue – qui n’a finalement pas pu être contenue ou évitée – a contraint les Californiens du Sud à l’évacuation plus ou moins piteuse en direction d’autres États moins menacés – pour l’instant – par la raréfaction ou la disparition des pluies.
Un texte post-apocalyptique survivaliste de plus, dans un paysage littéraire qui en manque de moins en moins ces dernières années ? Certes, mais pas du tout uniquement cela, loin s’en faut. Avec ce premier roman publié en 2015 (dont la traduction française de Sarah Gurcel est parue chez Albin Michel en septembre 2017), faisant suite à un recueil de nouvelles fort remarqué, Claire Vaye Watkins a su intriquer subtilement plusieurs thématiques qui, si elles s’entrechoquent par moments au prix de quelques maladresses, en font sans doute l’un des romans les plus intéressants du moment, dans le genre science-fictif ou en dehors (ce roman-ci ne se revendiquant pas de la science-fiction en soi, même s’il en utilise plusieurs des meilleures pratiques).
Si l’on devine aisément la référence au J.G. Ballard de « Sécheresse » (1964), la filiation des « Sables de l’Amargosa » est sans doute surtout à établir du côté du « Gang de la clef à molette » (1975) d’Edward Abbey, dans un référentiel du Sud-Ouest américain et de sa nature que Claire Vaye Watkins (comme en témoignaient autant les nouvelles de son premier recueil en 2012, « Nevada », que plusieurs entretiens parus dans la presse américaine, canadienne ou anglaise en 2015) maîtrise remarquablement : la désertification, l’épuisement des nappes phréatiques et la destruction du cycle des pluies apparaissent bien ici, au fil des explications distillées incidemment par tel ou tel protagoniste, quel que soit son niveau intrinsèque de crédibilité (cette crédibilité défaillante des « explications » est bien l’un des enjeux du roman – on y reviendra), comme les conséquences à plus ou moins longue échéance de la disparition du Colorado en tant que fleuve et, de facto, de l’ensemble de son bassin, mis au service intensif de l’irrigation californienne. En ce sens, il est dommage que le titre français se soit à ce point éloigné du titre américain, « L’or, la célébrité, les agrumes », réponse mythologique moderne à la devise « J’ai trouvé » de l’État de Californie, phrase qui revient pourtant comme un véritable leitmotiv tout au long des 400 pages du roman.
Mais le sable, tout ce sable, ce sable infini et monstrueux. Qui avait émaillé le Sud-Ouest d’un réseau d’aqueducs ? Qui avait asséché d’abord le lac Owens, puis les lacs Mono, Mammoth, Havasu et cetera, pour ne laisser que de grandes macules de poussière blanche ? Qui avait détourné les eaux de pluie de la côte et pompé les nappes phréatiques du Grand Bassin ? Qui avait creusé sous le lac Mead, installé un drain au point le plus bas et vidé l’ensemble comme un lavabo ? Qui avait épuisé les aquifères de l’Ogallala et du Rio Grande, la couverture neigeuse de la Sierra Nevada et des Cascade Mountains ? Si c’était Dieu, il portait de nouveaux noms : Conseil municipal de Los Angeles, Service de l’eau et de l’électricité de Los Angeles, Ville de San Diego, Ville de Phoenix, Service de l’eau et de l’électricité d’Arizona, Commission de l’eau du Nouveau-Mexique, Direction de l’eau et de l’habitat de Las Vegas, Bureau de gestion du territoire, Département de l’Intérieur des Etats-Unis.
Les métaphores étaient inévitables. L’Amargosa était une maladie : un cancer, une malignité, une tumeur. Un bulldozer, un rouleau compresseur. Une bête insatiable, un corps obèse s’autogénérant, une boursouflure informe se bâfrant de terres fraîches, diverses images d’appétit extrême, projection des désirs les plus laids de notre moi profond.
L’Amargosa était en colère, cruelle, insensible – une personnification inévitable, pardonnable, même, car parfois la masse semblait bouger avec discernement. Des témoins rapportaient des épisodes où il leur avait semblé qu’elle suspendait sa progression, ou que, plutôt que d’écraser une ville de son pied ferme, elle l’enveloppait, comme un étreinte, comme pour donner aux habitants le temps d’accrocher leur caravane à leur voiture et de se mettre à l’abri. Une fois, ses bourrasques soulevèrent un enfant qui jouait aux osselets dans son jardin et le déposèrent sain et sauf sur la benne à ordures derrière la station-service où travaillait sa mère. Mais une avalanche de sable qui bourdonnait quinze kilomètres plus loin dévia tout aussi facilement pour avaler une ville entière en quelques minutes. On parlait du mal incarné, mais aussi de l’œil grand ouvert de Dieu.
Le grand désert mobile, à l’avancée inexorable, de l’Amargosa, qui serait né du delta disparu du Colorado en Basse-Californie et s’étendrait désormais sans relâche vers le Nord et vers l’Est, n’est ici qu’un fort beau prétexte. Malgré son luxe de détails, pour la description desquels Claire Vaye Watkins démontre un authentique talent de conteuse écologique et de nature writer (les références à John Muir et à bien d’autres figures tutélaires de la frontière et de la wilderness abondent d’ailleurs), allant jusqu’à un extrait, sur cahier d’écolier dans le corps du livre, d’un bestiaire recensant sa faune nouvelle et bien particulière, ce décor extraordinaire ne doit pas masquer que « Gold, Fame, Citrus » nous parle avant tout – et avec quelle rouerie ! – de l’affrontement de divers storytellings (au sens développé notamment par Christian Salmon), au long cours comme à très court terme.
Storytellings politiques : on sera ainsi travaillé par l’apparition de divers credos, sous des formes habilement trafiquées, allant de la justification de toutes les politiques sécuritaires et de la torture préventive (on songera au « Supplice de l’eau » de Percival Everett), de l’abdication organisée face aux lobbys industriels (on songera à nouveau à Edward Abbey, plus particulièrement ici à celui du « Retour du gang de la clef à molette », mais aussi au John d’Agata de « Yucca Mountain », dont on pourrait jurer que Claire Vaye Watkins a voulu fournir dans un de ses passages un chapitre supplémentaire, en forme de contrepoint et de pied-de-nez tragique) jusqu’aux explications complotistes de toute nature (dont certaines auraient pu constituer dans leur cohérence insensée un régal tardif pour les scénaristes à bout de souffle des « X-Files »). Storytellings sociaux : des clichés survivalistes de masse, soigneusement retournés après avoir été empruntés à la trilogie « Matrix » ou à la série « Walking Dead », plutôt qu’aux films « Mad Max » (évoqués par certains critiques), avec leurs réorganisations des pouvoirs, aux manières dont se construisent les sectes (on songera alors au troublant et décisif « La couleur de la nuit » de Madison Smartt Bell, et l’on interrogera peut-être l’impact sur le roman de l’ancienne appartenance du père de l’autrice à la « Manson Family »). Storytellings intimes, enfin : il est poignant de discerner que, au cœur de l’ensemble, gît aussi une tentative de redéfinition du discours amoureux, qui semble bien échouer tragiquement dans la réitération des clichés patriarcaux, mais aussi des illusions psychologiques faussement libératrices. L’enfant, Ig ou Estrella, lâché comme une proie ou un leurre au centre du dispositif, l’enfant autour duquel semble longtemps s’organiser la roue de l’ensemble des thématiques, ne se révèle-t-il pas in fine dans sa vraie nature pour les protagonistes, à tous les niveaux : celle d’un support de communication ?
Les versions circulant dans les professions libérales peuplent la colonie de réfugiés de la bourgeoisie. Une enseignante célibataire n’a pas déposé son dossier de titularisation à la faculté. Le service environnement n’a plus de nouvelles du petit nouveau tout droit sorti d’une université prestigieuse de l’Ivy League. Le directeur ultra-pointilleux d’un illustre laboratoire de recherche n’a pas renouvelé ses demandes de financement. Un post-doctorant brillant mais solitaire n’est pas revenu à son bureau dans la bibliothèque de l’institut.
Selon les approximations du sous-prolétariat, la colonie est un mélange d’habiles escrocs, de charlatans et de marchands d’élixirs de jouvence, héritiers de cœur des pionniers de la grande ruée vers l’or de 1849 : ils guettent la manne pétrolière, quand l’énorme masse de sable recrachera ses doses d’or noir, ou bien la manne aventurière, quand le sommet dépassera le Denali, la plus haute montagne du continent, et que les balades en hélicoptère iront au plus offrant, qu’un escadron de millionnaires à vestes colorées et barbes de trois jours se dresseront sur leurs tas d’argent pour être les premiers en haut.
Pour la gauche, c’est un avant-poste de survivalistes, de Cassandres qui pensent que l’Amargosa leur a donné raison, installés dans de vieux wagons de marchandises rouille orangé, rouge, bleu clair vif, avec des stocks d’armes, de boîtes de conserve, de bouteilles d’eau et de rations militaires. Un refuge de pérégrins libertaires et autres vagabonds, clochards, nomades, préférant se passer d’adresse, une garnison d’énervés, chatouilleux de la gâchette, qui viennent froncer les sourcils et cracher leur jus de tabac dans ce nouveau Vieil Ouest.
Pour la droite, c’est l’épicentre de la bio-révolution, une utopie dynamique où les beatniks du Nouveau-Mexique se sont rapatriés depuis le « Cercle enchanté » du Grand Sud – à moins que ce ne soient les toxicos vieillissants d’Atlas City depuis Tucson, ou les écolos de No Where Ranch depuis Santa Fé, ou les végétaliens vitrux de Gaia Village depuis Taos, ou les tourtereaux sulfureux de l’Agape Force depuis Sébastopol, ou les anarcho-communistes du Ant Hill Collective depuis Oakland, ou les surmenés de l’Alpha Farm depuis Grass Valley, ou les amazones saphiques de Girlhouse depuis Portland, ou kes junkies du Compound depuis Santa Monica, ou les adeptes du Burning Man depuis Minden, ou les moines rasés du Shamanic Living Center depuis Ojai, ou le groupe d’impro Technicolor Tree Tribe depuis Santa Cruz -, tous dans leurs géonefs roulantes, faites de pneus, de bouteilles et d’argile à l’empreinte carbone nulle.
La belle lecture de Yan sur le blog Encore du Noir est ici. Sa chronique se conclut par : « Voilà un roman incontestablement original et d’une remarquable maîtrise dont la façon d’aborder avec finesse des questions complexes, sans verser dans un symbolisme lourd, n’est pas la moindre des qualités. » Je ne peux que confirmer de mon côté, avec une certaine joie inquiète, ce sentiment.
Claire Vaye Watkins par Heike Steinweg
Claire Vaye Watkins, Les Sables de l'Amargosa, éditions Albin Michel
Charybde2
l'acheter ici