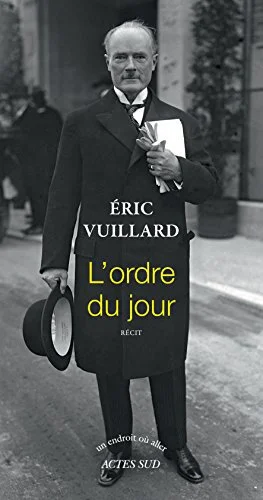L'Histoire avec du recul d'Eric Vuillard
Montée du nazisme : coups de force et coups de bluff à l’ère des connivences fort peu paradoxales.
Nous sommes un lundi, la ville remue derrière son écran de brouillard. Les gens se rendent au travail comme les autres jours, ils prennent le tram, l’autobus, se faufilent vers l’impériale, puis rêvassent dans le grand froid. Mais le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Pourtant, la plupart passèrent leur matinée à bûcher, plongés dans ce grand mensonge décent du travail, avec ces petits gestes où se concentre une vérité muette, convenable, et où toute l’épopée de notre existence se résume en une pantomime diligente. La journée s’écoula ainsi, paisible, normale. Et pendant que chacun faisait la navette entre la maison et l’usine, entre le marché et la petite cour où l’on pend le linge, puis, le soir, entre le bureau et le troquet, et enfin rentrait chez soi, bien loin du travail décent, bien loin de la vie familière, au bord de la Spree, des messieurs sortaient de voiture devant un palais. On leur ouvrit obséquieusement la portière, ils descendirent de leurs grosses berlines noires et défilèrent l’un après l’autre sous les lourdes colonnes de grès.
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-quatre paires d’épaules rembourrées de laine, vingt-quatre costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pinces, avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l’Assemblée ; mais bientôt, il n’y aura plus d’Assemblée, il n’y aura plus de président, et, dans quelques années, il n’y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants.
Pour le moment, on dévisse vingt-quatre chapeaux de feutre et l’on découvre vingt-quatre crânes chauves ou des couronnes de cheveux blancs. On se serre dignement la main avant de monter sur scène. Les vénérables patriciens sont là, dans le grand vestibule ; ils échangent des propos badins, respectables ; on croirait assister aux prémices un peu guindées d’une garden-party.
Éric Vuillard, depuis qu’il a adopté – après son « Conquistadors » de 2009 – la forme ramassée et hautement explosive qui est progressivement devenue l’une de ses marques de fabrique, fait pour moi figure de véritable magicien littéraire contemporain, capable désormais mieux que personne d’extraire tout un monde et tout un tourbillon de sens politiques, subtilement et sans tintamarre, à partir d’une image, d’une date ou de leur résonance potentiellement diabolique. L’acte final de la conférence de Berlin, le 28 février 1885, la barbe foisonnante de Léopold II, un Congolais aux mains coupées : c’est l’atrocité de la colonisation en Afrique, de son cortège d’horreurs habillé de missions civilisatrices, avec « Congo » (2012). La mort du maréchal Alfred von Schlieffen, le 4 janvier 1913, un vieillard de quatre vingts ans couvert de décorations chamarrées, un plan d’une logique inexorable : c’est toute la marche forcenée à la guerre mondiale en résolution des poussées conflictuelles ou revanchardes des impérialismes en présence, avec « La bataille d’Occident » (2012). 1885, c’était aussi l’entrée du vieux chef amérindien Sitting Bull, sorti de sa prison pour l’occasion, dans le Wild West Show de Buffalo Bill, et l’avènement du divertissement industriel et du spectaculaire marchand au devenir si dominateur, avec « Tristesse de la Terre » (2014). Une forteresse fatiguée en plein centre d’une capitale, servant de prison d’État, une foule hétéroclite qui prend soudainement conscience d’elle-même en tant que foule : c’est la naissance du creuset fondamental de l’imaginaire révolutionnaire, et un jour de 1789 qui deviendra mondialement célèbre, avec « 14 juillet » (2016).
Hitler avec Hjalmar Schacht
Ils écoutèrent. Le fond du propos se résumait à ceci : il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d’être un Führer dans son entreprise. Le discours dura une demi-heure. Lorsqu’Hitler eut terminé, Gustav se leva, fit un pas en avant et, au nom de tous les invités présents, il le remercia d’avoir enfin clarifié la situation politique. Le chancelier fit un rapide tour de piste avant de repartir. On le congratula, on se montra courtois. Les vieux industriels paraissaient soulagés. Une fois qu’il se fut retiré, Goering prit la parole, reformulant énergiquement quelques idées, puis il évoqua de nouveau les élections du 5 mars. C’était là une occasion unique de sortir de l’impasse où l’on se trouvait. Mais pour faire campagne, il fallait de l’argent ; or, le parti nazi n’avait plus un sou vaillant et la campagne électorale approchait. À cet instant, Hjalmar Schacht se leva, sourit à l’assemblée, et lança : « Et maintenant, messieurs, à la caisse ! »
Cette invite, certes un peu cavalière, n’avait rien de bien nouveau pour ces hommes ; ils étaient coutumiers des pots-de-vin et des dessous-de-table. La corruption est un poste incompressible du budget des grandes entreprises, cela porte plusieurs noms, lobbying, étrennes, financement des partis. La majorité des invités versa donc aussitôt quelques centaines de milliers de marks, Gustav Krupp fit don d’un million, Georg von Schnitzler de quatre cent mille, et l’on récolta ainsi une somme rondelette. Cette réunion du 20 février 1933, dans laquelle on pourrait voir un moment unique de l’histoire patronale, une compromission inouïe avec les nazis, n’est rien d’autre pour les Krupp, les Opel, les Siemens, qu’un épisode assez ordinaire de la vie des affaires, une banale levée de fonds. Tous survivront au régime et financeront à l’avenir bien des partis à proportion de leur performance.
Lord Halifax et Hermann Goering (novembre 1937)
À cette date méconnue du 20 février 1933 et à cette galerie de puissants industriels et financiers (dont l’héritage perdurera en effet presque intact après la catastrophe – et dont l’aura maligne irriguera longtemps après les faits un certain esprit du miracle allemand et certains anticorps tels la Rote Armee Fraktion, comme nous le rappelle par exemple le puissant « Si les bouches se ferment » d’Alban Lefranc), Éric Vuillard ajoute deux autres moments emblématiques, deux bonnes doses de liquides révélateur et fixateur offertes à l’histoire. Avant même Munich, ce sera le 20 novembre 1937 une visite privée de Lord Halifax à Hermann Goering, et la connivence capitulatrice par anticipation d’une diplomatie patricienne européenne amatrice de bons vins et de mets fins, de chasses et d’entre-soi. Avant même la Pologne ou la Tchécoslovaquie, ce sera le 12 février 1938 et la convocation du chancelier autrichien Schuschnigg à Berchtesgaden, pour qu’Hitler et Von Papen lui signifient l’ultimatum menant à l’Anschluss.
Un penchant obscur nous a livrés à l’ennemi, passifs et remplis de crainte. Depuis, nos livres d’Histoire ressassent l’événement effrayant, où la fulgurance et la raison auraient été d’accord. Ainsi, une fois que le haut clergé de l’industrie et de la banque eut été converti, puis les opposants réduits au silence, les seuls adversaires sérieux du régime furent les puissances étrangères. Le ton monta à mesure avec la France et l’Angleterre, en un mélange de coups de force et de bonnes paroles. Et c’est ainsi qu’en novembre 1937, entre deux mouvements d’humeur, après quelques protestations de pure forme à propos de l’annexion de la Sarre, de la remilitarisation de la Rhénanie ou du bombardement de Guernica par la légion Condor, Halifax, lord président du Conseil, se rendit en Allemagne, à titre personnel, à l’invitation d’Hermann Goering, ministre de l’Air, commandant en chef de la Luftwaffe, ministre du Reich à la forêt et à la chasse, président du défunt Reichstag – le créateur de la Gestapo. Voilà qui fait beaucoup, et pourtant Halifax ne tique pas, il ne lui semble pas bizarre, ce type lyrique et truculent, antisémite notoire, bardé de décorations. Et on ne peut pas dire qu’Halifax a été entourloupé par quelqu’un qui cachait son jeu, qu’il n’a pas remarqué les tenues de dandy, les titres à n’en plus finir, la rhétorique délirante, ténébreuse, la silhouette entripaillée ; non. À cette époque, on était très loin de la réunion du 20 février, les nazis avaient abandonné toute retenue.
Schuschnigg convoqué par Hitler à Berchtesgaden (12 février 1938)
En se déplaçant avec finesse dans les méandres des intérêts capitalistes bien compris, des connivences paradoxales et des veuleries ordinaires, Éric Vuillard manie une langue désormais familière, dans laquelle le sens du détail et de la juxtaposition acérée secrète une ironie glaciale et permanente, vertigineuse lecture de ces moments qui créent du sens invisible, qui historicisent subtilement les décors et leurs envers, les évidences et les ressorts plus discrets de ce qui se fit, de ce qui se fait sans doute, de ce qui se fera peut-être. Jusque dans les démythifications instantanées de fausses vérités tenaces (et auprès de publics pourtant tenus pour avertis le plus souvent), tels celui de l’efficacité de la Wehrmacht, presque paralysée en entrant en Autriche par une logistique carburant défaillante (grain de sable qui en annonce bien d’autres du même calibre durant le conflit mondial qui se profile alors), Éric Vuillard réalise une nouvelle prouesse de cette littérature décapante, glaçante et impressionnante, qui informe l’Histoire de toute sa puissance.
Et d’heure en heure, Goering dicte son ordre du jour. Pas à pas. Et dans la brièveté des répliques, on entend le ton impérieux, le mépris. Le côté mafieux de cette affaire saute soudain aux yeux. À peine vingt minutes après la scène que nous venons de lire, Seyss-Inquart rappelle. Goering lui ordonne de retourner voir Miklas et de bien lui faire comprendre que s’il ne le nomme pas chancelier avant dix-neuf heures trente une invasion peut fondre sur l’Autriche. On est bien loin de la gentille conversation entre Goering et Ribbentrop à l’intention des espions anglais, bien loin des libérateurs de l’Autriche. Mais une chose encore doit retenir l’attention : c’est l’expression qu’emploie Goering, cette menace de fondre sur l’Autriche. On lui colle aussitôt des images terrifiantes. Mais il faut rembobiner le fil pour bien comprendre, il faut oublier ce que l’on croit savoir, il faut oublier la guerre, il faut se défaire des actualités de l’époque, des montages de Goebbels, de toute sa propagande. Il faut se souvenir qu’à cet instant la Blitzkrieg n’est rien. Elle n’est qu’un embouteillage de panzers. Elle n’est qu’une gigantesque panne de moteur sur les nationales autrichiennes, elle n’est rien d’autre que la fureur des hommes, un mot venu plus tard comme un coup de poker. Et ce qui étonne dans cette guerre, c’est la réussite inouïe du culot, dont on doit retenir une chose : le monde cède au bluff. Même le monde le plus sérieux, le plus rigide, même le vieil ordre, s’il ne cède jamais à l’exigence de justice, s’il ne plie jamais devant le peuple qui s’insurge, plie devant le bluff.
Eric Vuillard
Eric Vuillard - l'Ordre du jour - éditions Actes Sud
Charybde2 le 4/05/17
l'acheter ici