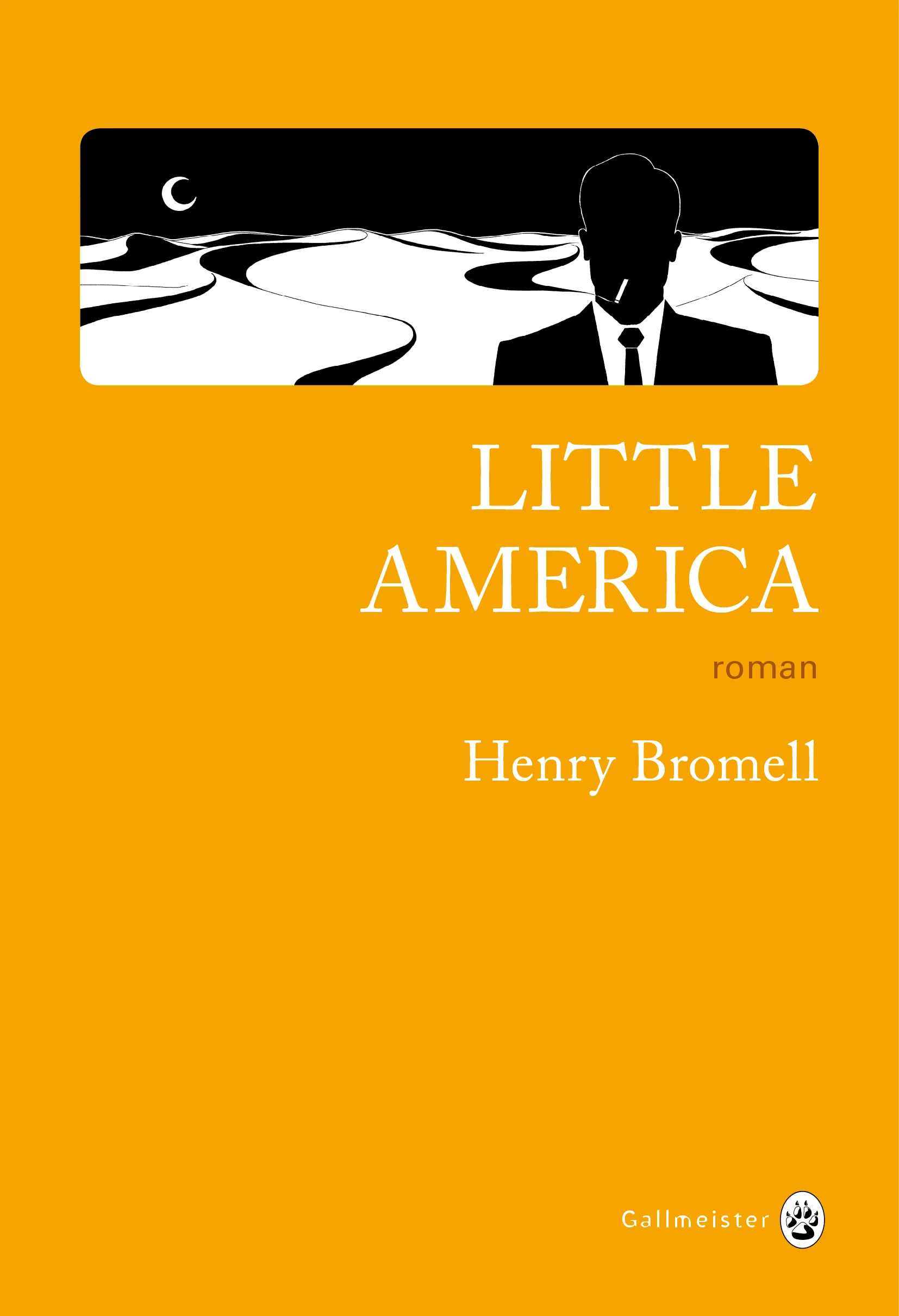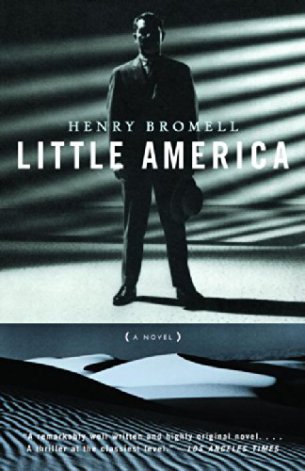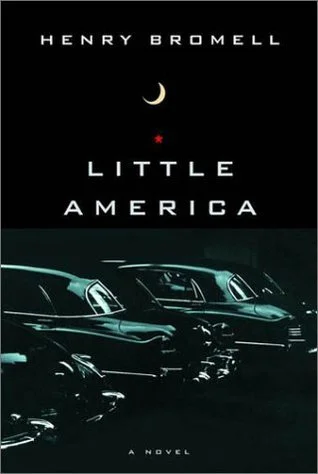Henry Bromell auteur marquant, avant le ratage du scénario d'Homeland
Espionnage au Moyen-Orient en 1958, dans les yeux acérés d’une enfance qui se cherche de nos jours. Très impressionnant.
Un samedi matin de l’été 1957, presque cinq mois avant les événements en question, la porte d’entrée d’une modeste maison en stuc à un étage de P Street, dans le quartier de Georgetown à Washington DC, s’ouvrit en grand, et je sortis avec mon père et ma mère. À l’époque, j’avais dix ans et je bichonnais ma coiffure gominée. Nous étions revenus de Syrie depuis trois ans et, cinq mois plus tard, nous serions installés au Korach, le sujet de cette histoire. Mon père était espion, ou, comme il préfère qu’on s’en souvienne, officier de renseignement à la CIA, de 1950 à 1978. Il avait été recruté alors qu’il travaillait pour une société d’investissement de Wall Street.
Il détestait Wall Street, mais en tant que WASP occupant une position sociale élevée, il ne pouvait exprimer sa haine que de façon indirecte ou involontaire. Le cou coincé, de profil, raide et le regard fixe, il effectuait chaque jour l’aller-retour en train de banlieue entre Grand Central Station et Hastings-on-Hudson. Nous vivions là – mon père, ma mère, moi et un cocker appelé Winston – dans une maison en location de Clinton Street. Je ne dirais pas que mon père, une fois entré à la CIA, devint un homme heureux ; la mélancolie est, je m’en aperçois aujourd’hui, profondément ancrée dans les gènes de ma famille. Je dirais plutôt qu’il passa d’une forme d’anxiété à une autre. Son cou ne se coinçait plus, mais les sécrétions acides dues au recueil de renseignements finirent par provoquer un trou assez conséquent dans son estomac et les saignements faillirent le tuer.
Lui-même fils d’un officier de renseignements américain ayant longtemps travaillé au Moyen-Orient, le scénariste, producteur et romancier Henry Bromell écrit « Little America » en 2002, presque trente ans après son premier roman, « The Slightest Distance » (1974), en ayant toutefois publié deux recueils de nouvelles, pendant qu’il se consacrait essentiellement aux séries « Northern Exposure », « Homicide », « Chicago Hope », « Carnivale » ou encore « Rubicon ». Dans un entretien d’époque, il indiquait avoir mûri pendant près de quinze ans cet étonnant roman, mêlant avec une acuité impressionnante une vision « depuis l’intérieur » de la communauté américaine du renseignement issue de la deuxième guerre mondiale, une mise en perspective fine et contrastée des enjeux géopolitiques du Moyen-Orient des années 1960 (et de leur longue traîne jusqu’à nos jours) et une quête du passé par les yeux d’un enfant devenu adulte tentant, in fine, de comprendre peut-être son père.
Nous jouions à un jeu.
Le jeu s’appelait Espion.
Mon père et moi étions un agent et son officier traitant. Il devait me faire passer un message. Ma mère appartenait au contre-espionnage. Si elle nous attrapait en train de nous passer la missive, elle gagnait. Sinon, on gagnait. On gagnait toujours. Mon père gagnait toujours. Même dans cette version imaginaire de sa vie, il se devait de gagner. Avec le recul, je comprends que ma mère devait régulièrement endosser le rôle d’une sorte de souffre-douleur et perdre, encore et encore, face à mon père. Mais il est possible que ce jeu, auquel nous jouions le week-end depuis mes sept ans, ait aidé ma mère à se préparer pour ce mois de décembre 1958, quand mon père fut rappelé à Washington pour consultation et la laissa, à la grande consternation de tous les protagonistes, à la tête de la station d’Hamra.
1958 : le fictif royaume du Korach, au point d’intersection désertique de l’Irak, de la Syrie et de la Jordanie inquiète l’administration Eisenhower, en pleine mise en place du containment face aux succès politiques et militaires du communisme, à travers les figures historiques du secrétaire d’État John Foster Dulles et de son frère cadet Allen Dulles, directeur de la CIA. Après l’assassinat du souverain hachémite (et donc cousin distant du roi Fayçal d’Irak comme du roi Hussein de Jordanie) régnant, c’est son fils de vingt-deux ans, rentré dare-dare de son pensionnat britannique, qui se trouve propulsé à la tête de ce territoire en apparence insignifiant, mais riche peut-être d’enjeux stratégiques, alors que le conflit israélo-arabe de 1956 a laissé l’Égyptien Nasser, hostile aux puissances occidentales, maître du canal de Suez, et que le parti socialiste Baas, dangereusement proche de l’Union Soviétique, vient de prendre le pouvoir en Syrie, et ce alors même que les Britanniques, traditionnels protecteurs de la région, ont désormais entamé leur repli définitif. La CIA dépêche donc sur place un jeune officier prometteur, à charge pour lui de gagner la confiance du jeune roi et de s’assurer que sa politique sera nettement pro-occidentale.
La nuit quand il dort, je consulte mes livres et les quelques centaines de fiches que j’ai rassemblées, sur lesquelles sont griffonnées les miettes d’informations glanées dans les centaines de livres et de documents que j’ai lus et laissés dans la bibliothèque de l’UCLA. Je déroule aussi le grand rouleau de papier blanc épais sur lequel je construis ma chronologie des événements de 1958 au Korach, mon graphique des allées et venues des principaux protagonistes, un schéma de CE QUI S’EST RÉELLEMENT PASSÉ, D’APRÈS MOI, sur lequel j’ai la ferme intention de relier tous les points, puis de prendre sans crainte de la distance pour voir ce que j’ai obtenu. Le dernier indice déterminant découvert, le message chiffré déchiffré, le mystère résolu. La vérité. Même si je persiste à croire qu’une telle chose n’existe pas.
« Little America », c’est le surnom donné localement, par leurs habitants eux-mêmes, à ces enclaves américaines abritant le personnel et les familles de l’ambassade et des différents programmes d’assistance ou de coopération développés à partir de 1950 en direction de pays « du Tiers Monde » (en tout cas de ceux stratégiquement positionnés dans la lutte contre le communisme), reproduisant la plupart des éléments-clé, pratiques et symboliques, d’une petite ville américaine, même sur une surface extrêmement réduite, et même, comme au Korach, en plein milieu du désert. Henry Bromell, essentiellement à travers les souvenirs du narrateur qui y vécut enfant, nous en offre un portrait incident et saisissant qui, croisé avec les dossiers d’archives (désormais « ouvertes ») que parcourt le même enfant devenu historien professionnel, évoque avec puissance et intimité l’univers secret qui succède à celui de Graham Greene, version américaine de l’Oxbridge feutré et pervers de John Le Carré, version sur le terrain de l’ « État profond » des États-Unis à travers le renseignement, tel qu’on le trouvera ausculté, bien différemment, dans « La Compagnie » (2003) de Robert Littell, et mis en scène, déroutant et poignant, dans le grand « La femme qui avait perdu son âme » (2013) de Robert Shacochis. La puissance documentaire du roman, spectaculaire, ne le cède toutefois en rien à la profonde ruse de l’intrigue, digne des plus paranoïaques espionnites aiguës, ni à la justesse de la quête autorisée par le scénario du fils adulte cherchant à savoir ce qui s’est passé à propos du rôle ancien de son père, toujours lié par le secret.
Ils allèrent au village le plus proche pour déjeuner, la Chevy était cuisante. Ils s’assirent à une simple table en bois sous une treille, se firent servir de l’agneau et du riz par un petit garçon solennel. Hussein mangea à la cuisine. Ma mère l’entendait parler doucement avec la mère du garçon, qui cuisinait. Ma mère et Kumait ne dirent pas grand-chose. Ils étaient tous deux fatigués et ma mère avait mal à la tête. De gros oiseaux noirs qui ressemblaient à des buses tournaient paresseusement au-dessus d’eux, portés par des courants ascendants provoqués par la chaleur du désert. Au loin, une colonne de poussière s’éleva de la route. Kumait étudiait ma mère, se demandant quel degré d’exposition à l’histoire elle pouvait supporter en une seule journée. Les Américains n’étaient pas aussi solides que les Britanniques, spéculait Kumait, et acceptaient avec moins d’enthousiasme de devoir affecter un certain mimétisme. Ces Américains avaient quelque chose de vulnérable, et cependant, ou peut-être pour cette raison même, quelque chose de dangereux aussi, quelque chose qu’il n’arrivait pas à comprendre, et qui l’effrayait, comme le souffle mortel et espiègle d’un très grand enfant gâté.
Même s’il surjoue peut-être un peu les éléments profondément humains de ce drame à multiples étages (mais je ne vois pas de raison de bouder ici ce pur plaisir), « Little America » frappera la lectrice ou le lecteur par la finesse de sa compréhension géopolitique (comme c’était d’ailleurs le cas, issu d’une source pas si différente en réalité, du quatrième et dernier tome de l’indispensable « Quatuor de Jérusalem » d’Edward Whittemore), fût-ce en détournant pour l’essentiel au profit d’une nation bédouine fictive le contexte tout à fait réel de la Jordanie du roi Hussein, de son équilibrisme délicat et bien longtemps fort réussi entre l’alignement sur l’ancienne puissance coloniale britannique et le nouvel homme fort américain, la prudence relative vis-à-vis d’Israël, la complexe relation avec les monarchies pétrolières, et le pas de danse sophistiqué avec le pan-arabisme de Damas et Le Caire. Nul besoin – et n’en déplaise au bandeau promotionnel des par ailleurs excellentes éditions Gallmeister (qui publient en ce début 2017 la traduction française de Janique Jouin-de Laurens) – d’aller chercher chez Henry Bromell le tardif scénariste de la série « Homeland » (que je trouve personnellement fort médiocre, caricaturale et devant plutôt ses quelques mérites à la formidable et subtile série israélienne dont elle est le remake, « Hatufim ») pour être saisi d’admiration devant la capacité de « Little America » à s’imprégner d’une profonde et rare compréhension culturelle, historique et stratégique de cette zone désertique pourtant située à nouveau au cœur de bien des enjeux contemporains – et à le faire avec un exceptionnel mélange d’humour noir et de nostalgie.
En observant de plus près, j’ai remarqué que beaucoup des soldats de plomb et des véhicules en métal étaient cabossés ou entaillés à cause des guerres sur le sol des chambres de nos maisons au Korach. Il manquait un œil à un fantassin de la Première Guerre mondiale, un bras à un tireur embusqué écossais, leurs chevaux à quelques membres de la cavalerie confédérée. Soudain, l’innocence a semblé avoir une vie intérieure plus sombre. Ces jouets muets étaient les vétérans de notre enfance, les survivants, mutilés, blessés et à moitié morts, enterrés pour toujours dans leurs souvenirs de douleur, de boue et de tonnerre, d’acier et d’obus hurlants. J’ai revu l’armée korachite vers 1958, qui conduisait toujours des chars britanniques, identiques si ce n’était par la taille au gros Centurion solide que je tenais maintenant dans ma main, les mêmes Hawker Hunter volant au-dessus de nos têtes, aussi petits, vus de là, que ces jouets, ce semblant d’armée de l’air. Une armée de jouets, une armée de l’air de jouets, commandée par un roi jouet. Tout ça pour amuser les enfants de l’empire, les enfants de Little America. Nous.
Henry Bromell
Henry Bromell - Little America - éditions Gallmeister
coup de cœur de Charybde2 le 18/04/17
L'acheter ici