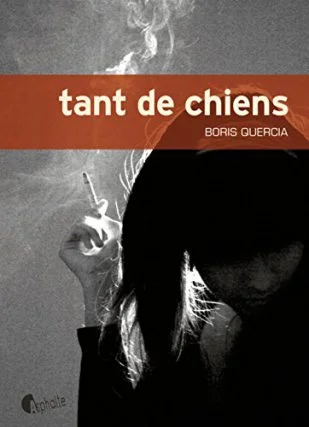Vie de chi(li)en plombée : un polar saignant de Boris Quercia
Où l'on retrouve le vaillant Santiago Quiñones dans l'ultra-violence chilienne. Du polar saignant, et saigné à blanc en altitude. Si la vie au-delà du périphérique parisien vous semble effrayante, essayez Santiago du Chili. Le 9-3 et le 9-5 vous seront ensuite comme une visite à Disneyland…
Écrit en 2015, traduit la même année chez Asphalte par Isabel Siklodi (sa version originale espagnole est à paraître début 2017), le deuxième roman de Boris Quercia met en scène, comme « Les rues de Santiago » précédemment, l’infiniment dur-à-cuire policier chilien Santiago Quiñones.
"Plusieurs pistolets-mitrailleurs nous tirent dessus et les balles ricochent de partout, je suis planqué dans un cagibi où sont entreposées des bouteilles de gaz et les balles me sifflent aux oreilles.
Depuis le début je ne le sentais pas. Je devrais être de permanence au bureau, pas dans ce trou à rats qui va exploser d’un moment à l’autre.
Jiménez est à deux mètres de là, une balle lui a traversé la cuisse et il se tord par terre. Du dehors, on lui crie de ne pas bouger mais Jiménez est fou de douleur.
On est dans la cour d’une maison de San Luis, à Quilicura. Dès qu’on a défoncé la porte, on a été surpris par les rafales ; il n’y a que Jiménez et moi qui avons pu entrer. Comme il est passé le premier, son corps m’a servi de bouclier. Je n’ai pas eu d’autre choix que de me jeter dans cet abri, mais si une balle touche une bonbonne, je vais être réduit en bouillie.
Jiménez crie de nouveau, fou de douleur, un autre projectile l’a atteint malgré son gilet pare-balles et on dirait qu’il a une côte cassée. Je ne peux pas bouger d’un millimètre, je ne peux même pas lever le bras pour viser sans risquer qu’on me fasse sauter un doigt, j’ai la tête collée contre le mur et mon casque est sur le point de tomber. Du fond de la maison, les types du gang lâchent les chiens. Des rottweilers, des diables noirs qui bavent et grognent férocement.
Ils se précipitent sur Jiménez, droit à la gorge. Je le vois se défendre en essayant de leur donner des baffes. Moi, ils ne m’ont pas vu. J’essaie de viser l’un des chiens qui l’attaquent, mais je ne tire pas, j’ai peur de toucher Jiménez. Les collègues, depuis l’extérieur, lancent des bombes lacrymogènes, l’air devient irrespirable. La fusillade s’arrête, j’en profite pour me jeter au sol et m’extirper de ma cachette. J’attrape Jiménez par une jambe pour le traîner vers la porte. Les chiens disparaissent, sauf un qui ne veut pas le lâcher et lui mord rageusement l’avant-bras. Je colle mon arme sur la poitrine de la bête et je lui mets deux balles. Malgré ça, il n’abandonne toujours pas. On dirait un vrai démon, ce chien, la fumée lui sort par le museau à cause des coups de feu tirés à bout portant."
En tombant sous les balles d’un gang, Jiménez lègue à son collègue désenchanté Santiago, toujours amoureux de sa Marina, mais toujours autant au bord de différents gouffres, un paquet plus ou moins bien bien ficelé d’indices, d’ennuis et de contacts, allant d’une enquête en cours des Affaires Internes à une jeune prostituée en fuite, ou d’une secrétaire aux archives fort dévouée à un prêcheur ex-avocat. Mis en mouvement sans doute davantage par l’impulsion et la rage que par la saine réflexion, le policier courageux et parfois inconscient met les deux pieds dans un imbroglio dont le Chili contemporain n’a certainement pas le monopole, mais où la proximité des réseaux de pouvoir et d’argent, et les ombres mal réglées de la dictature, favorisent peut-être encore plus qu’ailleurs le sentiment d’impunité des avides et des puissants, quelles que soient leurs abjections.
Je sens à chaque pas le pistolet se balancer doucement dans mon holster sous mon bras. Ce simple objet est pour moi comme le destin. Le ranger dans son étui tous les matins est un appel au malheur. À un moment donné, il faut bien dégainer. Enlever la sécurité, appuyer sur la détente, et après tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne vois plus que de la cervelle éparpillée autour de toi.
Quand je pense que Yesenia était la petite fille qui s’asseyait sur le pas de la porte des voisins.
Avec ce deuxième roman, encore plus brutal et encore plus attachant que le premier, Boris Quercia confirme que s’il est un cinéaste – et même un acteur – remarquable, il compte désormais aussi sans aucun doute parmi les auteurs sud-américains capables de porter haut, aux côtés par exemple du Brésilien Edyr Augusto ou de l’Argentin Leonardo Oyola, avec un humour intérieur à la fois désenchanté et presque secret, le sentiment de révolte instinctive d’hommes désabusés, qui, presque littéralement n’en peuvent plus, mais croient encore, en certaines circonstances, à une certaine justice et à leur métier, malgré des sociétés concentrant les maux de l’extrême inégalité, de l’avidité sans bornes et de la corruption fort solide. Et c’est ainsi que la meilleure tradition du hard-boiled abrupt, sans fioritures et sans concessions, pétri de réalité sociale et de cynisme obligé, se perpétue et se renouvelle encore.
Ce qu’en dit le blog Encore du Noir est ici, ce qu’en dit Tara Lennart sur Bookalicious est là, et ce qu’en dit le blog Unwalkers est là-bas.
Tant de chiens de Boris Quercia aux éditions Asphalte
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.