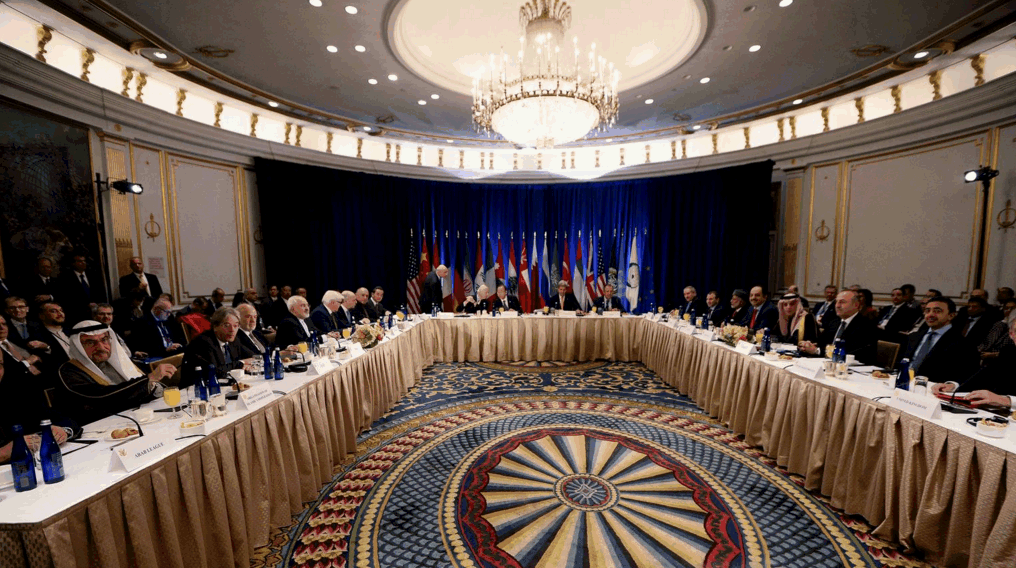Syrie : qui veut quoi dans les négociations ?
Longtemps les Saoudiens se sont opposés à la participation de l’Iran sur les négociations tant que Téhéran fera du maintien de Bachar al-Assad un préliminaire absolu. La position iranienne est plus nuancée qu’on ne le pense. Comme les Russes, c’est moins la personne du président syrien qu’il s’agit de conserver à tout prix, mais c’est davantage la pérennité d’un Etat unitaire où des éléments ‘présentables’ du régime de Damas figureraient. Il s’agit d’éviter la répétition de l’expérience irakienne. Sur ce point, on peut estimer que les positions iraniennes et américaines pourraient se rapprocher même si les propos publics sont plus rigides. Plusieurs facteurs ont considérablement changé la donne. Le premier, le plus évident, est l’intervention militaire russe particulièrement massive, par des bombardements qui frappent de façon indifférenciée tous les opposants armés au régime syrien, voire des hôpitaux et cibles civiles. Il reste qu’en dépit d’un débat sur l’efficacité de ces bombardements, ceux-ci ont fragilisé les troupes de Daech et constituent sur le terrain un « game changer » tout comme l’appui militaire américain à des groupes kurdes. Un autre facteur, moins signalé, nous semble peser sur l’attitude iranienne. L’appareil militaire iranien, tout comme le Hezbollah, enregistre des pertes de plus en plus visibles, comme l’atteste la publicité des obsèques de « martyrs ». Les coûts humains (politiques et financiers), de ce front (comme de l’engagement en Irak) commencent à peser lourd sur un outil militaire beaucoup plus fatigué qu’on ne le pense généralement. L’alliance syro-iranienne se perpétue sur la base d’objectifs communs mais au bout du compte, limités : une posture défensive contre des adversaires et des craintes partagés : les deux pays veulent éviter à tout prix que le pays ne devienne (sous couvert d’une majorité sunnite que Téhéran ne conteste pas) un nouveau pôle wahhabite du fait de l’influence saoudienne. Ils veulent aussi se prémunir des « menaces » israéliennes. Mais Téhéran redoute justement que l’effondrement de Damas ne prive le Hezbollah de ses approvisionnements en armes fournies par la République islamique et qui transitent par la Syrie. Le discours de Riyad articulé autour de la dénonciation d’une pseudo-solidarité chiite-alaouite dissimule les véritables enjeux stratégiques (1). Les appétits de revanche saoudiens sur un Bachar al-Assad qui avait publiquement humilié le royaume (mais aussi le Qatar et la Turquie) en confisquant à son profit une ‘médiation’ destinée à stabiliser l’exécutif libanais, sont très présents dans les esprits, même si analystes et media occidentaux paraissent avoir oublié cet épisode.
Rencontre entre le médiateur de l'ONU et l'opposition syrienne du Haut comité de négociations (HNC) à Genève. Photo ONU/Jean-Marc Ferré
Les Saoudiens soutiennent toujours officiellement les opposants à Bachar al-Assad au sujet desquels la frontière entre différentes catégories d’islamistes est assez difficile à tracer. L’intervention russe a bousculé toutes les stratégies, y compris iraniennes (la faiblesse de l’appareil militaire iranien imposait à Téhéran le recours à une stratégie de ‘résistance’ passant par l’appui à des forces de type milice, loin des règles d’engagement classique, qui ont trouvé leurs limites, comme le montre le redéploiement d’une partie du contingent iranien hors de Syrie confirmé par John Kerry au Congrès (2). Ce faisant, comme le note un observateur avisé, Moscou a montré qu’au-delà du champ de bataille syro-irakien, la Russie défend plus largement ses intérêts au Moyen-Orient face à Washington, et même à Riyad dans un contexte énergétique tendu (3). Le même analyste relève justement que l’Arabie saoudite a fait de même en annonçant le 4 février son intention d’envoyer des troupes au sol en Syrie : le brigadier-général Ahmed al-Asiri, porte-parole des forces armées saoudiennes, a déclaré : « Le royaume est prêt à participer à toute opération au sol que la coalition (contre Isis) pourrait décider en Syrie. » Par ailleurs, « selon des sources militaires, des milliers d’éléments des forces spéciales pourraient être déployées, probablement en coordination avec la Turquie » (4). Le général Asiri aurait laissé entendre que des contingents saoudiens pourraient être retirés du front yéménite en raison de « progrès » sur le terrain pour être déployés en Syrie pour combattre Daech. Ceci pour répondre aux critiques, y compris américaines (5) croissantes contre le fait que l’Arabie saoudite ne se bat pas contre Daech et ses alliés en Syrie. Cette annonce a suscité un certain scepticisme chez les observateurs qui doutent des capacités opérationnelles de l’armée saoudienne au vu des engagements sur le front yéménite (6). On notera qu’Adel al-Jubeir, ministre saoudien des Affaires étrangères, a décrit, le 8 février, à l’issue d’une rencontre avec John Kerry, ce projet comme s’insérant dans une coalition sous direction américaine (7). Sans surprise, cette annonce (provocatrice) a généré à la fois des critiques virulents et des sarcasmes en Iran et en Syrie. Walid Moallem, ministre syrien des Affaires étrangères, s’exclame : « Ceux qui lanceront une agression contre la Syrie s’en retourneront dans des caisses en bois, qu’ils soient Saoudiens, Turcs ou autres » (8). Ali Jafari, commandant des Gardiens de la Révolution, a qualifié le projet de « suicidaire ». D’autres responsables militaires mettent en avant la faiblesse et l’impréparation de l’armée saoudienne, et mettent en garde contre tout engagement contre des troupes iraniennes, qui pourrait déclencher un véritable conflit armé entre les deux pays. Ils prévoient qu’en pareil cas la monarchie s’effondrerait (un cadeau pour l’Iran et l’Irak) sans exclure, selon eux, la possibilité que des personnels de l’armée saoudienne, au contact des islamistes, ne rejoignent ces derniers (9). Ces propos martiaux alternant avec des moqueries sont-ils basés seulement sur un calcul stratégique ou sont-ils le moyen d’exorciser l’inquiétude des chefs militaires iraniens ? Les analystes iraniens sont assez partagés : les uns estiment que ce n’est qu’un bluff politique, d’autres se basant sur le processus de décision très personnel en cours à Riyad, n’excluent pas une initiative individuelle impulsive. D’aucuns, enfin, y voient le moyen d’exorciser des problèmes internes (10). Certains analystes saoudiens (11) louent l’initiative du royaume comme un moyen de véritablement déclarer la guerre à ISIS/Daech (on se demande bien comment) et surtout de mettre l’Amérique au pied du mur (ce qui n’est peut-être pas faux). Devant les incertitudes de ce projet hasardeux, Saoudiens et Turcs laissent paraître un peu de flottement en semblant s’en remettre à Washington (12). L’enjeu de l’annonce dépasse de loin le seul théâtre syrien, le royaume veut afficher en cela son leadership sur toute la communauté sunnite dont il serait le catalyseur pour sa défense face au « péril terroriste » (ISIS/Daech), mais plus probablement face à la concurrence régionale iranienne. Les Russes ont condamné vigoureusement toute présence de troupes saoudiennes en Syrie, assimilée (comme pour les Iraniens) à une déclaration de guerre, ce qui contraste avec la (prudente, vague et fort peu enthousiaste) approbation américaine.
Dans ce contexte, il n’est pas inutile de souligner dans le cadre de la redistribution des cartes régionales que la Turquie a renforcé son axe avec l’Arabie saoudite (13). A l’occasion de la visite de l’importante délégation turque (le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu était notamment entouré de Mevlet Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères, Mustafa Elitas, ministre de l’Economie, Efkan Ala, ministre de l’Intérieur, Ismet Yilmaz, ministre de la Défense, Binali Yildirim, ministre des Transports, et le général Hulusi Akar, chef d’Etat-Major des armées) reçue par le roi Salman le 31 janvier, les deux pays ont annoncé la création d’un Conseil de Coopération Stratégique pour coordonner leurs actions et intérêts économiques, politiques, militaires, en matière de sécurité, d’éducation, de santé. Ils ont dans ce cadre entamé des discussions de coopération militaire (14) principalement en direction de la Syrie (15). L’éclat donné au renforcement des liens turco-saoudiens ne vise pas seulement ou prioritairement une alliance contre le péril islamiste. Il est destiné à offrir aux Turcs des cartes de rechange au vu de la dégradation visible des relations d’Ankara et de Moscou tant à propos du gaz que des postures respectives dans les conflits régionaux (incidents aériens lors de survols russes de l’espace aérien turc, appui russe au régime de Damas (16) et à l’Iran, pilonnage russe d’islamistes éventuellement protégés par les turcs qui ciblent plutôt les kurdes….). Ankara, se sentant isolé de la Russie, en posture de défi par rapport à l’Iran (en dépit d’une nécessaire relation de coopération obligée (17) sur le gaz et la Caspienne), en crise économique, cherche une alliance de revers avec Riyad. La Turquie, en plein malaise, n’a d’ailleurs pas d’autre choix que de tenter par ailleurs un rapprochement avec Israël et de tourner la page de la brouille née avec la triste expédition maritime vers Gaza. Tout ceci ne fait pas l’affaire de l’Iran mais l’axe turco-saoudien présente un aspect si visiblement opportuniste que sa survie à long terme n’est pas assurée (18) tant que perdure l’aveuglement stratégique des dirigeants des deux pays condamnés à l’improvisation, faute de vision. En appuyant ce qui ressemble à une coalition « sunnite » dirigée plus contre l’Iran que contre Daech, Obama s’enferme dans une dangereuse impasse s’il amplifie son appui à une coalition aux buts hétéroclites (par exemple l’obsession anti-kurde de la Turquie prévaut sur toute éradication des islamistes) dont l’action militaire, comme on le voit dans la disparité des cibles des bombardements, est dépourvue de cohérence (19). Percevant les limites de l’axe turco-saoudien, les dirigeants turcs ont amorcé une prudente conciliation avec Téhéran focalisée sur les enjeux économiques (gaz, échanges commerciaux), par une visite en Iran du Premier ministre Ahmet Davutoglu le 4 mars, suivie d’un déplacement du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, à Ankara le 19 mars. A cette occasion, les deux pays ont tenté d’améliorer le climat politique de leur dialogue et de rapprocher leurs points de vue sur la Syrie et les crises régionales.
Les risques de périlleux dérapages que comporte cette bien incertaine entreprise ont lourdement poussé Barack Obama à peser sur les principaux protagonistes pour parvenir aussi vite que possible à un cessez-le-feu très provisoire à caractère humanitaire (pour faciliter les secours aux populations civiles assiégées). Le 22 février, une concertation accélérée entre Washington et Moscou dans le cadre de l’« International Syria Support Group » (ISSG), après que des conversations préalables aient été lancées par l’envoyé spécial de l’Onu, Staffan de Mistura, permet le début d’un cessez-le-feu le 27 février. ISIS (Daech) et Jabhat al-Nusra sont exclus de cette « cessation d’hostilités ». La Russie est chargée de s’assurer du respect de cet engagement par Damas, l’Amérique devrait faire du même pour ce qui est des opposants au régime syrien. L’accord doit son émergence aux intenses contacts personnels entre Obama et Poutine, Kerry et Lavrov. Ce cessez-le-feu, en dépit de toutes les inquiétudes, semble globalement respecté les premiers jours de son entrée en vigueur, en dépit de la fragmentation des groupes concernés et de l’imprévisibilité des comportements (20). Au-delà de son caractère humanitaire, cette étape doit être comprise comme devant permettre des négociations immédiates en vue d’un cessez-le-feu permanent. Elles débutent le 1er mars pour reprendre le 9 mars en vue de rendez-vous successifs. Washington constate avec satisfaction que Moscou assure sa part dans la manoeuvre, en pressant Téhéran de ne pas commettre d’écart compromettant leur succès. Kerry a rassuré les Russes en démentant l’existence d’un « plan B » (partition de la Syrie), issue nullement souhaitée mais redoutée en cas d’échec diplomatique (21). Il reste que ce gel des hostilités est éminemment fragile et peut voler en éclats n’importe quand. Dans l’esprit du duo américano-russe, comme dans celui de Staffan de Mistura et Ban Ki Moon, le secrétaire général des Nations unies, cette trêve, si elle survit, doit permettre de lancer au plus vite de nouvelles négociations sur l’avenir politique de la Syrie. Un autre défi de taille. Paradoxalement, les multiples tensions régionales pourraient engendrer une lassitude chez les principaux acteurs, de nature à favoriser la recherche de compromis politiques. Les effroyables dévastations, les désastres humanitaires, les flots de réfugiés dont l’impact affecte désormais plusieurs continents, sont une incitation à faire preuve d’imagination devant l’urgence de solutions. L’ampleur des répercussions délétères au-delà de la région justifie une mobilisation. En outre, une mécanique belligène d’une grande dangerosité était en train de se mettre en place : d’un côté, un bloc USA/OTAN/Arabie saoudite, et de l’autre une coalition russo-iranienne. La préparation de plans d’assistance de l’OTAN a engendré une grande nervosité à Moscou qui a annoncé que tout envoi de troupes « étrangères » (= saoudiennes) en Syrie déclencherait une guerre. Dimitri Medvedev, Premier ministre russe, a prévenu : « Les Américains et leurs partenaires Arabes doivent bien réfléchir : veulent-ils une guerre permanente ? » (22). De son côté, Ashton Carter, le secrétaire d’Etat à la Défense, a clairement évoqué les perspectives d’intervention et d’appui de l’OTAN. Medvedev a fustigé la menace que représente l’OTAN comme au temps de la guerre froide. On comprend mieux à présent que l’urgence contraint les protagonistes à retrouver la table des négociations et de travailler à la stabilisation régionale. Le résultat des élections iraniennes du 26 février, qui est un encouragement donné à la politique de détente de Rohani, non seulement avec les Occidentaux mais aussi au niveau régional, est un contexte favorable à une politique privilégiant des solutions diplomatiques plutôt que la poursuite coûteuse d’opérations militaires incertaines en Syrie. Les ressources financières limitées dont disposera l’Iran après la levée des sanctions, tant que le cours du baril reste bas, obligent les responsables de la République islamique à sérier leurs priorités. En matière de défense, la lutte contre Daech sera la priorité absolue. Compte-tenu des moyens modestes de l’appareil militaire iranien, y compris chez ses alliés du Hezbollah, il sera nécessaire qu’une forme de concertation organisée, de partage des tâches, s’opère entre l’Iran et les Occidentaux, les Russes, pour véritablement éradiquer le péril djihadiste. Ce qui suppose des révisions doctrinales, notamment à Washington. A cet égard, l’Iran a mis en garde l’Amérique de ne pas utiliser le cessez-le-feu pour faire disparaître le pouvoir syrien (23).
Cette nécessité se perçoit au vu de l’appui américain donné à la Turquie qui devait s’engager dans la lutte contre Daesh mais qui en fait a surtout frappé les Kurdes. Washington n’a semble-t-il pas encore fait de choix véritable, ou du moins, clair. Or, une telle révision est une revendication iranienne régulièrement avancée devant les Etats-Unis afin de pouvoir coopérer efficacement pour stabiliser la région. L’Iran répète sans cesse qu’il est un véritable Etat, stable, et qui n’envahit pas ses voisins. Si la pérennité et la tradition étatique de la République islamique ne font guère de doute, les arguments iraniens sont moins convaincants à propos du respect de la souveraineté d’autrui. Le contentieux relatif aux ilots d’Abu Mussa, de la Petite et de la Grande Tomb, oppose les Emirats arabes unis à l’Iran qui refuse tout arbitrage ou soumission à la Cour Internationale de Justice. Ceci ne renforce pas la crédibilité des positions iraniennes. Au bout du compte, il apparaît que l’Amérique serait ouverte à un retour de l’Iran comme puissance régionale ayant des responsabilités correspondantes.
La posture rigide saoudienne ne donne pas de signe visible d’assouplissement, Riyad ne répondant pas aux demandes d’ouverture iraniennes. Au vu du pourrissement de la situation en Syrie, dont les conséquences régionales peuvent être explosives, d’autant que des tensions dangereuses se développent par ailleurs entre la Turquie et la Russie, Barack Obama a compris que des initiatives urgentes s’imposent, en vue de relancer l’indispensable retour des négociations avec toutes les parties prenantes, au premier chef l’Iran. Washington veut obliger tous les acteurs à dialoguer. Téhéran, même si la Maison-Blanche répète que la République islamique doit renoncer à un soutien « inconditionnel » au maître de Damas, se veut acteur « à part entière » de ce dialogue. A cette occasion, on assiste manifestement à une coordination étroite entre la Russie et la République islamique pour conforter une position commune dans les futures négociations, une identité de vues et d’intérêts qui n’est sans doute pas sans nuances ni nuages. Hossein Moussavian, ancien négociateur nucléaire iranien, connu pour sa capacité à diffuser des « messages, ballons d’essai », répète que l’Iran plaide pour une solution politique en Syrie si l’on veut éradiquer Daech et les autres groupes djihadistes. Elle passe par un cessez-le-feu et par la constitution d’un dialogue national intégrant tous le groupes et courants politiques, suivi d’une réconciliation nationale. Il considère que le sort de Bashar al-Assad est un sujet de désaccords mais pas insoluble. L’Iran demande des élections libres sous les auspices de l’ONU (24). Les interlocuteurs de Moussavian lui rétorquent que la grande majorité des Syriens veulent un changement de régime. Cette objection est-elle pertinente ? La population veut massivement la fin des hostilités armées. L’avenir politique du pays sera de toute façon différent du passé. La perpétuation de l’ancien régime inchangé n’est plus d’actualité. Les dirigeants américains, tout en répétant que le maintien au pouvoir du président syrien est inenvisageable (25), commencent à reconnaître que son départ immédiat n’est pas réaliste. Il faut y voir une double origine : le résultat des frappes aériennes russes qui ont donné du répit au maître de Damas, mais aussi l’influence de conseillers réalistes comme Steven Simon, ancien Directeur Moyen-Orient au Conseil National de Sécurité, qui a mené des rencontres officieuses à Damas. Simon fait partie des conseillers qui adjurent Obama de donner la priorité à la lutte contre Daech avant de peser sur un quelconque départ de Bachar al-Asssad (26). L’ancien secrétaire d’Etat à la défense, Chuck Hagel, plaide aussi pour une révision en dénonçant le fait que la politique américaine sur la Syrie est paralysée par la rhétorique répétant qu’Assad doit partir (27). Cette idée a fait son chemin, puisque des réflexions internes au Département d’Etat (mais opportunément ‘fuitées’ dans la presse) laissent entendre que le président syrien ne pourrait quitter son poste guère avant mars 2017 (28).
En décidant de procéder dès le 15 mars au départ d’une partie du contingent russe dont il déclare la « mission accomplie », Vladimir Poutine a créé un choc. En dépit de démentis peu convaincants, il semble qu’Américains et Iraniens aient été pris par surprise. On peut penser que plusieurs raisons, de nature différente, motivent ce tournant. D’une part, même si l’anéantissement de Daech est loin d’être achevé, des coups sévères lui ont été portés. Il n’est pas certain que Moscou, dont la situation financière n’est pas brillante, avec un faible prix du baril, puisse indéfiniment entretenir hors de son sol un dispositif fort coûteux. En second lieu, la Russie, qui a changé la donne sur le terrain militaire, a sans doute voulu aussi bousculer le jeu diplomatique car elle pousse de la sorte les Américains, les Saoudiens, les insurgés à progresser autour de la table de négociations. Moscou a changé le rapport de forces militaire en sorte de créer des conditions nouvelles pour amener les protagonistes à se parler. Un des nombreux prétextes au blocage a probablement été ainsi levé. Ce n’est pas un retrait total, Moscou détenant encore des moyens de pression ; l’opposition syrienne a salué cette décision de nature à pousser Damas à véritablement négocier. A coup sûr, les Syriens et Iraniens ont peine à cacher leur embarras. Les représentants de Damas ont confirmé aussitôt leur inflexibilité quant au maintien de Bachar al-Assad. Une position dure qui ne peut surprendre et ne présage pas de l’avenir. La perplexité de Téhéran est encore plus visible. Les média iraniens ne dissimulent pas un malaise : on lit dans le quotidien réformateur Arman : « La Russie n’était pas un partenaire stratégique », le retrait russe étant un arrangement entre Washington et Moscou pour amener un cessez-le-feu, la Russie agissant au nom de ses propres intérêts. Les Iraniens découvrent à leur corps défendant que Moscou et Téhéran n’ont pas nécessairement le même agenda. L’hebdomadaire ultra Yalasarat, lié au groupe Ansar-e Hezbollah, considère que le retrait russe est encore plus surprenant que son entrée dans le conflit. Cet épisode s’ajoute aux autres divergences russo-iraniennes, dont le refus de Téhéran de se joindre au projet de gel de production de pétrole pour relever les cours. Enfin, les aléas de la livraison à Téhéran du système russe anti-missiles A300 y contribuent. Le départ des troupes russes exerce une très lourde pression sur le dispositif militaire iranien déjà très éprouvé en pertes humaines (visibles) et matérielles, comme le Hezbollah libanais. La force spéciale Al Qods du général Soleimani, déjà fortement mise à contribution, va devoir être renforcée d’éléments des forces spéciales d’Artesh (successeur de l’armée traditionnelle), ce qui est un précédent. Comme le note Georges Malbrunot dans un article du Figaro le 16 mars, Téhéran a dû revoir son dispositif militaire, prié par Moscou d’envoyer plus de troupes, d’officiers d’encadrement, moins de généraux. De plus, des divergences s’étaient élevées entre les responsables de l’armée syrienne et les « conseillers » iraniens sur le rôle des forces de la République islamique. Demander un effort supplémentaire à l’Iran qui est déjà à la peine est peut-être un moyen de l’encourager à presser Damas à des concessions. En dépêchant inopinément à Damas Kamal Kharazi (ancien ministre des Affaires étrangères et chef du Strategic Council of Foreign Relations) le 19 mars, Téhéran a sans doute délivré un message (dont on ignore le contenu) mais qui pourrait être une invitation à faire progresser une solution politique.
D’autres facteurs interviennent, dont le facteur kurde, qui n’est pas uniquement le rapport avec les Turcs, mais également celui entre les Kurdes et la Syrie. Se pose aussi le défi de la stabilisation de l’Irak, qui est dans une situation désastreuse sur tous les plans : les caisses sont vides à Bagdad, le gouvernement ne parvient pas à se constituer comme un véritable Etat, les ministres sont corrompus, la situation est très critique sur le plan militaire car les Iraniens qui sont au cœur de l’offensive contre Daesh travaillent avec les milices chiites (29) qui sont aussi redoutées que les djihadistes et qui par là même compromettent une réconciliation avec les tribus sunnites qui pourraient être hostiles au redoutable « Califat ». Ce rapprochement avec les tribus sunnites, très vivement souhaité par les Etats-Unis, ne peut pas se faire, il y a là une véritable impasse. Paradoxalement, on pourrait penser qu’il y a une certaine convergence de vue entre les Iraniens et les Etats-Unis sur l’urgence d’une stabilisation politique de la situation en Irak, mais sur le terrain, le fait que le gouvernement irakien soit défaillant et que l’armée irakienne qui devrait être à la pointe de la lutte contre Daesh ne le soit pas, est un frein à cette normalisation. Ce n’est pas le seul. Ali Khamenei rappelait en septembre 2014 sur son site que « dès le départ, les Etats-Unis demandèrent via leur ambassadeur en Irak si nous pourrions coopérer contre Daesh ». Il ajoute : « J’ai répondu non, parce qu’ils ont les mains sales » (les Américains). Il confirme sa position au sortir de l’hôpital où il avait subi une opération (30) : « Le Secrétaire d’Etat (John Kerry) l’a demandé en personne à (son homologue iranien) Mohammad Javad Zarif et il a rejeté cette requête ». Pareille idée suscite officiellement des sarcasmes chez maints responsables militaires iraniens. Lors de l’exercice annuel « Défense Sacrée » qui commémore en septembre 2015 le début de la guerre Iran-Irak, le major-général Hassan Firouzabadi, chef d’Etat Major des Gardiens de la Révolution, réfute vertement la moindre idée de coopération militaire avec les Américains : « Vous plaisantez ! ». Il lance : « Les Américains sont ceux qui ont créé ISIS. Les officiels américains jouent deux rôles. Il mentent en politique et ils mentent en matière de sécurité ». Un officier supérieur pasdaran de la marine, l’amiral Ali Fadavi, abonde en soulignant que les différences qui séparent « ne nous permettent pas de coopérer les uns avec les autres ». Il insiste : « Même si nous avons des intérêts communs, ceux qui sont dans le vrai ne peuvent coopérer avec ceux qui sont dans l’erreur ». La porte est-elle totalement fermée de ce côté ? Il semble que les opinions soient plus diverses qu’on ne le pense. Le Brigadier Général Ahmad Reza Pourdastan, chef de l’armée de terre, est plus nuancé. Il reconnaît que l’accord nucléaire a laissé paraître le début d’une confiance, mais la construction de cette dernière doit se poursuivre. Selon lui, « les Américains devraient véritablement modifier leur langage menaçant » (31).
Dans leur remarquable analyse de la posture iranienne face à Daech et à la crise irakienne (32), Dina Esfandiary et Ariane Tabatabai rappellent que la question d’une concertation entre les Occidentaux et les Iraniens à propos de l’Irak n’a pas fait l’objet de négociations officielles pendant les discussions entre Téhéran et les 5+1 mais que dans les coulisses, parallèlement, des échanges de vues officieux se sont poursuivis entre Américains et Iraniens sur ce thème. Les officiels iraniens ont veillé à ne s’exprimer qu’en termes très vagues sur une telle perspective, expliquent ces deux expertes, car Rohani savait qu’une minorité d’ultras très active et puissante s’y oppose avec énergie. La situation évolue, selon elles : « Washington et Téhéran partagent les mêmes objectifs pour l’Irak : éviter la partition et une guerre civile religieuse potentiellement dévastatrice ». Elles évoquent des signes de coopération tactique, notamment quand des Iraniens se félicitent de bombardements américains contre les djihadistes. Tout en relevant les refus de Khamenei que l’Iran se joigne à la coalition anti Daech, elles rappellent que de tels propos visent un auditoire intérieur, donc que ceci fait partie d’une gestion politique des courants. La montée des périls en Irak, soulignent les mêmes analystes, contraint la République islamique à réviser ses choix. L’Irak instable est une menace plus urgente que la Syrie pour la sécurité nationale. De plus, l’intégrité des sites chiites saints de Najaf et Kerbala est une ligne rouge que Daech ne sera jamais autorisée à franchir.
Au terme des présentes réflexions, nous voyons que les élections du 26 février 2016, marquées par une victoire spectaculaire de la coalition modérée dans la circonscription de Téhéran, pourraient, si une majorité d’idées pragmatique émerge du second tour (fin avril) et des reclassements au sein des indépendants et des conservateurs, offrir quelque marge de manœuvre au président Rohani pour poursuivre une politique de détente avec les Occidentaux et diminuer les tensions régionales. C’est son objectif. L’Amérique, en pleine campagne pour les primaires présidentielles, saura-t-elle ou voudra-t-elle saisir cette occasion ? Il n’existe pas de réponse claire à cette question. On remarquera que si les avis sont partagés sur cet avenir, ils n’excluent pas qu’une approche de ‘tests’ (vérification de la bonne-volonté iranienne) puisse donner quelque résultats (33) même limités. Bien entendu, si l’Arabie saoudite refuse de s’engager sur la vie de la concertation, le dangereux pourrissement se poursuivra. Le péril que fait peser Daech sera-t-il une incitation à une plus grande coopération avec l’Iran en Irak ? La raison le voudrait mais sera-t-elle écoutée ? Sur le front yéménite, Riyad semble percevoir les risques du pourrissement de la crise. Au début mars, une délégation houthie s’est rendue en Arabie saoudite pour des conversations exploratoires pour tenter de trouver une issue à ce conflit. N’en exagérons pas prématurément la portée, mais c’est un signe. Toujours est-il que l’OTAN réfléchit aussi aux pistes de concertation et de coopération avec Téhéran (34). En effet, le développement de la présence de Daech et de réseaux djihadistes en Afghanistan fait peser une très lourde menace sur la région. L’infiltration de ces combattants dans une part non négligeable des Etats d’Asie Centrale est extrêmement préoccupante et exige urgemment une coopération des acteurs régionaux, dont l’Iran. Il ne sera pas possible d’en faire l’économie. Chinois et Russes l’ont bien compris, les Occidentaux attendront-ils de nouvelles explosions pour s’en préoccuper et appuyer les parties prenantes ?
Michel MAKINSKY
Michel Makinsky est chargé d’enseignement à la France Business School, chercheur Associé à IPSE, Directeur Général d’AGEROMYS INTERNATIONAL.
Dernière publication : « L’Economie réelle de l’Iran, au-delà des chiffres », ouvrage collectif, Paris, L’Harmattan, 2014.
Publié dans Les Clés du Moyen-Orient. Une revue dont la lecture est indispensable pour ceux qui s'intéressent à cette région dont l'avenir nous concerne maintenant tous.
Notes :
(1) Barak Barfi,The Real Reason Why Iran Backs Syria, The National Interest, 24 janvier 2016.
(2) Iran said withdrawing all its fighting forces from Syria, The Times of Israel, 28 février 2016.
(3) Joseph Benzekri, Beyond Syria : Saudi Arabia’s Strategies for Dealing with Iran, nformed Comment, 26 février 2016.
(4) Saudi Arabia offers ground troops to Syria to fight Isis, The Guardian, 4 février 2016.
(5) Kerry se serait ouvertement plaint de l’inaction saoudienne : “Tout le monde doit faire plus. Nos alliés arabes doivent faire plus”, Saudi Offer to Deploy Troops to Syria ‘Turns the Tables’ on the United States, The Atlantic Council, 9 février 2016.
(6) Madawi Al-Rasheed, Are Saudis ready to fight in Syria ? Al-Monitor, 10 février 2016.
(7) Cette communication lui permet de faire endosser à Washington toute décision sur ce qui n’est qu’une possibilité. Les autorités américaines sont restées volontairement floues sur cette perspective : Saudi Arabia says open to sending special forces into Syria, Reuters, 8 février 2016.
(8) Syria and Iran warn Saudis against sending troops, who would return in wooden boxes’, Los Angeles Times, 6 février 2016. Un langage martial qui dissimule mal une vraie inquiétude.
(9) Ali Hashem, Iran reacts to Saudi’s offer of troops in Syria, Al-Monitor, 10 février 2016.
(10) Une vue iranienne : Hossein Kebriaeezadeh, Motivation, Goals, and Consequences of Saudi Military Deployment in Syria, Iran Review, 23 février 2016.
(11) Jamal Khashoggi, Saudi Arabia’ Plan B in Syria, Al-Hayat, 13 février 2016.
(12) Saudi Arabia and Turkey rolling back on rhetoric to send troops into Syria, The Independant, 15 février 2016.
(13) Ankara Seeks Fresh Balance of Power for Region, Alwaght (support proche des Frères musulmans), 1er mars 2016.
(14) L’Arabie Saoudite a déjà envoyé des avions sur la base turque d’Incirlik, une mesure supposée s’inscrire dans la lutte contre Daech : Military Moves :Turkey and Saudi Arabia close ranks on Syria, Al Arabiya, 17 février 2016.
(15) Ibrahim al-Hatlani, Saudi Arabia turns to Turkey, Al-Monitor, 11 février 2016.
(16) Moscou a humilié Ankara en appuyant les forces pro-syriennes à qui la Russie offre une protection aérienne. La Turquie a ainsi été contrainte de renoncer à l’incursion que le président Erdogan projetait en territoire syrien : After Syria intervention flop, what’s next for Erdogan ? Al-Monitor, 26 février 2016.
(17) La visite d’Ahmet Davutoglu à Téhéran le 4 mars 2016 a permis d’en prendre la mesure, Turkish PM Davutoglu Due in Iran Friday, Tasnim News, 3 mars 2016 ; voir aussi : Turkey seeking additional gas : Davutoglu leaves for Tehran, Trend News, 4 mars 2016 ; et : Important for Turkey to keep trade relations with Iran-expert, Trend News, 4 mars 2016 ; Tehran, Ankara to mull transportation of Iranian gas via Tanap, Trend News, 4 mars 2016. Voir aussi : Syria divisions aside, Turkish PM eyes closer ties with Iran, Reuters, 4 mars 2016. M.K. Bhadrakumar, Turkey reset in Iran ties, AsiaTimes Online, 7 mars 2016 ; Reza Solat, Assessment of Turkish Prime Minister’s Recent Iran Visit, Iran Review, 10 mars 2016 ; Iran FM in Turkey ‘for best of economic relations’, Trend AZ, 19 mars 2016.
(18) Ja’far Haghpanah, Saudi-Turkey Coalition is Temporary and Publicity Stunt, Interview, Iran Review, 25 février 2016.
(19) Voir l’éclairante demonstration de Fernando Betancor : Is Us Syria Policy to Back New Saudi-Turkish Moves against Iran ?, Informed Comment, 1er mars 2016.
(20) Mona Alami, Will current truce pave way for permanent cease-fire in Syria ?, Al-Monitor, 29 février 2016.
(21) Laura Rozen, If Syria cease-fire fails, what is Plan B ?, Al- Monitor, 1er mars 2016.
(22) Baher Kamal, Syria : Instead of a Cease-Fire, have Great Powers unleashed new Proxy War ?, Informed Comment, 17 février 2016.
(23) Iran’s Velayati Questions US intentions in Syria Truce, Tasnim News, 1er mars 2016.
(24) Veteran diplomat outlines reasons behind Tehran-Riyad dispute (interview au journal allemand APuZ), IRNA, 23 février 2016.
(25) Kerry says Assad Staying Is a Non-Starter in Syria Talks, Bloomberg, 12 novembre 2015.
(26) Assad Is Reaching Out to Washington Insiders, Bloomberg, 22 décembre 2015.
(27) US’Syria Policy ‘Paralysed’ by Rhetoric that Assad Must Go, Says Hagel, The Atlantic Council, 13 janvier 2016.
(28) AP : US sees Assad staying in Syria until March 2017, PBS Monitor, 6 janvier 2016.
(29) Dénoncées avec véhémence par les Saoudiens qui rêvent de les anéantir. Pour une vue saoudienne, voir : Nawaf Obaid,Why Saudis may take on Iraq’s Shiite militias, Al-Monitor, 29 février 2016.
(30) Iran rejects US appeal for cooperation against ISIS : Khamenei, Daily Star (Beyrouth), 15 septembre 2014.
(31) Could Iran, U.S. tag-team ISIS, ’You must be dreaming’, Iranian general says, CNN, 23 septembre 2015.
(32) Dina Esfandiary, Ariane Tabatabai, Iran’s Isis Policy, International Affairs, vol. 91 n°1, janvier 2015.
(33) C’est la position de l’ancien diplomate Nicholas Burns : Dealing with Iran : A Policy of Engagement and Deterrence, The Atlantic Council, 19 janvier 2016.
(34) NATO Official Says Cooperation With Iran Possible, sputniknews, 16 février 2016.
Négociations de Genève