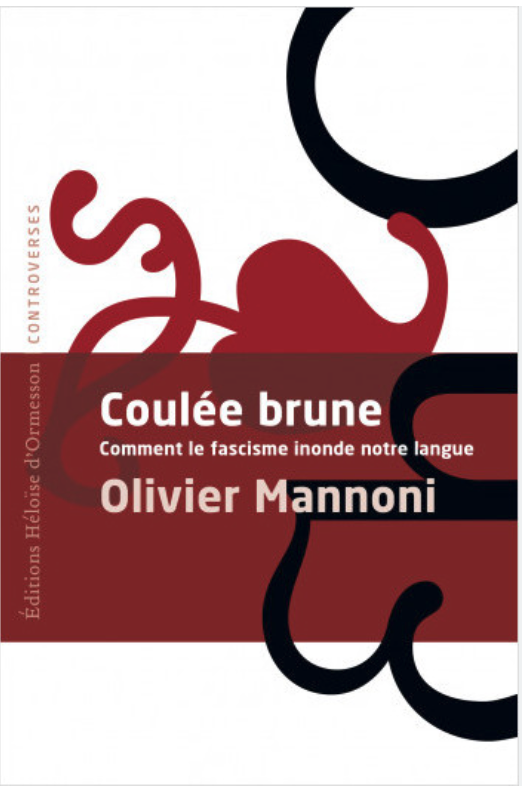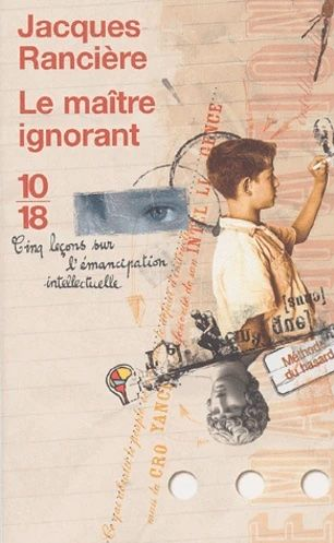"La race tue deux fois", de Rachida Brahim
Rabha Attaf - Le déni dont fait preuve l'Etat français à l'égard de la violence coloniale et son prolongement, la négation des crimes racistes, sont passés au crible par une chercheuse qui déconstruit méticuleusement ce qu'elle désigne comme législation « racialisante », c'est-à-dire les lois successives sur l'immigration, mais aussi paradoxalement les lois anti-racistes. Le contexte dans lequel ces lois sont votées les imprègne en effet d'un état d'esprit particulier. Un déni qui se traduit aussi dans la plupart des procès des crimes racistes par des peines légères, le mobile raciste étant souvent écarté.
Sur les parois de mon cervelet subsiste le tracé d’une langue que je ne sais ni lire ni écrire. Je succombe régulièrement à la douleur que provoque en moi cette seule phrase. Je succombe à cette étrange indigence qui vous conduit à ne rien savoir de vos propres défunts. Je succombe à la présence d’une violence et d’un amour que je n’ai pas connus, mais dont le souvenir me hante.
Le racisme postcolonial est un long désastre qui sait taire sa source. Il puise sa force dans l’anéantissement de notre historicité. Il est un vide dans lequel nous devons néanmoins croître sans assises et sans certitudes, mais avec ces mille fragments de postmémoire qui tailladent quotidiennement nos esprits et l’aisance avec laquelle nous pourrions être au monde. La postmémoire, c’est la réminiscence d’une violence primordiale que nous n’avons pas directement vécue. Elle se manifeste chez les descendants d’un traumatisme collectif quand bien même celui-ci n’aurait pas été transmis dans le récit familial ou national. Elle habite des allures, de lourds silences, de terribles exigences et un héritage sibyllin fait de paroles fantomatiques, de photos impénétrables, d’objets surannés et usés du quotidien: des tissus couverts de symboles, des ustensiles en étain noirci, un grand plat en bois poli à un endroit précis par un sempiternel mouvement. Ce sont ces choses infimes et pourtant massives qui depuis le passé colonial continuent à influencer notre présent. Tant bien que mal, nous nous sommes mis en quête des éléments qui nous permettraient de déchiffrer ce passé.
Ce livre est le fruit d’une postmémoire aphone qui tente malgré tout de s’énoncer. J’aimerais dire ici la violence que le racisme postcolonial fait à nos corps et à notre raison. J’aimerais décrire le mécanisme qui préside à cette violence sans rien cacher des troubles que ce savoir me cause et des leçons que j’en tire. Non par goût du pathos, mais parce que la neutralité généralement feinte par les chercheurs en sciences sociales est en réalité une violence épistémique qui participe à ce long désastre. Elle entrave l’intelligence de tout un chacun en l’obligeant à privilégier les analyses en termes de classes sociales encore perçues comme les seules garantes de l’objectivité scientifique. Pour ma part, je crois avec d’autres que la société est traversée par un régime d’inégalités protéiformes qui nécessitent de prendre aussi bien en compte les critères de classe que de genre ou de race pour ne citer qu’eux. Je soutiens par ailleurs que les propos qui suivent ont été dictés par un besoin d’histoire, par la volonté de lire une histoire de l’immigration – c’est-à-dire une histoire de France – qui serait moins fragmentée, dans laquelle on pourrait déceler des continuités, quand bien même la violence en serait le fil conducteur. Même le fait de mettre au jour un héritage atrabilaire que surplombe la violence fabriquée par la colonialité du pouvoir me semble préférable à l’ablation de la mémoire qui a longtemps prévalu. Ce besoin est une réaction à la rupture qui a été orchestrée entre les différentes «générations d’immigrés» et qui a influencé l’écriture et la transmission du récit national. Le sociologue Abdelmalek Sayad a expliqué que l’avènement de la «deuxième génération», celle des enfants de migrants maghrébins, a fait a posteriori exister la «première génération», celle des parents. Il décrit les différences qui ont été construites entre ces deux générations comme le résultat «d’une véritable opération de chirurgie sociale» au cours de laquelle la première génération a été «exclue», «tenue à distance», « cantonnée dans une vie quasi instrumentale» alors que la deuxième génération a «fait l’objet d’une tentative de récupération, d’une volonté communément partagée d’annexion en tant que sous-produit endogène». Cette opération a eu pour conséquence de scinder les deux groupes, renvoyant les premiers à un passé auquel les seconds ne pouvaient accéder.
Ce racisme postcolonial s’accompagne d’une douleur indicible qui nous fait côtoyer la honte et l’insanité. Elle est indicible non pas parce que nous manquons de mots, mais parce que les réceptacles font encore défaut. Les paroles qui cherchent à énoncer et donc à transcender cette douleur sont systématiquement réduites à l’état de bruit. En étant renvoyées au registre des émotions déplacées, elles sont minimisées ou criminalisées alors qu’elles sont factuellement justes, sémantiquement précises et socialement vitales. Cette impossibilité à dire le racisme postcolonial est aussi indécente qu’immorale. Elle condamne les personnes concernées à exister dans un espace qui confine à la folie, dans lequel d’autres peuvent leur expliquer qu’elles se trompent sur la violence qu’elles pensent subir tout en les maintenant dans l’ignorance de leur propre condition. Reste après coup, la dure honte d’avoir énoncé à voix haute ce qui doit être tu et la sensation de perdre la raison puisque les éclats de nos vies ciselées de ruptures ne peuvent jamais être rangés dans des canevas logiques.
Paradoxalement, cette douleur est sans doute notre meilleure chance. L’expérience de ce racisme postcolonial, parfaitement agencé, extrêmement feutré, repousse sans cesse les limites de notre entendement. Faisant l’expérience de ce racisme, nous faisons l’expérience de l’oreille absolue. Nous cherchons à discerner, par-delà le temps et les silences, le type d’humanité dont nous sommes les témoins. Une fois que la chose est entendue, une fois que plus aucun doute ne subsiste quant à la manière dont le monde social nous réduit à des catégories évoluant dans des relations plus ou moins médiocres, nous accédons à ce que nous avons de plus grand et de plus subtil. Nous accédons à notre âme. Elle présente l’indéniable avantage de n’être d’aucune race, d’aucune classe, d’aucun genre. Elle est l’endroit dans lequel, par-delà la douleur, nous venons puiser notre force et notre constance. Témoigner depuis son âme, c’est agir en conscience, de manière à ce que les mots tant dévoyés de justice et de fraternité l’emportent encore.
Plus la parole de nos âmes sera disqualifiée, plus nous redoublerons d’intelligence pour que puisse survivre cette part de nous-mêmes que la colonisation nous a confisquée et où se mêlent le regard de nos femmes tatouées, la luxuriante misère de nos lignées, la réminiscence d’une terre saccagée, mais toujours féconde, et ce long et délicieux parfum d’insubordination. Dans la pièce qui se joue encore, en vertu de cette part sensible et de son potentiel subversif, nous conjurons le sort et et nous enterrons nos morts. Nous conjurons le sort et nous enterrons nos morts. Nous tenons des listes d’hommes tombés sous les coups du racisme pour dire que nous refusons catégoriquement d’être violentés en raison de notre visage, de notre nom, de notre filiation. Nous dressons religieusement ces listes parce que nous nous souvenons des grands-parents que nous n’avons pas connus et des petits-enfants que nous n’avons pas encore. Ce geste, quand bien même il n’aurait pas la matérialité d’un monument aux morts, relève d’un acte patrimonial. L’élaboration de ces listes a été guidée par la volonté de laisser une trace et un témoignage sur l’époque au cours de laquelle elles ont été compilées. Plus qu’une comptabilité macabre, elles livrent des éléments sur l’état des rapports sociaux. Répéter régulièrement que des hommes meurent en raison de leurs stigmates, c’est dire la précarité de certaines vies, l’adversité d’une condition et les formes extrêmes que peut prendre l’exclusion.
De telles listes sont dressées depuis les années 1970. Compilées par plusieurs générations de militants, elles sont enfouies dans les caves des archives associatives et présentent toutes le même format, à la fois sec et funeste. On y trouve la date du crime, le nom de la victime, suivis d’une ou deux phrases laconiques. Elles frappent par leur rudesse, leur longueur et leur nombre. Poser une liste conduit inexorablement à en trouver une autre quelques jours plus tard. Ces listes expriment l’idée d’une injustice. Elles dénoncent le racisme et l’impunité du racisme. Elles pointent du doigt les crimes, mais également la grande majorité des procès qui ont fini par des peines légères avec sursis ou des acquittements, quand ce n’est pas un non-lieu qui est venu clore l’affaire. Elles disent en substance que la racialisation – autrement dit, le fait de placer des personnes dans une catégorie raciale afin d’asseoir un rapport de pouvoir et d’en tirer profit – cette action précise, à la fois nébuleuse et très sophistiquée, tue deux fois. La première violence se déroule dans un cadre interpersonnel et touche d’abord à l’intégrité physique de la personne. Elle s’incarne dans le coup porté à un individu en raison des préjugés que l’on entretient à son égard. La seconde violence a lieu à l’échelle institutionnelle et porte davantage un coup psychique. Elle est une conséquence du traitement pénal qui ignore la nature raciste des crimes jugés.
Cette histoire des crimes racistes vise à déchiffrer ces listes en interrogeant les soubassements de cette double violence. Elle s’intéresse à une période déterminante qui se situe entre les années 1970 et 2000. Votée en 1972, la loi Pleven est considérée comme le pilier de la législation antiraciste française. Il a cependant fallu attendre l’année 2003 pour que la France adopte une loi permettant de prendre en compte l’intention raciste d’un crime. Ainsi, durant cette période d’une trentaine d’années, alors que la notion de crime raciste occupait régulièrement la sphère militante et médiatique, elle était à l’inverse totalement inexistante dans la sphère juridique. Aujourd’hui encore, malgré la loi de 2003, il reste difficile d’invoquer le mobile raciste puisque celui-ci ne peut être considéré comme une circonstance aggravante que si le prévenu a exprimé un préjugé raciste avant, pendant ou après les faits. Deux conceptions d’une même réalité ont donc coexisté: la réalité du groupe concerné par ces violences, d’une part, et celle émanant du droit étatique, d’autre part. Alors que pour les personnes mobilisées, le caractère raciste des violences ne faisait aucun doute, pour les législateurs, l’idée même d’un mobile raciste a régulièrement été rejetée. J’ai voulu questionner ces deux vérités et les circonstances qui ont déterminé leur existence. Pour les personnes concernées par ces violences, quels sont les mécanismes qui conduisent certains à la mort et d’autres à une vie empreinte d’un si tenace sentiment d’injustice? Du côté de l’État, à travers la voix des parlementaires, quels arguments ont été employés pour réfuter la prise en compte du mobile raciste et sur quelle rationalité s’est fondé ce rejet?
Ces questions sur la carrière juridique du mobile raciste dépassent le strict champ pénal. Elles interrogent la logique sociale qui conditionne la difficulté à mettre les crimes racistes en procès. Elles imposent de mettre en évidence la structure raciste qui assure la pérennité de ces violences. Il existe un certain nombre de travaux fondateurs sur la question du racisme, mais l’idée d’un racisme structurel, qui adviendrait de manière systémique à la fois à l’échelle interpersonnelle et institutionnelle, ne semble pas encore bien admise en France. Par exemple, lorsque l’on entre ces deux mots dans SUDOC, la base de données universitaire française rassemblant plus de 13 millions de notices bibliographiques, aucun résultat ne s’affiche, comme si la chose sur laquelle nous souhaitions nous informer n’existait pas, alors même qu’un certain nombre de travaux pionniers pourraient être classés sous cette entrée. De manière générale, le racisme structurel est un agencement méthodique dans lequel les normes établies par les pratiques institutionnelles et les représentations culturelles permettent non seulement de produire, mais aussi de perpétuer les inégalités touchant les personnes racialisées. En étudiant la dénonciation et le traitement des crimes racistes, je souhaite plus précisément identifier la fonction de l’appareil législatif et judiciaire au sein du racisme structurel. Il s’agit, d’une part, de rendre compte de la violence dans laquelle évoluent les personnes racialisées et, d’autre part, d’interroger le rôle joué par le droit lui-même dans la production et le maintien des catégories raciales par-delà la dénonciation des violences qui en résultent. En l’occurrence, cet ouvrage explique que ce qui déchire le ventre et l’esprit, ce qui provoque la violence physique et psychique, c’est de se voir tenir un discours contradictoire dans lequel des lois particulières et des règles universelles alternent de manière à produire et maintenir les catégories raciales. Je soutiens que cette contradiction est un pilier du racisme structurel qui repose sur un processus concomitant de racialisation et de déracialisation auquel le droit participe en tant qu’outil de division et de normalisation sociale.
Il est possible de mettre au jour l’ossature du racisme structurel en revenant sur les temps forts qui ont jalonné l’histoire des crimes racistes entre les années 1970 et 2000. La première partie de l’ouvrage présente ces violences en s’appuyant sur des exemples précis. Parce qu’elle expose froidement des données obscènes, la lecture de ces exemples peut provoquer un certain malaise, mais bien entendu ce n’est pas le but poursuivi. Tenter de décrire les faits de la manière la plus exhaustive possible participe à l’administration de la preuve et permet de se représenter cette violence. Parmi l’ensemble des actes dénoncés durant cette période, les crimes racistes qui ont eu lieu dans la région marseillaise en 1973 s’apparentent à un cas emblématique. À la suite du meurtre d’un chauffeur de bus commis par un Algérien psychologiquement instable, six hommes arabes sont retrouvés morts dans les cinq jours qui suivent. En l’espace de trois mois et quelques, on compte une cinquantaine de blessés et dix-sept morts. À ce moment précis, l’engrenage qui conduit à la violence raciale est parfaitement visible. Mais les évènements de 1973 ne sont pas un cas isolé. Depuis la décolonisation, les crimes racistes ont varié d’intensité, mais avec les violences qui ciblent les populations les plus vulnérables, ils constituent la toile de fond de notre apparente paix sociale. En l’absence de statistiques dites ethniques et en raison des délais de communicabilité qui contraignent l’accès aux archives publiques, il est difficile de chiffrer précisément cette violence. Pour ma part, en consultant les archives d’associations, de journaux et du ministère de l’intérieur, j’ai pu relever 731 actes dénoncés comme étant racistes entre 1970 et 1997. Cette base de données permet de mettre en évidence les trois grands types de circonstances qui se dessinent derrière la notion générique de crime raciste. On trouve des violences que l’on appellera idéologiques, situationnelles ou disciplinaires.
La deuxième partie de l’ouvrage s’intéresse à l’approche particulariste qui caractérise la manière de gouverner les personnes racialisées. En dépit des différences circonstancielles, toutes les violences ont été motivées par la nécessité de se défendre contre le danger que représentaient les Maghrébins et leurs descendants dans l’esprit de leurs auteurs. Cette idée d’un danger lié généralement à la présence de migrants africains est également visible au sein de la politique d’immigration française. Entre les années 1960 et 2000, différentes mesures visant à freiner l’immigration africaine ont alimenté les préjugés raciaux à l’encontre de ces migrants et de leurs descendants. Ces derniers ont été rendus particuliers afin de justifier l’adoption de lois tout aussi particulières visant à gérer les problèmes que poserait leur présence. En stigmatisant leurs traits physiques ou culturels, les politiques publiques relatives à la question migratoire (la politique d’immigration mais aussi la politique du logement ou la politique de la ville) ont par ailleurs perpétué les catégories raciales produites durant la période coloniale. Cette opération de stigmatisation joue un rôle clé dans le processus de racialisation. C’est elle qui expose les personnes concernées à une violence spécifique, une violence raciale en l’occurrence, en les associant à un danger contre lequel il faut se défendre. Ainsi, durant la période étudiée, les travailleurs africains puis les «jeunes de banlieues» ont pu être présentés comme des populations insalubres, criminelles ou incapables de s’adapter à la société française. Durant cette même période, différentes générations de militants ont dénoncé les crimes racistes ciblant les migrants maghrébins et leurs descendants ainsi que l’impunité dont bénéficiaient les auteurs de ces faits. Le thème de l’impunité mobilisé par ces militants visait à interroger la responsabilité des pouvoirs publics dans ce racisme qui semblait se renouveler en entrant dans l’arène judiciaire. Il porte bien en lui l’idée d’un racisme que le droit lui-même rendrait structurel et systémique. Afin de mettre un terme à cette impunité, les manifestations avaient notamment pour but de faire reconnaître le mobile raciste.
La dernière partie de l’ouvrage montre que le particularisme qui caractérise la prise en charge des personnes racialisées s’arrête précisément au moment où elles demandent une justice qui prenne en compte la différence à laquelle elles ont été assignées. Alors qu’elles sont soumises à un droit particulier en matière d’immigration ou de logement, quand survient un crime on estime au contraire qu’il est impossible d’instaurer un droit particulier pour juger ces violences parce que le droit, selon un principe universaliste, doit être le même pour tous. Cette approche universaliste a insidieusement perpétué les catégories raciales en étant simplement aveugle à la race pourtant élaborée durant le temps du particularisme et dénoncée durant le temps des violences. Ce passage du particularisme à l’universalisme est perceptible au cours des trois séquences qui caractérisent la mise à l’agenda législatif des crimes et du mobile raciste. Dans les années 1970, alors que l’État algérien prenait part à la politisation des violences prenant pour cible les migrants maghrébins, les agents du ministère de l’intérieur et des affaires étrangères en France se livraient à une réécriture des faits visant à occulter le caractère raciste des agressions. Cette réécriture a contribué à la négation et à l’éviction du mobile raciste lors du vote la loi Pleven du 1er juillet 1972. Dans les années 1980, les difficultés relatives à la qualification des crimes racistes incarnent une problématique essentielle au sein des mobilisations dénonçant le traitement pénal des violences. À l’issue de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, le gouvernement s’engage à faire du mobile raciste un élément constitutif des infractions. Dans la loi votée le 3 janvier 1985, cet engagement sera contourné en arguant d’une impossibilité technique à définir le mobile raciste. Dans les années 1990 et 2000 enfin, sous l’influence des institutions européennes, la proposition visant à faire du mobile raciste une circonstance aggravante est prise en compte par le Parlement. Cependant, lors de l’élaboration de la loi Gayssot du 13 juillet 1990, cette option est à nouveau écartée alors qu’elle constituait le point central du texte initial. Elle sera réintroduite dans la loi Lellouche du 3 février 2003 sous des conditions qui nuancent l’idée d’un basculement du droit en faveur des victimes et qui témoignent de la prégnance des catégories raciales au sein même de la législation antiraciste.
Rachida Brahim
Rachida Brahim : “La race tue deux fois. Une histoire des crimes racistes en France (1970-2000)”
Collection : « Histoire : enjeux et débats » Éditions Syllepses, janvier 2021, 228 p.
ISBN : 978-2-84950-844-2-PAP
18 € Acheter