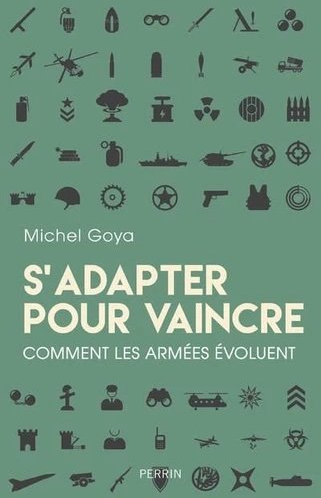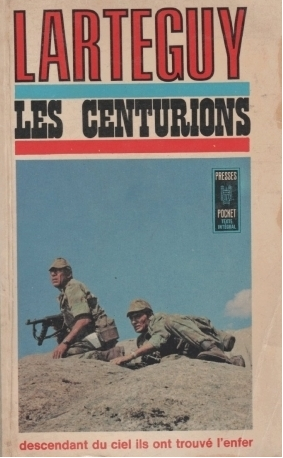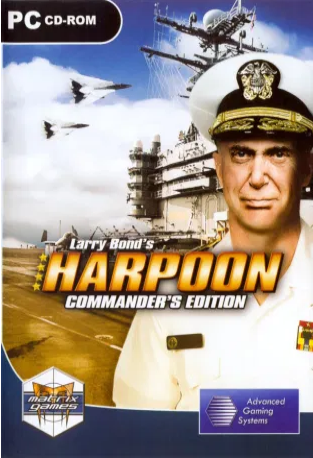Stratégies de conquêtes militaires par l'innovation systémique de Michel Goya
Une précieuse incursion dans les mécanismes de l’innovation systémique en matière militaire, aux XIXe et XXe siècle.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et l’âge des révolutions, politiques et industrielles, il était parfaitement possible de faire toute une carrière d’officier dans une armée européenne sans avoir à remettre en cause fondamentalement la manière dont on faisait la guerre. Il existait bien sûr des évolutions mais celles-ci étaient plutôt lentes et s’assimilaient assez facilement. L’armée de Wellington à Waterloo en 1815 n’était ainsi pas très différente de celle de Marlborough à Malplaquet, à 70 kilomètres de là, mais cent six ans plus tôt. Dans une confrontation entre les deux, la première aurait sans doute eu un léger avantage, mais l’issue de la bataille aurait quand même été incertaine. Wellington et ses hommes auraient en revanche été balayés en quelques minutes par la 1ère armée du général Horne pénétrant en Belgique cent trois ans après Waterloo. L’armée de Horne elle-même n’y aurait guère été à son avantage face aux divisions blindées de la 2ème armée britannique de Dempsey et aux avions de la 2ème Tactical Air Force revenant au même endroit à peine vingt-six ans plus tard. En l’espace de deux siècles, l’art de la guerre a ainsi connu une évolution d’une rapidité inédite, en Europe d’abord, puis par contrecoup dans le reste du monde.
Cette évolution trouve son origine dans les profonds bouleversements de société qui ont frappé tous les grands pays européens depuis la Révolution française. Les changements politiques, sociaux, techniques ou économiques se sont succédé dès lors et se sont entremêlés à une vitesse inconnue jusque-là. Les nations devenues « industrielles » sont parvenues à transformer l’énergie de manière nouvelle, à produire des biens en masse, à triompher même de la loi de Malthus, qui liait démographie et ressources. Elles ont connu un développement sans précédent de leur population comme de leur puissance.
Pour la première fois également, le changement autour de soi est devenu clairement perceptible au cours d’une même vie. La notion de « progrès » a fait son apparition et les regards se sont détournés progressivement d’un âge d’or antique pour se tourner vers un futur jugé prometteur, mais angoissant pour ceux qui se sentaient dépassés par ces changements trop rapides pour être complètement assimilés. Toute scientifique qu’elle se voulût, cette Europe en transformation a aussi été le lieu des tensions et des passions. Le nouveau monde industriel a été – et est toujours- un monde d’affrontements.
Les armées sont au cœur de ces turbulences. Elles aussi sont amenées à se transformer, poussées par l’évolution des choses et surtout celle de leurs ennemis. Quand et pourquoi innovent-elles dans la manière dont elles combattent ? Sont-elles condamnées, si elles n’évoluent pas assez vite, à refaire la guerre précédente ? Est-il plus facile d’innover en temps de paix, sans la pression de l’ennemi, ou au contraire en temps de guerre, où l’on est au contact des réalités ? Comment s’articulent dans ces efforts l’action des institutions internes aux armées et les pouvoirs externes, de l' »arrière », industriel par exemple, du pouvoir politique et peut-être surtout de l’ennemi ? À l’intérieur même des organisations militaires, entre le haut commandement et la première ligne qui est le véritable moteur des changements ?
Avec cet ouvrage, au propos annoncé particulièrement clairement dès les premières pages de son introduction (ci-dessus), publié en 2019 chez Perrin, Michel Goya s’affirme, s’il en était besoin, comme l’un des plus probants penseurs militaires de ce premier quart de XXIème siècle, opérant toujours plus finement à la charnière complexe entre l’histoire militaire (événementielle, doctrinale ou technique), l’histoire sociale, politique et intellectuelle à laquelle elle est liée (cet ouvrage-ci en apportant une nouvelle démonstration particulièrement éclatante), et l’histoire culturelle de la société « civile » dans laquelle une armée s’inscrit, quels que soient les effets de halo laissant parfois imaginer le contraire.
Cinq ans après son excellent « Sous le feu : la mort comme hypothèse de travail », l’ex-colonel désormais retraité de l’armée d’active nous entraîne ainsi dans plusieurs analyses détaillées de « phénomènes d’évolution militaire » entre 1789 et le temps présent. Les fondations même de l’innovation pensée comme telle, sous une forme pré-systémique et ne se réduisant donc pas à l’introduction d’une technologie et aux bouleversements, petits ou grands, qui en découlent, sont l’objet du premier chapitre, « L’armée prussienne face aux révolutions (1789-1871) », tandis que le deuxième, « La victoire en changeant – Comment les poilus ont transformé l’armée française (1914-1918) », exploite et oriente fort intelligemment, en les synthétisant, les travaux personnels les plus amples conduits par l’auteur au début de sa carrière d’historien et d’analyste – et construit ainsi un exemple particulièrement déterminant d’innovation systémique engendrée « par le bas ».
Une bonne mise en perspective de ces phénomènes de transformation technique et intellectuelle, au long cours comme sous la pression des urgences, ne serait pas complète sans l’analyse d’un échec : le troisième chapitre, « Pour le meilleur et pour l’Empire – La Royal Navy face à son déclin (1880-1945) », est en ce sens particulièrement captivant, tandis que le quatrième, « Bomber Offensive – Le Bomber Command et la 8e Air Force contre le Reich (1939-1945) », et le cinquième, « On ne badine pas avec l’atome – Guerre froide et feu nucléaire (1945-1990) », sont sans doute un peu moins convaincants, même s’ils sont tous les deux précieux quant à la prise en compte des luttes d’influence doctrinales et parfois simplement politiques (au « mauvais » sens du terme) au sein des états-majors, même parmi les plus réputés historiquement. Ces deux éclairages-là peuvent être utilement étayés par les travaux pourtant plus littéraires en apparence de Pierre Bergounioux (« B-17 G ») ou, surtout, de Mike Davis (« Dead Cities »), ou encore par les analyses de la guerre nucléaire (et de ses évolutions doctrinales depuis 1945) que l’on trouverait chez André Beaufre, Lucien Poirier ou François Géré, par exemple.
Le sixième chapitre, « Le temps des centurions – L’évolution de l’armée française pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) », autour de ce qui demeure encore un véritable point aveugle, malgré de récents efforts, de l’historiographie contemporaine française, et plus encore de sa composante militaire, est particulièrement intéressant, naturellement, par les liens qu’il tisse avec les très actuels « conflits de basse intensité » un peu partout dans le monde et avec les diverses luttes contre le terrorisme déployées face au fondamentalisme musulman dévoyé dans la part aveugle d’une lutte armée. Michel Goya prend toutefois soin de contourner habilement (car cela serait trop largement sorti du propos de cet ouvrage-ci) les débats récents autour de la « redécouverte » de la lutte anti-guérilla française par les stratèges américains englués en Afghanistan et en Irak. On songera certainement, du côté des résonances probables, aussi bien au journaliste de guerre Jean Lartéguy lui-même qu’au subtil travail opéré à distance par l’Alexis Jenni de « L’art français de la guerre », ou bien sûr, au grand « Tombeau pour cinq cent mille soldats » de Pierre Guyotat.
Le septième et dernier chapitre, « L’US Army et la guerre moderne – Entre guerres imaginées et guerres menées, l’évolution de l’US Army de 1945 à 2003 », par la richesse et le foisonnement de ce qu’il couvre, fait déjà office de pré-conclusion à l’ouvrage, et réutilise pour les réorienter et les synthétiser une partie des munitions développées dans les chapitres précédents (les cinquième – sur le nucléaire – et sixième – sur la guerre d’Algérie – tout particulièrement). Sous la pression du tragique échec vietnamien, des difficultés sans nombre d’abord à le comprendre et à l’analyser, puis des difficiles évolutions entre fin présumée de guerre froide et développement à grande échelle des conflits asymétriques, l’évolution du débat doctrinal et de ses déclinaisons en politiques de moyens et d’emploi est superbement traité par Michel Goya, couvrant aussi bien, sans toujours les détailler bien entendu, faute de place, les vastes réformes si habilement vulgarisées par le Tom Clancy de « Tempête rouge » ou « Octobre rouge » que les réorganisations pensées un temps autour de la « manœuvre » de John Boyd.
Ce livre a commencé avec des interrogations sur la manière dont les armées évoluaient et s’adaptaient. Les cas concrets qui ont été décrits ensuite ont au moins mis en évidence combien les processus pouvaient être complexes.
Il est possible toutefois de dégager quelques principes en partant d’un schéma simple : une armée est d’abord orientée par les missions qu’elle doit accomplir face à des ennemis actuels et potentiels. Dans le même temps, cette armée est liée aussi au reste de la nation qui lui fournit ses ressources. Missions comme ressources sont fixées par l’autorité politique supérieure avec laquelle l’armée entretient un double rapport d’expertise et de subordination. L’adaptation militaire définit alors d’abord la gestion de la tension entre ressources et missions des armées dans un cadre politique plus ou moins contraint.
Au centre de ces tensions, on trouve un système de compétences liant, au sein de structures données, des équipements à des hommes guidés par une culture (soit l’ensemble des façons de « voir les choses ») et qui développent des méthodes particulières. Ce système a quatre composantes, que l’on baptisera Pratique, correspond à ce qu’une organisation militaire est réellement capable de faire. Faire évoluer une armée, c’est faire évoluer sa Pratique.
La lecture de Michel Goya est désormais particulièrement stimulante, dans la mesure où, au fil des publications, la lectrice ou le lecteur constate à quel point, loin des balbutiements opérés par d’autres il y a vingt ou trente ans en matière de compréhension réciproque de la chose militaire et de la chose civile – quand les métaphores et les ressassements obéraient toute réelle possibilité d’analogies productives -, il développe une véritable maîtrise, peu à peu affûtée, de l’échange intelligent entre univers disjoints.
Tout en ayant absorbé la boîte à outils théorique issue des travaux des historiens des révolutions militaires (dont on trouvera d’excellents résumés dans le « Comprendre la guerre » de Laurent Henninger et Thierry Widemann, par exemple), il manie à présent avec une réelle familiarité, sans contresens mais également sans excès dommageables de confiance, les concepts « civils » issus des travaux des trente dernières années sur l’innovation entrepreneuriale, notamment. Ses mobilisations à point nommé de Clayton Christensen, de Ram Charan ou de Geoffrey Moore, de Tom Kelley ou de Constantinos Markides, de Gary Hamel ou de Paul Geroski, que leurs noms soient cités ou que seules leurs théories soient mentionnées, sonnent juste à chaque fois, et sur les zones frontalières des analogies, cela n’est pas si fréquent.
En résumé, l’instabilité de l’environnement politique des armées introduit des changements fréquents dans les missions ; or celles-ci induisent des capacités et des méthodes – voire un esprit – différents. Il n’y a, par exemple, pas grand-chose de commun entre la gestion de foules et l’affrontement de deux escadres. Le passage régulier d’une priorité à l’autre est donc toujours une source forte de tensions et implique des adaptations.
Une particularité forte des missions de guerre, celles qui nous intéressent ici, est qu’elles se mènent face à des forces armées ennemies. Cela introduit plusieurs paramètres spécifiques par rapport à d’autres organisations comme des entreprises ou des administrations.
Le premier est l’ampleur des enjeux. Les choix qui sont faits dans l’action mais aussi dans sa préparation ont des conséquences graves, depuis la mort d’individus au combat jusqu’à la disparition éventuelle de nations entières. Le coût de l’échec, toujours ressenti beaucoup plus fortement que le succès, est particulièrement élevé, ce qui suffit en soi à inciter plutôt à la prudence et à un certain conservatisme.
Ajoutons que la préparation au combat repose dans la plupart des armées sur la consolidation d’une confiance en soi, mais aussi dans les pairs et les chefs, ainsi que sur un esprit de corps où l’attachement à l’histoire et aux traditions occupe souvent une place importante. On « oblige » un comportement en le liant à des comportements collectifs passés. Tout cela, avec la discipline et la sacralisation de l’accomplissement de la mission, renforce la capacité à résister à la pression des combats, mais n’incite pas forcément là non plus aux remises en cause pourtant régulièrement nécessaires.
Et puis, il y a l’ennemi, souvent potentiel, mais parfois réel. Si la confrontation avec lui est source de stress, elle est aussi un puissant stimulant qui suffirait à expliquer, avec l’accroissement des ressources qui accompagne souvent cette confrontation, la multiplication des innovations en temps de guerre par rapport aux temps de paix. Cette confrontation dialectique introduit également un facteur d’incertitude considérable. Comme l’explique l’historien et stratégiste Edward Luttwak, dans un monde sans ennemi le chemin le plus court d’un point à un autre est la ligne droite, ce n’est plus forcément le cas si ce chemin est l’occasion d’une embuscade. Dans ce contexte, le chemin le plus long sur la carte peut donc être paradoxalement le plus rapide, mais sans certitude absolue malgré le travail des services de renseignements. Edgar Morin de son côté distingue la programmation, l’agencement des moyens afin d’atteindre un but, de la stratégie, qui décrit la même chose, mais face à une intelligence hostile. La friction décrite par Clausewitz, ce désordre incompressible inhérent à toute opération, atteint des sommets dans les batailles, même les mieux préparées.
Hugues Charybde le 23/04/2021
Michel Goya - S'adapter pour vaincre - éditions Perrin
l’acheter ici