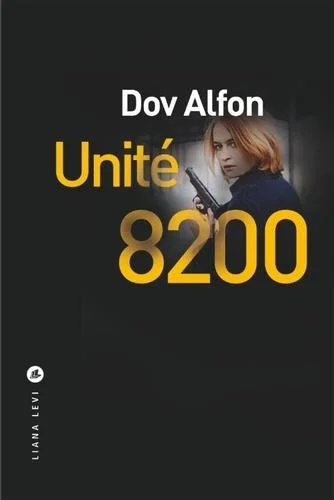Unité 8200 : dernières et superbes nouvelles du polar israélien
Entre un enlèvement à Roissy et un centre ultra-secret du renseignement israélien, une plongée remarquable dans un monde d’ombres et de magouilles impavides, par un fin connaisseur de l’Israël contemporain.
Neuf passagers furent témoins de l’enlèvement de Yaniv Meidan à l’aéroport Charles-de-Gaulle, sans compter les centaines de milliers d’internautes qui regardèrent les images de surveillance une fois qu’elles eurent été mises en ligne.
Le rapport initial de la police française le décrivait comme « un passager israélien âgé d’une vingtaine d’années », bien qu’il eût fêté son vingt-cinquième anniversaire une semaine plus tôt. Ses collègues le décrivaient comme « malicieux », voire « infantile ». Tous s’accordaient à dire qu’il « aimait s’amuser ».
Il débarqua d’humeur visiblement joyeuse du vol 319 d’El Al. En sortant de l’avion, il tenta une dernière blague auprès du personnel de bord et, au passage de la douane, il fit le pitre au bénéfice des policiers français, qui le regardèrent avec une hostilité manifeste avant de tamponner son passeport et de lui faire signe de passer.
Ça avait toujours été comme ça. Depuis la maternelle, les gens pardonnaient tout à Meidan. Sa spontanéité exubérante, juvénile, parvenait à charmer tous les employeurs pour lesquels il avait travaillé et lui avait gagné un certain nombre de cœurs, même pour un court moment. « C’est si facile de pardonner à Yaniv », avait dit un jour un de ses professeurs à sa mère.
Rien d’autre ne le distinguait des deux cents Israéliens venus à Paris pour participer à l’expo CeBIT Europe. Avec sa coupe en brosse et sa barbe de trois jours, son jean et son T-shirt portant le logo d’une expo précédente, il présentait l’uniforme de tous les jeunes gens d’un pays qui se qualifiait lui-même de « start-up nation ». La bande vidéo le montrait occupé à taper frénétiquement sur son téléphone portable.
Il était depuis deux ans le directeur marketing de la compagnie de logiciels B.O.R., ce qui faisait de lui le plus ancien de la petite bande envoyée à l’expo. Ils étaient six en tout – une équipe restreinte par rapport aux grandes compagnies. « Nous, on n’a pas d’argent, mais on a du talent », lançait-il régulièrement à ses collègues, qui le regardaient avec un mélange d’amusement et d’affection.
Le hall de réception des bagages était exigu et mal éclairé. Meidan se mit à multiplier les blagues. Plus ils attendaient, plus il s’ennuyait, et il faisait les cent pas en bavardant à perdre haleine, tambourinant par moments sur le tapis roulant qui s’obstinait à rester immobile. Il détestait attendre. Il détestait s’ennuyer. Sa réussite dans sa branche d’activité tenait essentiellement à cette qualité : son besoin obsessionnel d’injecter du divertissement dans chaque instant de la vie.
Dans l’attente des bagages, il entreprit de se photographier dans différentes poses, et posta une photo de lui en train de tirer la langue au mannequin nu d’une affiche des Galeries Lafayette, sans penser que l’image apparaîtrait le lendemain en première page de Yedioth Ahronoth, le journal le plus lu d’Israël.
Les directeurs des compagnies rivales étaient rivés à leurs portables et mettaient l’attente à profit pour travailler, peaufinant leur présentation pour l’expo. « Tout est affaire de connexion », lança Meidan à son équipe en sortant une carte Visa et en faisant une grimace devant un panneau d’affichage d’American Express.
Soudain les valises commencèrent à glisser sur le tapis roulant, et les leurs furent parmi les premières à apparaître. « Pas de panique, les gars, l’expo sera encore là demain », jeta Meidan aux autres passagers, avant de prendre la tête de son équipe qu’il guida vers la sortie d’un pas triomphant.
Il franchit la douane, ses cinq collègues dans son sillage, puis les portes automatiques s’ouvrirent devant une petite foule de chasseurs d’hôtels et de chauffeurs venus chercher un passager. La moitié d’entre eux avait l’air de gangsters, mais au milieu se tenait une blonde renversante dans un uniforme d’hôtel rouge qui brandissait bien haut son panneau. Meidan s’approcha d’elle aussitôt, histoire de faire encore une pitrerie, juste une dernière pour la route.
Il était 10 h 40, le lundi 16 avril.
La disparition en plein jour, à Roissy-Charles-de-Gaulle, d’un jeune directeur marketing high-tech israélien, sert ici de point de départ à un imbroglio particulièrement féroce, dans lequel une enquête policière échevelée, menée à Paris tant par les services officiels français que par les équipes israéliennes un peu plus officieuses présentes sur place plus ou moins par hasard, entre en sourde vibration avec une redoutable guerre des services et des personnes, guerre feutrée ou non, au sein de l’appareil de renseignement israélien et de ses officines gouvernementales, à Tel-Aviv.
Pendant ce temps à Tel-Aviv, on escortait en hâte le lieutenant Oriana Talmor à la réunion exceptionnelle.
C’était la première fois qu’on lui demandait de représenter son unité à Camp Rabin, le quartier général de Tsahal à HaKirya. Elle considérait avec surprise l’énorme bâtiment des Forces de défense israéliennes, tandis que l’athlétique membre de la police militaire qu’on lui avait assigné pour escorte ouvrait la marche d’un pas martial. Le lieutenant Talmor le suivait à travers un labyrinthe de casernes brutalistes en ciment et de tours en verre futuristes, le long d’allées portant des noms aussi incongrus que « chemin des iris » ou « sentier des Pâturages ».
Il leur fallut vingt minutes et plusieurs vérifications d’identité pour atteindre l’étage abritant les bureaux exécutifs du chef des Renseignements de Tsahal.
Oriana trouva un siège près d’une fenêtre donnant sur Tel-Aviv. Devant elle, une masse d’immeubles peu élevés où pointaient ici et là des taches de vert s’étalait en direction de la Méditerranée. La mer était à peine visible, incolore sous le soleil écrasant, éclipsée par les tours résidentielles et les hôtels.
De l’autre côté de la rue, les gens faisaient la queue devant des restaurants chics, passaient sur des vélos électriques dernier cri, échangeant des salutations, des nouvelles de la famille et des recettes vegan. Plus près des grilles, quelques femmes vêtues de noir appelaient à la fin de l’occupation militaire des territoires palestiniens, poliment ignorées par les touristes américains qui s’engouffraient à l’intérieur du centre commercial. Près du parking, des dizaines de chats rôdaient autour des poubelles, attendant que le soldat de corvée vienne y déverser les restes de la cantine.
Même de cette hauteur, Oriana percevait l’énergie qui se dégageait de tout cela. Tel-Aviv était désormais considérée comme l’une des villes les plus cool du monde. C’était aussi le seul endroit en Israël qu’elle n’avait jamais vraiment aimé.
Elle quitta la fenêtre et s’attarda devant les étranges objets qui ornaient les murs : un chapeau de cow-boy, don d’un chef de la CIA ; une épée en argent, présent du chef des services de sécurité du Zimbabwe ; une affiche vintage de Toblerone offerte par le chef du contre-espionnage suisse. Elle essaya de deviner quel présent le chef du renseignement israélien leur avait offert en retour.
À midi pile, les lourdes portes de bois s’ouvrirent et tout le monde entra en file indienne dans la salle de conférences, où l’air conditionné était réglé au maximum. Oriana prit un siège à l’angle de la table proche de la porte.
La tour Matcal (Camp Rabin, Tel-Aviv)
Ancien rédacteur en chef du grand quotidien Haaretz (et le premier séfarade de l’histoire à ce poste), ancien réserviste du renseignement militaire israélien, ayant vécu son enfance en France jusqu’à l’âge de douze ans, Dov Alfon est un fin connaisseur de la politique et de l’appareil militaire en Israël. Ce premier roman, publié en 2016 et traduit (fort correctement, même si quelques petites subtilités du vocabulaire militaire ont pu échapper à sa vigilance) en français (depuis l’anglais) en 2019 par Françoise Bouillot chez Liana Lévi, témoigne à la fois de cette fine connaissance de certains arcanes et d’une robuste capacité à questionner le mélange des genres et le détournement de moyens publics par des intérêts privés dont Benjamin Netanyahou et sa clique (visés désormais par nombre d’enquêtes judiciaires, comme on le sait, sans que cela n’empêche une nouvelle réélection) sont les bien tristes emblèmes. Plus surprenant, l’art du romancier qui se révèle ici permet un traitement léger, teinté d’humour, se tenant parfois joliment en équilibre à la limite de la farce rocambolesque, de sujets pourtant remarquablement sérieux, depuis les magouilles financières de politiciens au service de leurs généreux sponsors jusqu’aux caractéristiques les plus angoissantes du renseignement électronique contemporain et des échanges d’informations entre services secrets occidentaux. On songera certainement au ton jadis adopté, avec grand succès, par le Larry Beinhart de « Reality Show » (1993), puis par le film qui en fut adapté, « Des hommes d’influence » (« Wag the Dog ») (Barry Levinson, 1997). Et c’est ainsi que l’on passe, en 350 pages, un moment bizarre et passionnant en compagnie de personnages tels que le lieutenant Oriana Talmor et le colonel Zeev Abadi, tous deux de l’unité 8200 et tous deux joyeusement atypiques, le commissaire français Léger, le hacker israélien Vladislav Yerminski, ou encore le tueur à gages chinois Erlang Shen, et que l’on comprend tout à fait que les droits télévisuels de ce roman aient d’ores et déjà été acquis par les producteurs israéliens des remarquables séries « Hatufim », « False Flag » et « Fauda ».
Le moteur du chariot élévateur était froid. Les toilettes chimiques à côté semblaient flambant neuves, avec un panneau en trois langues accroché à la porte : Entrée interdite. Le capitaine de la police s’accroupit pour regarder par l’interstice sous la porte, comme pour s’assurer que personne n’était dissimulé là.
– Mes hommes ont déjà vérifié, il n’y a personne ici, dit-il en s’essuyant avec ostentation les mains sur son pantalon, comme pour bien montrer que grâce à cet exaspérant colonel, il allait devoir le faire nettoyer.
Abadi se tint un instant devant la porte des toilettes, puis, levant la jambe, il donna un violent coup de pied dans la poignée. La porte s’ouvrit avec un bruit sourd. Avant que les policiers aient eu le temps de réagir, il éclairait déjà l’intérieur avec sa torche. Il n’y avait personne, mais il y avait eu quelqu’un peu de temps auparavant. Une femme. Les toilettes étaient bouchées par une perruque blonde.
– Commissaire Léger, j’entends les chiens aboyer dans le parking en bas. Nous devrions peut-être les amener ici.
Dov Alfon
Dov Alfon - Unité 8200 - éditions Liana Lévi,
Charybde2, le 28 mai 2019
L’acheter ici