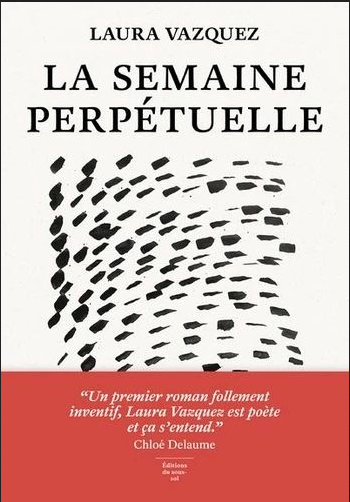Venez danser avec nous : “La semaine perpétuelle” de Laura Vazquez
La folle danse langagière des soupapes de sûreté d’un monde qui écrase, réduit et in-signifie, transformant les vies en spectaculaires obsessions de l’instant.
Une tête ne tombe pas, elle ne peut pas tomber. Elle est reliée par un fil qui descend jusqu’en bas de la personne, et si la tête tombe, le reste tombe. Il ne faut pas casser notre tête, mais on peut casser nos membres. Quand on se casse un membre, on se souvient du membre. Quand une dent s’infecte, elle vibre à l’intérieur, on dirait qu’elle nous parle. Quand on pince une main, elle apparaît. On crève un œil, et cet œil devient le centre de la personne. En vérité, le corps est mou. Les personnes sont molles. Leurs mains sont molles, elles sont plus tendres que le bois, plus molles que le plastique ou que les carapaces, elles sont plus molles que les fruits, elles sont plus tendres que la plupart des choses dans le monde. On pourrait les percer, ce serait simple, avec une aiguille, avec un clou, ce ne serait pas la peine de forcer. Traverser les mains, avec une pique, un bout de bois, rien de plus simple. Perdre les mains et qu’elles pourrissent, des mains qui tombent, il resterait les bras. Mais pas la tête. La tête ne tombe pas.
Certains robots portent une tête comme un ornement. On change leur tête, on la dévisse, on change leur apparence, ils gardent le même esprit. Salim imaginait des robots, plusieurs villes de robots dirigés par des robots. Une famille de robots dans une maison normale, le bruit de leurs pas dans les escaliers, ils discutent, ils mangent. C’est une famille ordinaire. Il arrêta d’imaginer. Il se regardait dans l’écran de son téléphone, son visage changeait. Le miroir est en train de parler, le miroir est orgueilleux et triste. Salim dit : Tu veux quoi ? Le miroir est en train de se taire.
Microcosme, monde en petit, société réduite aux acquêts, soigneusement entretenue (même si la désinvolture semble y être une culture essentielle) par les obsessions de chacune et de chacun, sous des formes mutantes et inquiétantes, dès qu’on les observe de près. La mère décédée, le père ivre de nettoyage préventif et de conformité pour éviter d’attirer l’attention du pouvoir, quel qu’il soit, et les ennuis qui iraient fatalement avec. Le fils Salim, poète instagrammatique du quotidien, pour qui tout est matière à coq-à-l’âne, à tentative de réenchantement, à télescopage spectaculaire (marchand d’une autre espèce), à mise en scène permanente du minuscule et du dérisoire qu’il s’agit de hausser chaque fois au niveau d’une préoccupation fondamentale et signifiante, au prix de contorsions intellectuelles inimaginables de prime abord (« Salim aima deux images dans son téléphone »), avec l’aide au rebond de son ami Jonathan, à la névrose encore plus visible, ou mieux dissimulée, selon le point de vue adopté. La fille Sara tente parfois désespérément de maintenir quelque sens dans la danse frénétique des instants sans lendemain véhiculée par les millions de voix solipsistes d’internet (« Parfois, Sara se demandait si c’était réel »). Quelques voisines ou voisins, fantomatiques ou ponctuellement incarnés, quelques (peut-être nombreux – qui sait vraiment ?) followers enthousiastes à l’attention si fugace malgré leur omniprésence, surtout lorsque l’un d’entre eux s’incarne en colocataire, des accidents de parcours à recycler séance tenante et incessamment, une logorrhée à tous niveaux essentielle qui doit faute de mieux faire tenir ces vies, si ce n’est debout en tout cas en vacillement non létal.
Le père avait de petites rides noires sur les lèvres, il dit : Je veux quoi ? Je veux que la maison soit propre, mais vous laissez des traces, je ne peux même plus compter. Si je compte une trace de doigt, je me rapproche et j’en compte 10, et si j’en compte 10, je me rapproche et j’en compte 100, toute la journée, je compte. On dirait que vous avez 1 200 doigts ta sœur et toi, vous avez 1 200 doigts tous les deux ? Ta sœur et toi ? Vous avez combien de doigts, 1 million ? Est-ce que vous avez 8 milliards de doigts ta sœur et toi ? C’est la question? C’est la question Salim.
Les lèvres de ce père produisaient de petits sons secs sur ses gencives. Il essorait l’éponge et il la plongeait dans l’eau, il l’essorait et il la replongeait. Il dirigea une fourchette vers le plafond et il dit : Tu dois comprendre qu’on ne fait pas tout ce qu’on veut. Un jour, la police va sonner et elle va t’emmener. Ils te mettront les deux mains dans le dos et tu feras quoi ? Tu pourras faire quoi dans cette position Salim ? Avec les deux mains dans le dos. Réfléchis bien, il faut que tu réfléchisses.
Avec cette « Semaine perpétuelle », publiée en août 2021 aux éditions du Sous-Sol, Laura Vazquez nous offre une impressionnante plongée, accompagnée de tourbillons et de vertiges, dans l’enfer d’un vide contemporain comblé à toute force par les obsessions envahissantes, érigées en systèmes de vie – ou de survie, systèmes diablement claudicants malgré leur vocation à marquer leurs micro-territoires sur les réseaux. Mobilisant sous forme de flashes lancinants, doucereux ou aveuglants, des dizaines d’instants magiques et sordides, absurdes et décalés, cette poésie de l’accumulation mixe avec une frénésie communicative des motifs pénétrants parfois aperçus dans des compagnies littéraires aussi diverses que Perrine Le Querrec (« La ritournelle », 2017), Gary Shteyngart (« Super triste histoire d’amour », 2010), William Kotzwinkle (« Fan man », 1974), Antoine Brea (« Roman dormant », 2014), Pierre Barrault (« L’aide à l’emploi », 2019), Alexander Dickow (« Le premier souper », 2021), Arno Calleja (« La mesure de la joie en centimètres », 2020), ou encore Frédéric Arnoux (« Merdeille », 2020). En forgeant ce langage-là, elle est capable de confronter les métaphores littéraires les plus imaginatives et sophistiquées à la boue des clichés les plus ordinaires, et d’examiner de près ce qui en résulte. Là où un Jean-Marc Agrati (« Le chien a des choses à dire », 2004) pratique avec un brio extrême, dans ses nouvelles, une terrifiante et hilarante ascèse de la perte de sens, Laura Vazquez organise au contraire la danse frénétique des soupapes de sûreté de cette insignifiance généralisée, largement portée à son degré de combustion spontanée par les miroirs grossissants enchevêtrés des réseaux dits sociaux, pour nous offrir une dantesque coulée volcanique de poésie de la profusion, de l’accumulation et de la tentative d’échappée explosive (ou d’une formidable poétique de l’idiotie comme l’évoque Lucien Raphmaj dans son superbe article de Diacritik, à lire ici).
Le colocataire manipulait un briquet en forme de pieuvre, il le faisait tourner entre ses doigts. Il dit : C’est un briquet rechargeable, je le branche sur mon ordinateur. Le colocataire pencha le front vers l’avant et il leva les yeux comme un démon, il remuait ses pâtes méchamment, il les salait beaucoup. Ses ongles étaient rongés au maximum, il s’arrachait les peaux jusqu’aux phalanges, et ses doigts étaient ronds. Jonathan dit : Il marche comment ce briquet ? Tu le branches et il fait du feu ?
Toute la pièce sentait le moisi. De gros champignons noirs stagnaient le long des murs. Au plafond, il y avait une fuite énorme qui se déplaçait. La fuite était devenue le centre de cet endroit. Une goutte tomba dans les cheveux du colocataire, il la fit glisser avec son pouce. Il s’était habitué à faire glisser les gouttes, c’était devenu un tic. Il l’étala sur son front, il ne leva pas les yeux, il mit une pâte dans sa bouche, il l’avala sans mâcher. Une goutte tomba dans l’assiette, il dit : Si on devait comprendre tout ce qu’on utilise, on n’utiliserait rien. Est-ce que tu comprends ta bouche par exemple ? Tu comprends la prononciation de chaque lettre dans ta bouche ? On n’a pas besoin de tout comprendre, on ne pourrait rien faire en comprenant les choses. On ne pourrait plus faire nos lacets, on ne pourrait plus mâcher. Heureusement, on ne comprend pas, on ne peut pas l’expliquer, non ne comprend pas le feu, mais le feu est bien, le feu est beau. On le voit, le feu est beau. J’ai brûlé des maisons avec ce briquet, je t’ai déjà raconté ? Mais je préfère brûler des appareils électriques. J’achète souvent de petits appareils électriques, j’achète des calculatrices et je les brûle. Les petites calculatrices pas chères dans les supermarchés, je les achète et je les brûle. Je brûle des piles, je brûle des machines. J’ai mis le feu dans un frigo un jour, devine ce qui s’est passé.
Il a explosé ?
Comment tu sais ? Tu lis mes mails ?
Hugues Charybde le 30/109/2021
Laura Vasquez - La semaine perpétuelle - éditions du Sous-sol
l’acheter ici
Laura Vasquez