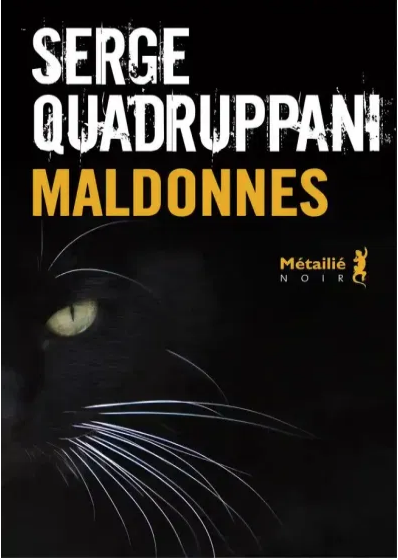Tricher n'est pas jouer … en politique comme ailleurs
Merveilleux de causticité, d’humour, de tendresse et d’allant, un polar de Serge Quadruppani en forme de somme politique provisoire, où la vengeance est bien glacée, l’avidité bien déchaînée, et l’amour bien présent, même s’il porte ses propres complexités.
Dans le Limousin, et ailleurs sans doute aussi, on dit des chats et des chiens que ce sont « des bêtes à chagrin ».
Pendant quinze ans, j’ai vécu avec Rétive, une chatte qui était la mère de tous les chats de tous mes romans. Comme beaucoup de mes contemporains, je m’éveillais souvent vers quatre heures du matin pour ressasser l’argent qui manque, l’amour qui ment, l’amitié qui trahit et l’absence de sens de tout ça et qu’en plus d’être insensé, tout ça, ça va finir car c’est la vie, la vie ça finit toujours mal et puis, en ce point précis de la nuit où je sentais un grand vide dans ma poitrine, Rétive me sautait sur le torse, elle ronronnait dans mon oreille, me léchait le menton, me mordillait le lobe et s’endormait sur mon plexus, et je me rassoupissais au chaud dans son sommeil de chat.
Un seul nuage pesait sur nous, mais il était bien noir : j’étais obsédé par l’unique différence, insurmontable, entre Rétive et moi. Celle de « l’espérance de vie ».
Pendant quinze ans, il ne s’est pas passé une semaine sans que j’aie peur que Rétive meure, et cette peur prenait la forme d’une toujours très vive représentation : je la découvrais au fond du jardin ou au pied du lit ou dans le bois voisin et mon imagination se mobilisait pour éprouver la sensation de son corps mou dans mes mains ou alors déjà raide, et l’ampleur de mon chagrin, les sanglots des premiers moments et le vide sans fin de la suite. Pendant quinze ans je me suis dit que c’était là une manière de conjurer un malheur qui n’arriverait peut-être pas avant vingt-cinq années et que peut-être je ne serais plus là pour le ressentir – et je le souhaitais avec sincérité.
Je me disais d’ailleurs la même chose quand j’imaginais aussi, parfois, avant de refouler ça bien plus vite et bien plus loin, la mort d’un être humain aimé. Je détestais la complaisance dans le tableau que je m’en faisais, la nouvelle apprise au téléphone, ou la longue souffrance médicalisée, ou l’accident atroce et bête. Je m’excusais aussi, en mettant cela sur le compte de l’angoisse, peut-être même de ma propre mort. À la fin, je m’abandonnais à une sorte de croyance obscure, jamais vraiment raisonnée : si j’y pensais tant, cela montrait bien que la mort de l’être aimé n’était et ne serait jamais que du fantasme.
Et puis, au bout de quinze ans, Rétive est morte.
Non, il n’y a pas maldonne. Vous n’êtes pas en train de lire les premières phrases d’une autofiction à la française tendance cause animale, mais bien le début d’un polar, et qu’il coïncide avec le récit de ce qui s’annonce comme les derniers temps de ma vie ne devrait pas vous gêner pour vivre par procuration des aventures palpitantes. Je n’écris pas pour vous déranger, bien calé que vous êtes dans votre fauteuil et votre vie à vous. Car vous pouvez certes partager, avec une intensité qui vous est propre, le genre d’angoisse que j’énonce ici en introduction, mais il est peu vraisemblable que vous ayez autant que moi des raisons de craindre, depuis tant d’années, la catastrophe. Car là, oui, quelque part très loin au temps de ma jeunesse, il y a eu, salement, méchamment, maldonne.
Et j’ai toujours su que, même si je n’étais pas coupable de cette mauvaise répartition des cartes qui m’a si bien réussi, je la paierais.
2021. Antonin Gandolfo, militant, braqueur, condamné, taulard, devenu écrivain à succès de romans policiers, conférencier occasionnel, amoureux et peut-être surtout lecteur (en tenace filigrane d’une existence), est forcé, qu’il le veuille ou non, de se remémorer un certain nombre d’épisodes d’une vie particulièrement mouvementée, publique ou plus secrète, lorsque certains soubresauts du passé remontent plus ou moins brutalement à la surface, depuis un certain jour d’avril 1971 dans un cercle de jeu semi-clandestin d’Orgon, bourgade des Alpilles alors en dehors des principaux radars surveillant le crime organisé, et depuis les circonstances de sa rencontre en 1977 avec un voyou particulièrement célèbre appelé Georges Nicotra.
Après ma sortie en avril 1977, j’ai un moment pensé à raconter cette histoire dans “Quetzal” à l’appui de développements sur les démocraties protestantes, leurs capacités à neutraliser les conflits et leur disponibilité à la transparence totalitaire. Mais d’autres intérêts m’appelaient. J’avais rencontré Isabelle et décidé d’aller voir Nicotra en prison.
À ces deux éléments qui allaient orienter ma vie s’en ajouta un troisième : je n’avais pas aimé la sensation d’enfoncer du métal dans la chair d’un autre et je me promis d’éviter de toutes mes forces de l’éprouver à nouveau. Après le chapitre amstellodamois, j’ai décidé que je n’étais guère doué pour la délinquance et j’ai peu à peu orienté mes activités vers des secteurs plus avouables. En lisant les mémoires de Vidocq, je découvris que dans l’argot des bandits de son temps, le faussaire était dénommé « homme de lettres ». Je pris ça comme un présage et connus bientôt le confort de savoir quoi répondre quand on me demandait ma profession. Isabelle m’encouragea dans cette voie, je devins écrivain de polar et, plus tard, grâce à Sonia, traducteur, sans renoncer le moins du monde à mes mauvaises fréquentations.
C’est ainsi qu’au début du XXIe siècle, alors que ma mue sociale était déjà bien entamée, je me suis retrouvé embringué dans des querelles à l’intérieur du milieu ultra-gauche anarcho-autonome parisien, déchiré par un désaccord stratégique fondamental entre les casseurs de vitrines et les brûleurs de poubelles. Comme je me moquais également de tous, les uns et les autres proclamaient partout leur résolution à me frapper si je croisais leur route. Durant quelques mois, je me suis donc déplacé dans la capitale avec un tournevis en poche mais quand j’ai croisé l’un de ces joyeux drilles, je me suis contenté d’échanger des injures avec lui et, malgré l’envie que j’avais de le lui enfoncer dans la narine (qu’il avait particulièrement dilatée, comme un aveu d’envie d’être pénétré sabotant le regard perçant et très viril à la mode dans ces milieux), le tournevis est resté où il était. Pendant les décennies qui ont suivi, hormis quelques rares jets de projectiles trop légers pour faire mal en direction des forces de l’ordre, le piquage de la cuisse de Désiré Venetiaan est donc resté le seul acte de violence aux dépens d’autrui que j’aie jamais commis.
De la trilogie Krachevski (« Y », « Rue de la cloche », « La forcenée »), qui marquait son entrée en fiction entre 1991 et 1993, aux plus récents « Loups solitaires » (2017) et « Sur l’île de Lucifer » (2018), ancrés dans l’actuel Limousin de son cœur, en passant par sa trilogie Simona Tavianello (« Saturne », « La disparition soudaine des ouvrières » et « Madame Courage ») de 2010-2012, orchestrant une vision affûtée – et pourtant non dénuée d’humour et de sensualité – d’une certaine Italie d’aujourd’hui, Serge Quadruppani a toujours su mêler avec une immense adresse les trames de la grande échelle criminelle, capitaliste et géopolitique avec celles d’un monde en plus petit se nourrissant d’autobiographie, réelle ou supposée. C’est pourtant plus particulièrement l’atmosphère spécifique de « Colchiques dans les prés » (2000), roman explicitement inscrit ici dans la bibliographie du narrateur principal, Antonin Gandolfo, qui en profite justement pour ironiser sur la tendance du lectorat à vouloir démêler le vrai du faux dans ses romans, atmosphère toute irriguée de braquages anciens et de vengeances inassouvies, qui sert d’amorce à la vaste fresque condensée en moins de 300 pages par ce « Maldonnes », publié en mai 2021 chez Métailié.
Multipliant les allusions, sans jamais gêner, bien au contraire, l’implacable déroulé polyphonique (en plus du corps principal du roman d’Antonin Gandolfo, il faudra compter soigneusement avec les récits croisés de Guillaume Lepreneur et d’Olga Nicotra) de ce thriller atypique, Serge Quadruppani convoque au détour des lignes aussi bien Gustave Flaubert (et certain faubourg de Salina) que Carlo Emilio Gadda, Elsa Dorlin (« Se défendre ») que Giorgio Agamben (avec « une politique qui dévoile ses acteurs dans leur vérité nue »), ou Giuseppe Tomasi di Lampedusa que Giorgio Scerbanenco, et nous invite subrepticement à une véritable visite guidée de la Bibliothèque Italienne qu’il dirige chez Métailié depuis 1999, mobilisant lorsque nécessaire, par clin d’œil joueur ou par instrumentalisation narrative, Andrea Camilleri ou Carlo Lucarelli, Giuseppe Genna ou Gioacchino Criaco, Massimo Carlotto ou les Wu Ming. Armé d’une merveilleuse causticité, il nous entraîne par de remarquables chemins détournés dans les méandres du capitalisme tardif et de sa rage punitive longtemps après les faits (l’affaire Cesare Battisti n’est peut-être pas si loin, non plus que les réflexions indispensables sur ce que fut la lutte armée dans les années 1970), en des territoires ignorés où la vengeance glacée et l’avidité brute ont plus que jamais droit de cité, où les sociétés financières luxembourgeoises ont plus à voir qu’on ne croit avec la dérive continentale conduisant des Beati Paoli de Luigi Natoli aux mafieux de Leonardo Sciascia – voire de Francis Ford Coppola (dans l’auto-parodie contemporaine du selfie généralisé) -, où « le dominant ne saurait chercher d’excuse dans la soumission du dominé », même s’il s’agit, encore et plus que jamais, de « contrecarrer les récits dominants ». Que cette rude balade dans les chemins de traverse soit conduite avec l’humour des « trous » mystérieux demeurant dans la fiche Wikipédia d’Antonin Gandolfo et avec la tendresse qui pointe jusqu’aux possibilités de fins alternatives au roman, ultime clin d’œil à celles de « Colchiques dans les prés », ne rend que plus puissant et plus nécessaire ce polar en forme de somme provisoire.
Je m’aperçois que pour en arriver à expliquer ce moment où, par un automatisme que m’a enseigné Olga, j’ai repéré sur le cou de Guillaume Lepreneur l’endroit où bat la carotide, il me faudra parler d’Olga, bien sûr, mais avant, d’Isabelle et aussi de Sonia : il y a sûrement des conclusions à tirer du fait que des femmes forment les chaînons reliant le bandit manqué au traducteur installé en passant par l’écrivain dont on redécouvrira un jour l’œuvre trop négligée en son temps (après que la clameur provoquée par le fait divers qui a marqué la fin de sa vie sera retombée). Ai-je été le jouet d’ingouvernables passions amoureuses réorientant ma vie à chaque nouvelle rencontre, ou bien un manipulateur qui a su trop bien tirer parti des attachements féminins que lui gagnèrent ses authenticités successives ? Rien ne dit que la postérité tranchera la question avec la radicalité d’une lame entrant dans une artère, il est bien possible que la chose demeure d’autant plus indécidable que tout le monde, le soussigné compris, s’en tape.
Hugues Charybde le 25/06/2021
Serge Quadruppani - Maldonnes - éditions Métaillé
l’acheter ici