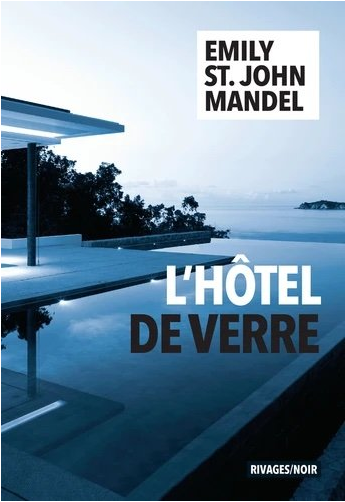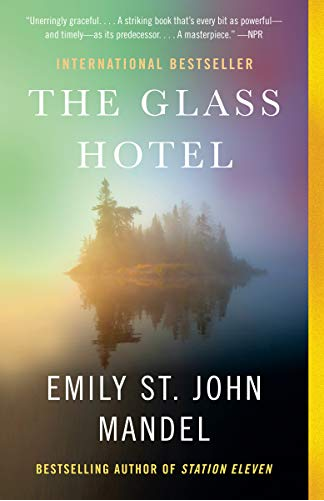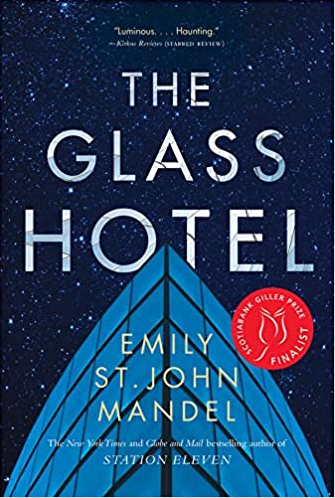L’arnaque Madoff au prisme du polar avec Emily St. John Mandel
Et si vous avaliez du verre brisé ? Le rêve emblématique de Bernard Madoff revisité en un jeu de miroirs à traverser, d’une puissance hautement inhabituelle.
Et si vous avaliez du verre brisé ? Une phrase griffonnée au marqueur à aide sur la baie vitrée de l’hôtel Caiette, côté est, avec des traînées de blanc dégoulinant de plusieurs lettres.
« Qui a bien pu écrire une chose pareille ? » Le seul client à avoir vu cette déprédation, un cadre supérieur insomniaque qui travaillait dans le transport maritime et était arrivé la veille, trônait dans l’un des fauteuils en cuir, buvant un whisky que le manager de nuit lui avait apporté. Il était un peu plus de deux heures du matin.
« Pas un adulte, vraisemblablement. » Le manager de nuit s’appelait Walter et c’était le premier graffiti qu’il voyait en trois années d’exercice. Le message avait été écrit du côté extérieur de la vitre. Walter avait scotché des feuilles de papier par-dessus et s’affairait maintenant à déplacer un philodendron en pot pour camoufler le papier, avec le concours de Larry, le portier de nuit. La barmaid de service, Vincent, essuyait des verres à vin tout en observant la scène de derrière le bar, à l’extrémité du hall. Walter avait songé à la solliciter pour l’aider à bouger la plante, parce qu’il avait besoin d’un coup de main et que l’agent d’entretien prenait sa pause-dîner, mais elle ne lui donnait pas l’impression d’être particulièrement robuste.
On fera assez rapidement ici connaissance de la jeune Vincent (ainsi nommée par ses parents en hommage à la poétesse Edna St. Vincent Millay), qui a perdu sa mère il y a quelques années dans un tragique accident ou suicide, qui a dans son paysage un demi-frère aux sérieux problèmes d’addiction, de volonté et d’honnêteté, et qui végète doucement, en attendant peut-être autre chose, en barmaid maîtresse des cocktails d’un hôtel de grand luxe perdu dans la nature côtière et forestière de l’extrême-nord de l’île canadienne de Vancouver, situé néanmoins avec ou sans hasard à deux pas des lieux de la fin de sa mère.
Une vie que l’on jurerait pourtant à ce stade devoir demeurer dans la zone de l’infra-ordinaire, malgré quelques bizarreries éventuellement familières aux lectrices et aux lecteurs d’Emily St. John Mandel (le roman entrecroise notamment très précocement certains de ses fils disjoints dont on devine pourtant qu’ils sont liés, et esquisse d’emblée de fort puissants flashbacks – comme nous l’avaient montré déjà les horlogeries impressionnantes de « Dernière nuit à Montréal » en 2009 et du « On ne joue pas avec la mort » en 2010) : jusqu’au moment où, le soir même où surgit sur la vitre de l’hôtel cet étrange graffiti arraché à sa pré-adolescence, « Et si vous avaliez du verre brisé ? », le chemin de Vincent croise celui de Jonathan Alkaitis.
Jonathan Alkaitis n’est pas un personnage inconnu dans la galerie de l’autrice, galerie qui prend doucement, au fil des romans, quelques aspects de mythologie intime : il lui servait déjà, dans « Les Variations Sebastian », en 2012, à propos d’une affaire cruciale d’éthique journalistique, à incarner un double fictif du Bernard Madoff de la « vie réelle », avec sa pyramide de Ponzi ayant couru sur des dizaines d’années, ses centaines d’investisseurs – des plus (relativement) petits aux plus grands – plus ou moins ruinés et sa condamnation à 150 ans de prison en 2009, jusqu’à sa mort en avril 2021 au pénitencier fédéral de Butner (Caroline du Nord), plus d’un an après la parution de « L’hôtel de verre », ce cinquième roman d’Emily St. John Mandel, publié en 2020, traduit en français en 2021 par Gérard de Chergé chez Rivages – et figurant sur la fameuse liste des « Lectures préférées de 2020 » de… Barack Obama.
Des années plus tard, Walter fut interviewé trois ou quatre fois au sujet d’Alkaitis, mais les journalistes repartirent toujours déçus. En sa qualité de manager d’hôtel, leur disait-il, il était tenu à la discrétion, mais en vérité il n’avait pas grand-chose à raconter. Alkaitis était intéressant uniquement avec le recul. Il était venu à l’hôtel Caiette avec son épouse, aujourd’hui décédée. Lui et sa femme étaient tombés amoureux du lieu, aussi avait-il acheté le terrain quand celui-ci avait été mis en vente, et il le louait à la société de gestion de l’hôtel. Il vivait à New York et venait à Caiette trois ou quatre fois par an. Il dégageait l’assurance un peu lasse de ceux qui ont de l’argent, cette conviction désinvolte que rien de grave ne pouvait l’atteindre. Il était bien habillé, sans ostentation, bronzé comme le sont les gens qui passent l’hiver dans des contrées tropicales, raisonnablement en forme mais pas à un point spectaculaire – bref, ordinaire à tous égards. En d’autres termes, rien chez lui ne laissait prévoir qu’il mourrait en prison.
En français, Dominique Manotti, avec son incisif « Le rêve de Madoff » (2013), et Mathieu Larnaudie, avec son essentiel « Les effondrés » (2010), nettement plus systémique, nous avaient déjà offert de superbes interprétations de ce dont Madoff est le nom, à l’heure pressante du capitalisme tardif et de la financiarisation généralisée. On dispose par ailleurs, avec de précieux romans récents tels que le « Lake Success » de Gary Shteyngart ou le « Mécanique de la chute » de Seth Greenland, de plongées fort réussies, avec un humour et une tendresse presque paradoxales, dans l’univers des ultra-riches, et dans la manière dont les hasards et les déterminismes s’y entrechoquent, in pursuit of happiness et de bien d’autres choses parfois très difficiles à nommer.
Peu d’autrices ou d’auteurs, en revanche, ont su comme Emily St. John Mandel ici dégager la composante proprement mythologique de cette bulle d’irréalité que constitue autour d’elle, quel qu’en soit le coût (pour les autres), cette fraction de facto séparatiste de l’humanité – et l’imaginaire du vide qui peut éventuellement y être associé. Si l’on songera peut-être, justement, dans cette direction-là, à l’‘Agora zéro » d’Éric Arlix et Frédéric Moulin, ou au « Aujourd’hui l’abîme » de Jérôme Baccelli, voire au Kim Stanley Robinson de « New York 2140 », mais dans ce cas particulier, avec une technique radicalement différente, on sera saisi par la capacité sans doute unique au monde de l’autrice canadienne pour aller dénicher et faire fructifier, au fond de ce qui s’exprime sous nos yeux, une vaste métaphore hautement significative de ce qui constitue cette frontière mouvante entre réel et irréel, frontière matérialisée fugitivement par les rêves éveillés de Vincent après la fin et par les échappées intérieures de Jonathan en prison.
Elle n’aimait pas mentir, mais les attentes de Jonathan étaient claires. En tant qu’ancienne barmaid, elle était habituée à interpréter un rôle. Mentir était d’une troublante facilité. La nuit où Jonathan était entré dans le bar de l’hôtel Caiette, quelqu’un avait écrit un horrible graffiti sur la baie vitrée et elle était là à essuyer les verres, à compter les minutes en attendant la fin de son service, à se demander comment elle avait pu penser que ce serait une bonne idée de revenir ici, à tenter d’imaginer – sans succès – le restant de sa vie, parce que bien sûr elle pourrait partir travailler dans un autre bar, puis dans un autre, puis encore un autre, mais quitter Caiette ne changerait rien à l’équation de base. Les problèmes de la vie de Vincent étaient les mêmes d’une année sur l’autre : elle se savait raisonnablement intelligente, mais il y a une différence entre être intelligente et savoir quoi faire de sa vie, et aussi une différence entre savoir qu’un diplôme universitaire peut changer votre vie et avoir la volonté de se coltiner le terrifiant fardeau des prêts étudiants, d’autant qu’elle avait travaillé aux côtés d’un nombre suffisant de barmen diplômés pour savoir qu’un parchemin universitaire risquait fort de ne rien changer du tout, etc., etc., et elle tournait en rond dans ce territoire familier, dégoûtée de ses pensées et dégoûtée d’elle-même, lorsque Jonathan était entré dans le bar. À sa façon de lui parler, à sa richesse ostensible et à l’intérêt manifeste qu’il lui portait, elle avait vu l’opportunité d’une vie immensément plus facile, ou au moins d’une vie différente, une chance de vivre dans un pays étranger, une existence faite d’autre chose que le service au bar, dans un autre endroit qu’ici, et cette perspective était irrésistible.
La beauté presque fondamentale de cet « Hôtel de verre » demeure peut-être néanmoins construite à partir de son maniement des atmosphères successives ou interpénétrées, pouvant passer à volonté de l’ambiance presque bucolique chère à Jim Lynch, à quelques centaines de kilomètres au sud de la Colombie-Britannique de Vincent, à celle, financière et surchauffée, des « Barbarians at the Gate » de Bryan Burrough et John Helyar, en passant par les pauses doucement méditatives (mais néanmoins malicieuses) d’un « Traversée » de Francis Tabouret ou par les beats électro-rock moites du « Riviera » de Mathilde Janin. Ces enchaînements de plages à la fois précises et doucement hypnotiques ne sont jamais gratuits ici, et c’est ce qui fait leur force : comme elle nous l’avait déjà montré dans ses romans précédents, et tout particulièrement dans son « Station Eleven » de 2013 (et comme on le retrouve d’ailleurs avec bonheur dans le tout récent « Soror » de Mathilde Janin, à nouveau, quoique dans un tout autre registre), Emily St. John Mandel sait utiliser son art pour jouer poétiquement tout au long des pages avec l’ironie du sort, tout en mettant en scène minutieusement un affrontement avec le passé, aux risques et périls des protagonistes, pour y dénicher aussi bien les fétiches encombrants que les totems libérateurs.
Hugues Charybde le 12/05/2021
Emily St. John Mandel - L’Hôtel de verre - éditions Rivages/Noir
l’acheter ici