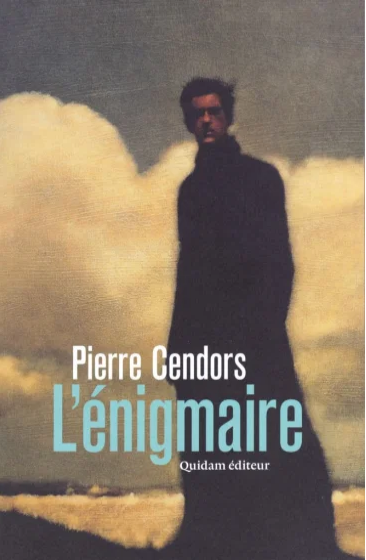L'art en version apocalypse, façon Tarkovski de Pierre Cendors
Sans frontières, parfois sans nom, nous ne régnons pas, nous allons : monstrueux de subtilité et de poésie, un labyrinthe science-fictif et tarkovskien pour réinterroger la possibilité puissante de l’art après Ravensbrück.
Ma première reconnaissance du Bois désert, à Orze, dans les terres du Nord – un petit village qui n’existe plus -, m’a conduit en cette fin d’après-midi à la lisière d’un marécage. Une coulée noirâtre, foulée d’une multitude de sabots, s’enfonçait à travers une roselière. Au bout d’une sente, je suis tombé sur plusieurs miradors d’affût. Des postes de tir. Deux cartouches vides, du calibre 12, avaient été abandonnées dans l’herbe. Elles conservaient encore une odeur de poudre.
À quelques pas de là, sur une trentaine de mètres, s’élevaient les hauts piliers en béton d’un viaduc ferroviaire. Une masse grise, hideuse. Les jours suivants, je remarquai que seuls des trains de fret, arborant la croix solaire des opposeurs, y processionnaient à faible vitesse. Aucun ne circulait à cette heure.
J’ai pressé le bouton de mon oreillette.
– Sans frontières, parfois sans nom…
– Nous ne régnons pas, nous allons.
– Validation de ma position ?
– Validée.
– On m’a signalé une ruine dans les parages.
– L’église de Saint-Édern.
– C’est ça.
– N’en subsiste qu’une abside et un enclos cimetérial.
– Quel temps prévu pour demain ?
– 3° en matinée, 10° l’après-midi. Un temps idéal pour la marche.
– Idéal sauf que… la chasse est encore ouverte.
– Était. La fermeture a eu lieu vendredi.
– Ah ! Parfait.
J’ai éteint le Dialogueur et regagné à pied le village voisin sans rencontrer personne. Le silence régnait dans le hall du Champ d’honneur. La réceptionniste s’était absentée. J’ai pris un bonbon d’accueil sur le comptoir en attendant l’ascenseur. Une fois dans ma chambre, la 10, sous le toit, je me suis assis sur le lit, toutes lumières éteintes, en regardant la nuit tomber derrière les rideaux.
Le lendemain, à mon réveil, j’hésitais toujours à pousser plus loin ma reconnaissance du Bois désert. Une heure me fut nécessaire pour me doucher, me raser et m’habiller. J’avais toujours la tête lourde et, comme il fallait s’y attendre, un peu d’hypotension. J’avalai quatre comprimés de Cogifix avec mon petit déjeuner, que je pris attablé face à la rue. C’était mon troisième jour de permission sur Terre. J’avais vingt-deux ans, aujourd’hui.
– Bon anniversaire, fiston !
– Merci ‘pa.
Si papa était encore en vie, j’aurais eu droit à la formule consacrée. Il n’y manquait jamais, pas plus qu’il n’omettait de l’agrémenter du refrain habituel :
– Tu es né le même jour que Little Nemo !
C’était vrai, sauf qu’il se trompait. Je connais cette bande dessinée par cœur. Le petit garçon en chemise de nuit qui, chaque soir, voyage au pays des songes sans jamais quitter son lit, était bien apparu un dimanche 15 octobre, comme moi, mais au moment de démarrer ses aventures dans le supplément en couleur du New York Herald, Nemo était déjà âgé de cinq ans quand je n’avais, pour ma part, que quelques minutes d’existence.
– Tu étais déjà mon petit héros avant que tu sois né !
– Oui ‘pa.
Pour mes sept ans, j’avais reçu la série complète du chef d’œuvre de Winsor McCay. Il était déjà plus qu’un frère à cette époque. On m’entendait lancer, à tout bout de champ, des « Whee ! », « Whopee ! », « Zowie ! », juste pour le plaisir de parler comme un terrien, un kiddo américain. Le petit bonhomme de McCay partageait d’autres points communs avec moi : le même toupet sur le crâne, une imagination surabondante et, ceci expliquant cela, la frousse devant tout ce qui ressemblait de près ou de loin à l’inconnu. À ma place, Nemo n’aurait jamais quitté son lit. Il n’aurait pas voulu remettre un pied au Bois désert. Il serait resté sagement au nid.
De retour dans ma chambre, j’eus beau interroger le ciel, assis sur le bord du lit, en tête à tête avec la clarté, je n’en reçus aucune lumière. J’étais censé libérer la 10 dans un quart d’heure.
Je bouclai mon sac puis enfilai mon blouson, prêt à sortir.
Au lieu de quoi, soucieux, je fis mon petit Nemo et me rassis.
Je venais d’effectuer neuf mois à bord de la station spatiale Unarus, dans un centre de Décentration de la Divna, un quotidien de plats préparés, de missions in situ, de continuelle camaraderie, sans m’illusionner sur ce que j’allais trouver ici : un territoire sinistré, dangereux – celui de la zone rouge -, d’une étendue dunaire, partiellement boisée, s’étirant à perte de vue sur un lit verdoyant d’obus, de munitions chimiques, de douilles, de grenades non explosées, de toute une militaria toxique enfouie sous les sols depuis plus de deux siècles.
Un matin tranquille de février 2016, une bourgade datant de l’Antiquité avait succombé là en quelques heures sous le feu roulant de l’artillerie ennemie. Sitôt l’armistice signé, on s’était contenté de rayer Orze des cartes. Beaucoup ne désignaient plus le site, désormais classé zone rouge militaire, interdit au public, que par le sobriquet d’une rivière aujourd’hui asséchée, dont seul demeurait un bras-mort : la Dormante.
Mais pour quelques spaciens, dont j’étais, ce mémorial négligé, pauvre orphelin de la grande histoire, était devenu une sorte de sanctuaire terrien post-apocalyptique, de maquis de l’imaginaire, d’arrière-monde fantasmé, que l’on évoquait sotto voce sous le nom du Bois désert, surnommé Boizéro. Je n’avais alors qu’une vague idée de ce que je venais faire ici.
Les virages d’une vie se prennent souvent ainsi.
Laszlo Ascencio est un jeune astronaute, le premier né dans l’espace. Adna Znor est une pianiste et compositrice de renommée internationale, endeuillée à plus d’un titre. Ils sont respectivement les usagers n°777 et n°778 du Dialogueur, super-assistant personnel et investigateur à l’échelle de la technologie déployée dans cette époque future, appareil dont les archives enregistrées constituent la trame principale d’un récit focalisé sur l’attraction étrange qu’aura exercée sur ces deux personnes – parmi bien d’autres – un lieu bien particulier : le Bois désert, situé sur l’ancienne commune d’Orze, éradiquée en 1916 sous un déluge d’artillerie et de gaz asphyxiants, devenu, au sens propre ou presque, un étonnant no man’s land, hautement dangereux et largement interdit. Diverses recherches, quelques indices épars et aux trois quarts oubliés, enfouis dans les caves d’instituts d’archéologie ou d’histoire du temps présent, semblent pourtant indiquer que, bien avant la Zone, il y eut à Orze des constructions proto-historiques, celles d’une civilisation disparue et mal connue, dont quelques fragments d’un livre, L’Énigmaire, nous seraient parvenus… Jusqu’à ce qu’une certaine Sylvia Pan devienne l’usager n°779 du Dialogueur, et que la nature ambiguë, fractionnée et universelle de cette Zone-là s’éclaire progressivement d’un jour nouveau et tentaculaire.
Nous parvînmes ensemble dans la frange marécageuse. La terre y avait été défoncée. Une cohue animale s’était attardée là, avant de filer à la queue leu leu par une coulée.
Les traces étaient anciennes. Sauf une, dans la boue. Une empreinte encore humide, celle d’une chaussure.
Je déplorai l’inemploi du Dialogueur. Une simple reconnaissance visuelle m’aurait appris de quel modèle il s’agissait, si c’était là une marque réglementaire parmi les rangs de l’opposition, ou d’un usage courant chez les chasseurs, les randonneurs et, enfin, la taille approximative de l’inconnu, son sexe théorique. Au lieu de quoi, j’en fus réduit à une rumination cérébrale qui découragea la curiosité fébrile du troglodyte.
Il fienta, puis prit son envol vers un lointain fourré.
Je fis demi-tour.
La zone rouge, personne ne l’ignorait, drainait à elle toutes sortes de marginalités routardes. L’un de leurs signes distinctifs était une allure vaguement antimilitariste, avec des velléités humanistes, et un uniforme – treillis, blouson d’aviateur dégalonné, chèche, et rangeos sprayées à la bombe argentée -, qui évoquait un scoutisme dévoyé, « Bad-Powell », noir futur, éco-punk.
À ceux-là, la zone offrait une immersion, généralement en petit groupe, dans une utopie post-apocalyptique relaxante. Leur sorte m’inquiétait moins que leur version radicalisée, les opposeurs, que l’on voyait patrouiller, toujours en binôme, la nuque rasée au millimètre, l’index en communion avec la gâchette de leur fusil mitrailleur.
Soucieux, je repris place sur mon billot, prêt à poursuivre la toilette de mes semelles. Ce point me préoccupait : une présence, dont la réalité ne faisait plus aucun doute, avait été détectée. J’en avais été prévenu. Quelque chose, à deux reprises, me l’avait signalée ; quelque chose, distinct de ma pensée, par deux fois, s’était exprimé en elle.
Ce n’était pas moi, et si ce n’était pas moi, c’était pourtant en moi.
Quelle était cette intelligence qui, ne possédant pas de corps, occupait le mien ? qui, voyant ce que je ne voyais pas, me le rendait pourtant visible ?
Le plus simple était de le lui demander.
Publié en janvier 2021 chez Quidam éditeur, « L’Énigmaire », neuvième roman de Pierre Cendors, placé dès son triple exergue sous le signe de l’hommage au « Stalker » d’Andreï Tarkovski et des frères Strougatski, amplifie sa source d’inspiration initiale tout en s’en démarquant fondamentalement. Ici, pas de pique-nique au bord du chemin parmi les emballages et restes laissés sur place par de mystérieux extraterrestres (même si la pulsion spatiale joue bien un rôle-clé, épiquement magnifiée à la manière du Harry Martinson d’« Aniara » et simultanément subtilement dévoyée en résonance avec le Pierre Alferi de « Hors sol ») : la somptueuse mobilisation de tropes science-fictifs effectuée par Pierre Cendors consacre bien plutôt le patient enfouissement, la lente sédimentation de ces « Capsules de temps » chères à Xavier Boissel, sous bien des formes possibles, des déchets radioactifs de toute « Yucca Mountain » envisageable aux ex-décharges arborées des « Freshkills », des couches langagières éventuellement codées avant renvoi aux archives archéologiques d’« Agrapha » aux objets techniques logiquement dévoyés du « B-17G » ou du « Baiser de sorcière » (Pierre Bergounioux partageant sans hasard l’exergue du roman avec le magicien du « Solaris » extrait de chez Stanislas Lem). La zone rouge de l’abandon et de l’oubli, ici, renverra le moment venu au moins autant aux friches socio-politiques du John Burnside (dont six lignes de poésie viendront achever « L’Énigmaire ») de « Scintillation » qu’aux véritables explorations urbaines et néo-rurales post-soviétiques du « Pays disparu » de Nicolas Offenstadt.
Sans l’ogre de la nécessité, il est à parier que le petit poucet inciterait l’humanité à franchir la douane du réel avec ses bottes de sept lieues. La vie sur Terre en serait – meilleure ou pire ? – considérablement déréalisée. Tout serait permis. Il suffit d’observer le comportement zoologique des riches pour s’en persuader. (Nausikaa Khan, Invitations néantes)
Même s’il a fallu ici prendre pour faux guide occasionnel le « Little Nemo » de Winsor McCay, s’il a fallu composer avec des tropismes arctiques et de mythiques communions avec la nature ré-ensauvagée (les loups de Baptiste Morizot ne sont pas si loin, la souille de Michel Tournier est étonnamment proche, c’est bien dans la discrète création et rusée mise en place d’un langage ad hoc, d’un vocabulaire aussi spécifique que savoureux (processionner, croailler, colériser, ultième, courre, décousure, mutité, surrection, charogner, encolérer, irrassasié, géniture, vacarmer, falaiseux, larmer, passée, récifal, cimetièral, inexister, apâli, plumifère, ondant, cortéger, inemploi, néantes, chaoticien,…) que peut s’opérer au fil des pages l’appréhension du monde flottant qui est ici l’enjeu de toute magie analytique.
Non pas un bardo volodinien, mais un ukiyo, et pour tenter de saisir ce monde flottant, le cheminement des artistes a autant d’importance – ou davantage – que leurs œuvres proprement dites : c’est ainsi que l’air guitar et les musiques fantômes, sans instruments, comme en écho au « Manger fantôme » de Ryoko Sekiguchi, peuvent pleinement jouer leur rôle, dans la fiction comme auprès de nous, lectrice ou lecteur. Les riches lectures des œuvres antérieures de Pierre Cendors effectuées par ma collègue et amie Marianne, sur ce même blog, que ce soit celle de « L’homme caché » (2006), d’« Engeland » (2010) ou des « Archives du vent » (2015) – et de son proto-making of en parallèle, « L’invisible dehors »), comme, presque paradoxalement, les boucles hypnotiques du Gabriel Josipovici de « Goldberg : Variations », pointaient dans une direction presque indicible, aujourd’hui, celle qu’exprime avec une ferveur éblouissante cet « Énigmaire » : c’est bien notamment par le parcours discret – voire secret – d’artistes réels et, plus encore, d’artistes imaginaires, que peut se conjurer, encore et encore, l’interrogation fondamentale de Theodor W. Adorno sur la possibilité de la poésie (et de l’art) après Auschwitz (ici, en l’espèce, après Ravensbrück), et que prend tout son sens la citation centrale, rappelée ailleurs aussi par le grand Hans Magnus Enzensberger, attribuée au général Hammerstein dont les filles étaient totalement engagées dans la résistance anti-nazie, sous sa bienveillante ignorance : « La peur n’est pas une vision du monde ». Et c’est ainsi que Pierre Cendors, dans la solide dureté d’une prose poétique à facettes, nous autorise un réenchantement aussi secret que d’abord improbable.
Ce n’était ni la séduction sombre qu’offrait une sépulture paysagère, ni le sortilège du rien – cette ultième illusion du désillusionné – pas plus que la fascination initiale que L’Énigmaire continuait d’exercer sur moi. C’était autre chose, de plus obscur, une notule au bas d’une page, quelques mots dans un journal, qu’il m’avait fallu relire à plusieurs reprises avant de comprendre que je n’y parvenais pas, c’était inutile, une partie de ma pensée, la partie louve, courrait ailleurs, avec ce bout de phrase dépassant de sa gueule.
Pierre Cendors - L’Enigmaire - Quidam éditeur
Hugues Charybde le 15/02/2021
l’acheter ici
Pierre Cendors