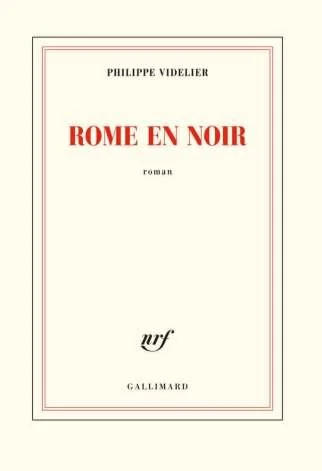Rome au pas mussolinien, par Philippe Videlier
Treize ans de fascisme italien dévorés avec un humour tragique dans les pas des coupables putatifs de l’assassinat d’un jeune boxeur lié au régime mussolinien.
Lyon, 1932. Alors que l’Italie fasciste est au sommet de sa gloire nationale et internationale, un jeune espoir de deuxième ou troisième rang de la boxe, lointain chouchou du régime, vivant au sein de la puissante communauté émigrée du Rhône français, est brutalement assassiné au pistolet dans une guinguette populaire de Villeurbanne. Il ne faut que quelques heures pour que la Sûreté française, désireuse de plaire à son homologue transalpine et de châtier comme il se doit les remuants milieux ouvriers socialistes et communistes, et l’OVRA, police politique mussolinienne, se lancent à corps perdu dans une enquête destinée à fournir rapidement des coupables.
La boxe avait ses avantages, mais aussi ses limites lorsque se présentait un client récalcitrant. Ainsi, les incidents survenus à Bologne avaient de quoi rendre moroses les plus convaincus. Un chef d’orchestre mince comme un fil refusait de se rendre aux arguments contondants sous prétexte qu’il avait dirigé Aida à Buenos Aires et La Traviata à la Scala. Ce n’était pas la Lune, pourtant, Saturne ou Jupiter, qui lui était réclamé, mais juste quelques notes en ouverture de son concert, juste jouer les premières mesures de Giovinezza, l’hymne gai du Parti, pour faire plaisir à Son Excellence le comte Ciano, gendre du Duce et homme de goût, présent dans la salle. Giovinezza, giovinezza, primavera di belleza – Ah, « Jeunesse, jeunesse, printemps de beauté… », ce n’était pas trop demander, ce n’était pas la mer à boire, ni même un flacon d’huile de ricin. Mais Arturo Toscanini, pincé comme jamais, avait regardé de haut les solliciteurs inconscients, il les avait toisés avec un je-ne-sais-quoi de vexant dans la repartie : « Vous êtes fous, je ne joue que de la musique. » Ils avaient insisté, poussant la conciliation jusqu’à renoncer à Giovinezza, pourvu qu’au moins le musicien consente à accompagner la Marche royale. Rien n’y fit. Même la Marche royale, il n’en voulait pas. Toscanini n’admettait que Wagner ou Verdi. Aucune pression, aucune menace verbale ne le faisait plier. Ne restaient plus de l’avis général que les coups de poing dans la figure. Cela, contre toute attente, ne donna aucun résultat. Il n’était pas envisageable néanmoins de revenir aux méthodes anciennes, aux recettes primitives essayées sur le député socialiste Matteotti qui avaient coûté trop cher au Régime.
Docteur en histoire, chercheur au CNRS spécialiste des migrations, des villes ouvrières et des cultures populaires, Philippe Videlier nous a déjà proposé de magnifiques aventures littéraires, par exemple avec l’énorme « Dîner de gala – L’étonnante aventure des Brigands Justiciers de l’Empire du Milieu » (2012), racontant la prise du pouvoir par Mao Zedong à la manière d’un grand roman épique classique de la littérature chinoise, ou avec le recueil des malicieuses « Dernières nouvelles des bolcheviks » (2017). En construisant son nouveau roman, « Rome en noir », publié chez Gallimard en janvier 2020, autour de la poignée de coupables présumés d’un règlement de comptes jamais vraiment élucidé, il nous offre avec une grande habileté littéraire une plongée alerte dans les spécificités du régime fasciste italien, entre 1932 et 1945. Le régime mussolinien, comme cela a été maintes fois noté par les historiens mais plus encore par les artistes, en Italie ou ailleurs, présente en effet un mélange rare en politique, à un tel degré, d’association étroite de la farce et de la tragédie, dualité fondamentale que l’écriture adoptée par l’auteur, en continuité avec ses approches précédentes mais évoquant désormais encore davantage, par sa somptueuse ironie, celle du Éric Vuillard de « Congo » ou de « L’ordre du jour », reflète avec ruse et presque perfection.
Tout le monde se souvenait de Giacomo Matteotti, de la façon dont il avait disparu, un jour, sur le chemin du Parlement, enlevé par un groupe de Chemises noires, de squadristes. Tout le monde s’en souvenait, mais personne ne se risquait plus à en parler, ou seulement à voix basse. Il était établi que le député socialiste était sorti de chez lui aux alentours de seize heures trente, qu’il n’avait en poche que dix lires de monnaie mais qu’il était porteur d’un épais dossier à ne pas mettre entre toutes les mains. Il y eut peut-être trois témoins de la scène quand au moins cinq hommes se précipitèrent sur lui et le poussèrent dans une automobile qui fila à toute vitesse. Ce pauvre Matteotti, on l’avait retrouvé le visage écrasé dans la glaise, un matin, et il n’était pas beau à voir. C’était le chien du brigadier Caratelli, racontait-on, qui l’avait flairé sous la mousse. D’abord, Trapani, le chien, était tombé sur deux os, une omoplate et un fémur auquel restaient attachés des lambeaux de chair desséchée, puis il avait découvert la partie principale du corps en décomposition. Sans la dent en or de la mâchoire supérieure gauche, un spécialiste de médecine légale n’aurait pu dire qu’il s’agissait du député. Le cadavre avait une lime quadrangulaire fichée dans la poitrine. Certains, pour qui le dénigrement était une seconde nature, avaient bassement profité de la situation. « Voyez le fascisme assassin ! » criaient-ils sur tous les tons, à gauche, à droite, en Europe et à la Société des Nations. « Voyez le fascisme criminel ! » Il se trouvait des gens en assez grand nombre, ici et là, pour prêter l’oreille, pour froncer les sourcils, pour changer de trottoir quand ils croisaient une Chemise noire. Le Duce, Benito Mussolini, avait traversé des moments fort difficiles. Il était à plaindre, ses nuits, ses jours n’étaient que tracas, soucis et contrariétés. La presse, au début, lui tombait dessus, lui manquait de respect, le traitait comme un malfrat. Matteotti par-ci, Matteotti par-là, Frinche, frinche, frinche, Mamma mia, tralala lalala. Mais lui aussi connaissait la musique. Il avait repris du poil de la bête. Il avait muselé la presse, et la presse, courageuse mais pas téméraire, s’était peu à peu accoutumée à la laisse et à la muselière. Dans son immense cabinet romain donnant sur la place San Marco, Mussolini recevait aimablement les plus grands journalistes de l’étranger : « Comment allez-vous ? minaudait-il, quel bon vent vous amène ? »
Au pas de course et armé d’un sourire trompeur, Philippe Videlier nous emmène au cœur de l’étonnante complaisance généralisée de l’époque, allant de la basse flatterie à la sincère admiration, vis-à-vis du fascisme, au nom de l’anti-communisme et des intérêts gouvernementaux bien compris, alors que les ors et les fastes désarment à peine encore le sens du ridicule, mais nous emmène aussi du côté de la xénophobie scientifique et de la xénophobie populaire, des guerres d’agression coloniales et européennes, en Libye, en Éthiopie (on songera à Carlo Lucarelli et à sa « Huitième vibration »), en Albanie ou en Grèce, à l’implication mussolinienne de moins en moins discrète dans la guerre d’Espagne (ce qui nous permettra d’ailleurs de croiser Max Aub, en relégation aux confins du Maroc et de l’Algérie avec l’un des protagonistes du roman), et aussi, douloureusement, dans la formidable division des gauches et des mouvements ouvriers face aux montées des périls (comme le constatait alors, poignant et lucide, le Daniel Guérin de « La peste brune »). Une belle réussite aux carrefours de la grande et de la petite Histoire, dans les imbroglios des occasions perdues et des vengeances tardives.
La police de Bocchini avait des noms, des adresses. Les subversifs se divisaient en plusieurs catégories également dangereuses : les communistes orthodoxes, sans surprise, les communistes dissidents, éparpillés en chapelles innombrables, prométhéistes, pappalardiens, les socialistes ratiocineurs, toutes tendances confondues, les anarchistes, violents en paroles, les républicains au verbe anticlérical et les giellistes – les adhérents de Giustizia e Libertà -, derniers apparus dans la cour de l’opposition, agressifs en diable, imprévisibles. Cela faisait du monde à surveiller. La police ne manquait pas de personnel. Elle recrutait à tout-va des bureaucrates à horaire fixe, des agents stipendiés en imperméable, des indicateurs à la petite semaine, de gros poissons intellectuels. Elle faisait miroiter la stabilité de l’emploi et, si nécessaire, usait du chantage. L’appât du gain, une bêtise ancienne, une famille à protéger, les vieilles recettes marchaient à fond. Des indicateurs, il s’en trouvait dans tous les partis, qui ouvraient l’œil et le bon, tendaient l’oreille, transmettaient des documents utiles et inutiles, vendaient leurs amis pour un rien, touchaient des subsides du ministère de la Culture populaire. La police ne chômait pas. Elle accumulait. Mais elle n’avait pas les mains libres à l’extérieur. Pas autant du moins qu’elle l’aurait voulu.
Philippe Videlier - Rome en noir - Gallimard, collection Blanche
Hugues Charybde le 8/05/2020
l’acheter chez Charybde ici
Philippe Videlier.