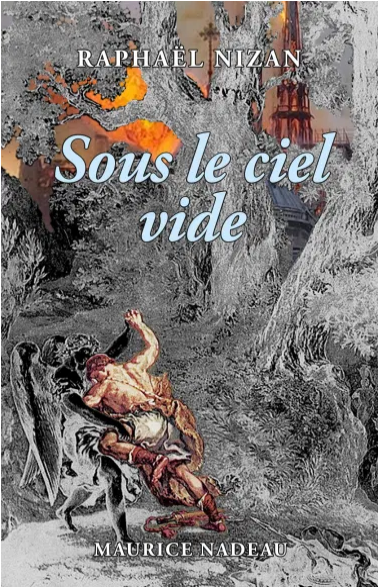L'amour fou dans la nuit parisienne de Raphaël Nizan
Une envoûtante descente amoureuse aux enfers des nuits glauques et de la dèche, proposée en une langue rare, hypnotique et acharnée.
Le 15 avril 2019, Notre-Dame flambait. Notre-Dame flambait, et moi, seul, les pieds ancrés sur l’asphalte graisseux d’un trottoir parisien, la gorge irritée par les fumées âcres qui se dégageaient du brasier, je ne pensais qu’à la dernière fois où j’y étais monté, vingt-neuf ans plus tôt, avec ma belle Ayla. Je pensais à ce jour-là, soixante-neuf mètres plus près du ciel, à l’amour fou qui nous liait et au désespoir tout aussi fou qui nous rongeait. Ce livre est tout ce qu’il m’en reste, tout ce que je ne voudrais pas, sans doute illusoirement, qu’il s’en perde, au milieu de la fureur et du bruit.
En forme de prière d’insérer glissé presque subrepticement par l’auteur sur le rabat de la troisième de couverture, ces neuf lignes tracent la voie étroite et cruelle du souvenir d’une véritable descente aux enfers, pourtant curieusement magnifiée et poétisée, sans aucune complaisance néanmoins, par un fort original regard sur le monde et par la langue décalée qui s’en empare.
Années 1990. Un jeune Parisien et une jeune Parisienne – mais ils pourraient bien, s’il n’y avait la silhouette de Notre-Dame sur leur horizon bouché, être de partout où il y a une métropole suggérant ces années-là de vivre fort, de vivre vite : danser sous les bombes, déjà. L’amour fou, le vrai, celui qui propulse et qui renvoie tout au deuxième rang ou beaucoup plus loin. Le sexe en sur-régime. La rupture de ban, diablement consommée, avec des familles nanties et toxiques. La spirale sans fin des excitants de toute nature et des expédients de plus en plus dangereux pour se les payer.
Contrairement à ce tragique 15 avril 2019 qui avait vu la grande dame s’effondrer sur elle-même dévorée par les flammes, au printemps 1990, lorsque nous avions gravi une à une les quatre cent vingt-deux marches de la tour nord, le ciel gris pesait sur Paris et sur nos têtes, comme le spleen baudelairien sur le crâne incliné du poète que je lisais et relisais en boucle, creusant ma douleur sans relâche, ne le délaissant que pour les chants du montévidéen, l’un remplaçant l’autre dans ma poche, même lorsque je n’arrivais plus à les lire, les yeux vitrifiés par la quantité industrielle de shit que nous consommions du matin au soir et du soir au matin avec la frénésie des affamés se jetant sur leur premier repas servi après des jours de jeûne. C’était d’ailleurs le prétexte qui nous avait convaincus de tenter l’ascension du beffroi malgré notre état de fatigue avancée, de nous fumer un gros spliff bien chargé en dominant cette ville où nous errions depuis des mois et qui nous rejetait sans cesse à la rue, amants maudits seulement préoccupés par nos recherches de came et les moyens de la financer. Ayla s’était fait virer de chez elle après que sa mère avait découvert qu’en plus de son argent de poche déjà très conséquent, sa fille tapait dans l’enveloppe toujours pleine du liquide que rapportaient ses transactions de bijoux plus ou moins légales qu’elle cachait dans le salon télé du penthouse de la rue Magellan. Moi, il y avait longtemps que l’appartement familial ne me servait plus que d’adresse officielle. Quatre ans pour être précis, depuis le milieu de l’année 1986, lorsque la violente dépression de mon jeune frère, les coups rageurs de ma mère et la lâcheté de mon père m’avaient peu à peu et conjointement jeté dans les bras des marges qu’incarnaient alors les bandes de chasseurs de fafs qui pullulaient dans mon lycée. J’avais treize ans et demi et je m’étais également mis à fumer mes premiers joints que nous allions rouler et partager dans le square au bout de la rue de Seine ou le petit jardin de la rue Visconti, le soir après les cours où je continuerai encore d’aller à peu près régulièrement jusqu’au mois d’octobre de la même année. C’est à cette période que je m’étais rasé la tête en n’y laissant qu’une mèche en forme de houppette au sommet, mis à porter mes premiers jeans retroussés sur mes paires de docks coquées, à arborer fièrement mon Teddy ou mon Harrington brochés de pins explicites qui étaient censés marquer mon appartenance aux courants combattants de la gauche radicale et de la mouvance anarchiste, bien trop inculte pour savoir ce qui pouvait les différencier, pire, ce qu’il pouvait y avoir d’absurde à accoler la batte et la faucille et le A noir cerclé, ma seule et unique obsession tenant à afficher mon rejet absolu et définitif des racistes du GUD qui descendaient régulièrement nous dépouiller à la sortie du bahut les samedis midi, en ce début d’année 1986 qui, je ne le savais pas encore, marquerait la fin de leur domination sur le cœur de Paris. Mais au printemps 1990, il y avait longtemps que j’avais laissé tous ces engagements derrière moi pour leur préférer le rêve alambiqué et brumeux d’une osmose sexuelle universelle et éternelle, au rythme des beats électriques et hallucinés qui nous arrivaient de Detroit et depuis peu de la nouvelle Berlin réunifiée.
On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans, mais, même lorsqu’on ne fait pas totalement foin de ce qui tient lieu de bocks et de limonade, la vie matérielle est là, aux aguets, prête à fondre en un instant sur les idéaux et sur les illusions. « Sous le ciel vide », publié aux éditions Maurice Nadeau en septembre 2020, aurait pu être une variation sur bien des nuits fauves vintage, sur de possibles contraposées au « Fasciste » de Thierry Marignac, sur d’éventuelles mutations de jeunes hommes chic, mais la narration fiévreuse de Raphaël Nizan dépasse subtilement ces comparaisons éventuelles en maîtrisant le charme particulier de la littérature qui ne se contente pas d’être gonzo : en jouant de références littéraires disséminées qui sont loin ici d’être purement décoratives (on songera, comme chez le Joseph Ponthus de « À la ligne – Feuillets d’usine », à la manière dont elles constituent une armature souterraine et vitale au récit d’une lutte quotidienne), en développant une langue curieusement raffinée, où d’inventives claudications de syntaxe ou de vocabulaire créent la magie de l’étrangeté (le « D’asphalte et de nuée » de Nicolas Rozier n’est paradoxalement peut-être pas si loin), l’auteur mystérieux nous offre un texte rare, hypnotique et envoûtant dans son incroyable litanie d’un désastre annoncé, vécu et en quelque sorte surmonté, par des moyens inattendus.
Et dans le fond, avais-je tenté de dire à ma belle russophile en rentrant, ce gamin de vingt-cinq ans qui avait essayé de m’expliquer la nuit durant la parfaite cohérence de son ambition d’imiter les Beatles avec son groupe de rock de l’université où il étudiait les sciences politiques, son nécessaire pèlerinage à cheval jusqu’à Serguiev Possad, le réel respect de sa compagne que constituait le lampage de shots de tequila sur le pied nu de la barmaid en attendant que la grande Russie n’ait enfin réglé la question de l’Est en reprenant Sainte-Sophie aux Ottomans, lui qui ne dépareillait en rien de cette jeune femme aux cheveux mauves, piercée et tatouée qui avait déboulé sur son skate, dans son baggie trop large, à l’angle de la rue de mon hôtel à Saint-Pétersbourg, en laissant derrière elle la criarde clarté de l’une de ces enseignes américaines, c’était ça l’impression étrange que m’avait laissée la Russie, ce cocktail improbable de culture yankee, de soumission au soft power du vieil ennemi tout en clamant sa résistance, son patriotisme et le renouveau de sa très orthodoxe piété encouragée à grand renfort de contrat public-privé, par l’indéboulonnable seigneur du Kremlin que je n’avais pu m’empêcher de revoir tout au long du séjour, chevauchant crânement la Harley Davidson prêtée par les Loups de la nuit, la horde de bikers dirigée par Alexander Zaldostanov et conjointement parrainée par le patriarche de l’Église orthodoxe et Vladimir Poutine lui-même.
Absurdité d’un monde où plus personne n’entendait faire de choix, ni incarner quoi que ce soit, sauf la représentation éclatée et multiple d’une image composite de soi, réalisée avec n’importe quelle application permettant cela sur Instagram. Qui suis-je ? Ça, son contraire et le reste, le puzzle de symboles quêtés de-ci de-là, au gré de mes errances virtuelles et agrégées via Layout dans l’ignorance volontaire la plus totale. Ce que, dans le fond, laissait déjà entendre d’elle-même la révolte jaune le premier samedi de novembre, comme cette Russie moderne d’où je revenais et tous ces profils Facebook, Twitter ou Instagram qui défilaient depuis douze ans sur les écrans de mon ennui, le fruit d’une consommation compulsive guidée par la seule inquiétude de n’avoir pas tout.
« De n’avoir pas tout, en même temps, comme ne cessait de le clamer à tout va le jeune président de la République française qui ne voyait d’autre issue aux profondes fractures qui morcelaient ce pays que l’accomplissement consumériste total, au mépris de l’agonie d’une planète qui semblait pourtant ne plus être un secret pour personne et de cette absence dramatique de sens, ce vide au bord duquel nous dansions encore avant de tomber.
On peut écouter Arnaud Laporte en parler superbement dans « Un livre, un jour » (ici). Je dois surtout remercier chaleureusement Delphine Chaume (qui l’évoque magnifiquement sur sa page Twitter, ici) pour cette découverte.
Raphaël Nizan - Sous le ciel vide - éditions Maurice Nadeau
Hugues Charybde le 30/11/2020
l’acheter chez Charybde ici