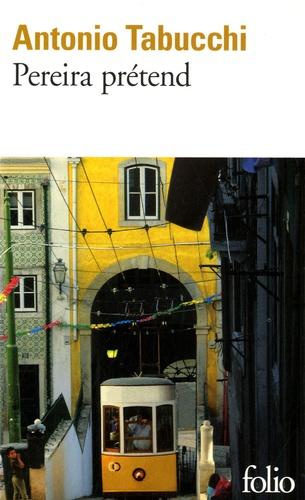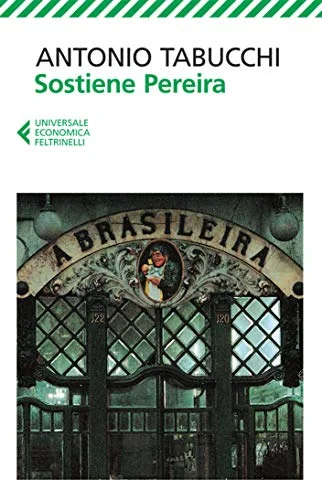Refuser la dictature avec Antonio Tabucchi et “Pereira Prétend”
Dans le cadre historique du Portugal de 1938, l’un des plus beaux romans qui soient, sous son apparente simplicité, sur, entre autres, le refus de voir une dictature pour ce qu’elle est, et sur les modalités des yeux qui se dessillent.
Pereira prétend avoir fait sa connaissance par un jour d’été. Une magnifique journée d’été, ensoleillée, venteuse, et Lisbonne qui étincelait. Il semble que Pereira se trouvait alors à la rédaction, il ne savait que faire, le directeur était en vacances, son souci consistait à devoir monter la page culturelle, parce que le Lisboa avait dorénavant une page culturelle, dont on lui avait confié la responsabilité. Et lui, Pereira, réfléchissait sur la mort. En ce beau jour d’été, avec la brise atlantique qui caressait la cime des arbres, avec le soleil qui resplendissait, et une ville qui scintillait, oui, qui scintillait littéralement sous sa fenêtre, et un ciel bleu, un ciel d’un bleu jamais vu, prétend Pereira, d’une netteté qui blessait presque les yeux, il se mit à songer à la mort ? Pourquoi ? Cela, Pereira ne saurait le dire. Peut-être parce que, dans son enfance, son père avait eu une agence de pompes funèbres qui s’appelait Pereira La Douloureuse, ou peut-être parce que sa femme était morte de phtisie quelques années auparavant, ou encore parce qu’il était gros, souffrait du cœur, avait une pression artérielle trop haute, et que le médecin lui avait dit que s’il continuait comme ça il ne lui resterait plus longtemps à vivre, le fait est que Pereira se mit à songer à la mort, prétend-il. Et par hasard, par pur hasard, il commença de feuilleter une revue. C’était une revue littéraire, qui avait aussi cependant une section de philosophie. Peut-être une revue d’avant-garde, Pereira n’en est pas sûr, mais qui avait beaucoup de collaborateurs catholiques. Et Pereira était catholique, ou du moins se sentait-il catholique à ce moment-là, un bon catholique, quoiqu’il y eût une chose à laquelle il ne pouvait pas croire : à la résurrection de la chair. À l’âme oui, certainement, car il était sûr d’avoir une âme ; mais la chair, toute cette viande qui entourait son âme, ah ! non, ça n’allait pas ressusciter, et pourquoi aurait-il fallu que cela ressuscite ? se demandait Pereira. Toute cette graisse qui l’accompagnait quotidiennement, et la sueur et l’essoufflement à monter les escaliers, pourquoi tout cela devrait-il ressusciter ? Non, de ça, dans une autre vie, pour l’éternité, il n’en voulait plus, Pereira, et il ne voulait pas croire à la résurrection de la chair. Il commença ainsi de feuilleter la revue, dans l’indifférence, parce qu’il s’ennuyait, prétend-il, et il découvrit un article qui disait : « À partir d’un mémoire soutenu le mois dernier à l’Université de Lisbonne, nous publions une réflexion sur la mort. L’auteur en est Francesco Monteiro Rossi, qui a obtenu sa maîtrise en philosophie avec la note maximale. Il ne s’agit ici que d’un extrait de son travail, dont nous publierons peut-être d’autres pages dans un proche avenir. »
Paisible personnage féru de littérature française du XIXème siècle et d’omelettes à toute heure, vivant largement dans un certain passé d’avant son veuvage – il parle régulièrement à la photographie de sa défunte épouse, le gras et cardiaque Pereira, après des années passées à traquer les faits divers dans un grand quotidien lisboète, est devenu le chef et l’unique employé de la toute nouvelle rubrique littéraire d’un hebdomadaire catholique ambitieux. En cette année 1938, alors que la guerre civile fait rage chez le voisin espagnol, le Portugal semble couler des jours tranquilles sous la férule de l’Estado Novoinstitué en 1933 avec la remise des pleins pouvoirs au président du Conseil des ministres, Antonio de Oliveira Salazar. Jusqu’au jour où, en croisant le chemin d’un jeune couple d’étudiants cherchant à placer quelques chroniques littéraires pour survivre, puis d’un médecin psychologue instillant en lui la possibilité théorique de composantes multiples de la personnalité, dont le centre de gravité pourrait bouger avec le temps, Pereira se met à voir, à changer, et peut-être bien, in fine, à agir, à son échelle.
Pereira prétend que, cet après-midi là, le temps changea. Soudain la brise atlantique cessa, un épais rideau de brume arriva de l’océan et la ville se trouva enveloppée dans un suaire de chaleur. Avant de sortir de son bureau, Pereira regarda le thermomètre qu’il avait acheté à ses frais et qu’il avait suspendu derrière la porte. Il indiquait trente-huit degrés. Pereira éteignit le ventilateur, rencontra la concierge dans les escaliers, qui lui dit au revoir doutor Pereira, il flaira une fois encore l’odeur de friture qui flottait dans la cour et, finalement, il sortit à l’air libre. Devant la porte d’entrée se trouvait le marché du quartier, deux camionnettes de la Guarda Nacional Republicana y étaient stationnées. Pereira savait que le marché était en agitation, car le jour d’avant, dans l’Alentejo, la police avait tué un charretier qui était un des fournisseurs du lieu et qui était socialiste. C’est pour cela que la Guarda Nacional Republicana stationnait devant les grilles du marché. Mais la direction du Lisboa n’avait pas eu le courage de passer l’information, c’est-à-dire le vice-directeur, car le directeur était en vacances, il était au Buçaco, pour jouir de la fraîcheur et des eaux thermales et, de toute façon, qui aurait pu avoir le courage d’informer qu’un charretier socialiste avait été massacré sur sa charrette dans l’Alentejo et qu’il avait couvert de sang tous ses melons ? Personne car le pays se taisait, il ne pouvait pas faire autrement que se taire, et pendant ce temps les gens mouraient et la police agissait à sa guise. Pereira commença de transpirer, parce qu’il songea de nouveau à la mort. Et il se dit : cette ville pue la mort, toute l’Europe pue la mort.
Publié en 1994, et traduit en français en 1995 par Bernard Comment chez Christian Bourgois, ce roman d’Antonio Tabucchi, le plus portugais des écrivains italiens (comme le rappelait délicieusement Roberto Ferrucci dans son « Ces histoires qui arrivent »), survient dix ans après « Nocturne indien » et huit ans après « Le fil de l’horizon », jusqu’alors les romans les plus célébrés de l’auteur. Lauréat à la fois du prix Campiello et du prix Viareggio, ce roman discret d’ouverture à la vision de ce qu’est, en pratique, une dictature, deviendra ainsi le plus récompensé de tous les textes d’Antonio Tabucchi. Adapté au cinéma par Roberto Faenza dès 1995 (avec Marcello Mastroianni dans le rôle-titre) et en bande dessinée par Pierre-Henry Gomont en 2016, ce roman aux faux airs placides (comme son personnage central) est sans doute l’un des plus puissants de l’auteur, où la ruse narrative, avec l’usage volontairement immodéré de cette formule qu’est « Péreira prétend », répétée souvent plusieurs fois par page, connote inévitablement l’interrogatoire policier, le compte-rendu juridique de quelque procès, voire le témoignage auprès d’un auditoire ou d’un lectorat résolument incrédules. Peu de textes auront su avec autant de talent donner à ressentir et à penser ce qu’est une dictature parée des apparences de la démocratie, ce que le Portugal de Salazar fut très effectivement de 1933 (au bas mot) à 1974, et de ce que les « braves gens » veulent en voir ou ne pas voir, selon ce qui les arrange à un moment donné. Et c’est ainsi bien entendu que la littérature, déguisée ou non en roman historique, conserve, hélas et heureusement, toute son actualité alors que les décennies ou les siècles passent.
Péreira prétend que, ce soir-là, la ville semblait aux mains de la police. Il y en avait partout. Il prit un taxi jusqu’au Terreiro do Paço où, sous les portiques, se trouvaient des camionnettes et des agents armés de mousquetons. Peut-être avaient-ils peur de manifestations ou de rassemblements sur la place, raison pour laquelle ils occupaient les points stratégiques de la ville. Il aurait voulu poursuivre à pied, parce que le cardiologue lui avait qu’il lui fallait du mouvement, mais il n’eut pas le courage de passer devant ces militaires sinistres, et prit donc le tram qui parcourait Rua dos Fanqueiros pour aboutir à Praça de Figueira. Il descendit là, prétend-il, et trouva d’autres policiers. Cette fois il dut passer devant les détachements, et il en éprouva un léger malaise. En passant, il entendit un officier qui disait aux soldats : et souvenez-vous, les garçons, que les subversifs sont toujours aux aguets, il est bon de garder les yeux ouverts.
Antonio Tabucchi
Antonio Tabucchi - Pereira Prétend - Folio/Gallimard,
Charybde2, le 24/04/19
L’acheter ici