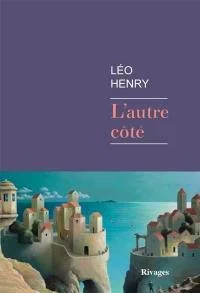L'Autre côté ou dans l'enfer du décor avec les réfugiés par Léo Henry
Fuir. Émigrer. Passer de l’autre côté. Avec de vrais ou de faux papiers. Dans la légalité idéale ou dans l’illégalité nécessaire. Pour mieux saisir l’envers du décor des réfugiés, plongez dans “L’Autre côté”, le dernier roman de Léo Henry, une superbe fable réaliste et intense.
Fuir. Émigrer. Passer de l’autre côté. Avec de vrais ou de faux papiers. Dans la légalité idéale ou dans l’illégalité nécessaire. Avec son compère Jacques Mucchielli, Léo Henry avait déjà exploré soigneusement certaines ramifications fictionnelles possibles de la réalité de l’exil (« Tadjélé », 2012), dans l’univers imaginaire bien spécifique de leur Yirminadingrad. Sept ans après, et à peine un an après l’impressionnant « Hildegarde », le voici de retour avec un court roman, « L’autre côté », publié chez Rivages en février 2019, poétique et incisif, saisissant à bras-le-corps les méandres du fait migratoire contemporain, concret, en à peine 110 pages, mais en utilisant toutes les subtiles ressources de la métaphore et du décalage pour faire saisir ici, mieux que bien des récits ou des essais, certaines choses essentielles.
Certains disent de Kok Tepa qu’elle est la plus ancienne ville du monde. Il est difficile de savoir si c’est vrai. Les Moines, gardiens des traditions et des récits, sont aussi les détenteurs du pouvoir temporel sur la cité, et ils ont toute latitude pour tourner l’histoire à leur avantage. Même chose pour les formules de l’immortalité, prétendument offertes par les dieux aux habitants de Kok Tepa il y a dix fois mille ans, en récompense d’un sacrifice oublié.
Kok Tepa, cité sainte, juste parmi les justes.
Kok Tepa, ombilic de la foi.
Kok Tepa, rétine de l’œil divin.
Etc.
Rostam s’est fait une raison : il ne saura jamais ce qu’il en est réellement. Il connaît assez bien les basses castes pour être familier de leur piété, faite de fatalisme et d’un goût profond, presque déraisonnable, pour la complexité et la multiplicité des rituels. Mais il a aussi assisté à suffisamment de cérémonies au Dilgûsha pour ne rien ignorer du rapport érudit et cynique que les Moines ont à leurs traditions, de leur penchant pour le pouvoir et l’arbitraire.
Aux yeux de Rostam, une chose demeure certaine : quand le soleil décline sur le haut-plateau, au-delà des frontières de la ville, vers six heures du soir, et que la brise du nord se prend à souffler, purgeant les fumées et les miasmes, Kok Tepa est le plus bel endroit sur terre.
La théocratie de Kok Tepa, cité-état millénaire et rutilante, dépositaire d’un secret convoité de l’immortalité, vit largement coupée physiquement du monde : une maladie endémique au traitement complexe et coûteux y règne, imposant un contrôle sanitaire rigoureux aux voyageurs, tandis qu’un système de castes régit non seulement la société dans son ensemble, mais tout particulièrement l’accès aux médicaments importés, seuls susceptibles d’enrayer le développement de la maladie chez les personnes atteintes. De ce fait, hors de la caste dirigeante, le seul salut pour celles et ceux qui auraient contracté la maladie (potentiellement toutes et tous, tôt ou tard) est dans l’émigration. Émigration nécessairement clandestine et compliquée, car les pays de l’Outre-Mer, où les traitements seraient disponibles, ont encerclé Kok Tepa et les pays avoisinants, où la maladie pourrait se mettre à rôder à son tour, d’un système de quarantaine réputé imperméable ou presque, que seules des filières de passeurs et de relais permettent de contourner, à prix d’or. Le héros de Léo Henry, Rostam, est l’un des principaux organisateurs, à Kok Tepa, de ces filières secrètes d’évasion vers la possibilité du soin.
Nisa enserre de ses deux mains les grands verres de bière noire et amère, puis les vide posément, l’un après l’autre. C’est une bonne buveuse. Elle fixe Rostam sans pudeur, de ses yeux transparents et curieux. Elle le fait parler.
Ils sont dans une cave des bas quartiers, le troisième bar depuis le début de la virée. L’espace est étroit, les tables rapprochées, les clients s’expriment fort et jettent haut leurs osselets, qui retombent en crépitant sur la feutrine usée des dessus de table. Il faut se pencher l’un vers l’autre pour s’entendre.
« De ce côté du mur, la tradition fixe la séparation des populations en castes héréditaires. Les Guerriers, les Commerçants et les Paysans sont considérés comme à peu près égaux et peuvent entretenir des échanges. On peut commercer, conclure des contrats, se marier entre nous. On peut même parfois choisir la caste de nos enfants. Les Moines, eux, restent à part. Ils ont la charge du pouvoir spirituel et temporel et sont soumis à d’autres règles. Comme ils sont dépositaires des formules d’immortalité, ce sont eux qui se partagent les traitements venus de l’Outre-Mer.
– Et personne ne leur conteste ce privilège ?
– Les conditions sanitaires de Kok Tepa condamnent la cité à l’autarcie. Nous importons la moitié de notre nourriture et presque tout notre équipement. Les Moines gèrent les relations extérieures, ce sont eux qui tiennent la ville. Et vu qu’ils sont les gardiens des traditions religieuses, remettre leur autorité en cause est absolument impensable pour mes concitoyens.
– Tu ne te comptes pas dans leur nombre ? »
Rostam boit au lieu de répondre. À sa grande surprise, il aime la franchise de l’Ambassadrice. Il aime se sentir embarrassé à chaque nouvelle question qu’elle pose.
Léo Henry lance son aventure de main de maître, en déjà vieux routier de l’imaginaire (science-fiction, fantastique ou transfiction du meilleur calibre), familier de la forme courte (il faut lire les textes de « Le diable est au piano »ou de « Point du jour »), et capable ainsi de camper en quelques pages un décor d’une extrême densité, sans fioritures inutiles et pourtant riche déjà en résonances potentielles. C’est lorsque Rostam, forcé d’organiser sa propre émigration clandestine, avec sa femme et sa fille qui vient de contracter la maladie, bascule de l’autre côté du miroir, que la machine infernale de Léo Henry s’emballe et déchaîne toute la puissance de l’usage rusé de la métaphore littéraire (poussée avec cohérence à son extrême) et du récit ancré dans l’imaginaire. Il rejoint ici en l’amplifiant l’indispensable appropriation de la migration contemporaine par la littérature, de la farce échevelée de Vladimir Lortchenkov (« Des mille et une façons de quitter la Moldavie », 2008) à la fable urbaine et réaliste de Denis Lemasson (« Nous traverserons ensemble », 2016), du témoignage picaresque d’Andreï Ivanov (« Le voyage de Hanumân », 2010) au vertige presque métaphysique de Laurent Kloetzer (« Issa Elohim », 2018), de la beauté complexe de Serge Quadruppani (« Les Alpes de la Lune », 2000) à la poignante tentative de compréhension d’un fait divers d’Arno Bertina (« Numéro d’écrou 362573 », 2013), de l’humble transfiguration du réel de Velibor Čolić (« Manuel d’exil », 2016) à la poésie pleine de rage d’Emmanuel Ruben (« Terminus Schengen », 2018), pour citer quelques belles réussites. Là où le récit ou le reportage, même lorsqu’ils dépassent la timidité ou la complaisance, peinent à franchir le mur blasé de l’indifférence et de la résignation, cimenté au fil du temps de phrases malheureuses (ou machiavéliques) à propos de « misère du monde », de « remplacement » ou de « terroristes infiltrés » (que la métaphore de l’imaginaire permet justement de retourner, et de renvoyer à leurs mythomanies respectives), la littérature peut fonctionner, et « L’autre côté » le démontre avec un éclat impressionnant, sans prêche et tout en poésie acérée.
Et puis, trinquant avec l’Ambassadrice, cette femme de l’Outre-Mer venue s’encanailler une nuit dans les bas-fonds de Kok Tepa, venue tourner la tête, quelques heures, aux bouseux obscurantistes de la ville sacrée, il déclare :
« Je sers de soupape à la cité. Je suis la porte de sortie officieuse. Je suis le passeur. »
Plus tard, la nuit bascule.
Nisa et Rostam, affalés dans des fauteuils de bois noir luisant, tirent sur de courtes pipes de cannabis.
Dans l’arène du grand aquarium, les poissons mâles se mordent à mort, c’est un ballet silencieux. Long froissement de voiles multicolores. Le sang, dans l’eau, dessine des précipités sombres.
Épisodiquement, avec des gestes las et lents, l’arbitre plonge une écumoire pour repêcher le corps déchiqueté d’un animal vaincu.
Léo Henry
Léo Henry - l’Autre côté - éditions Rivages
Charybde2
l’acheter ici