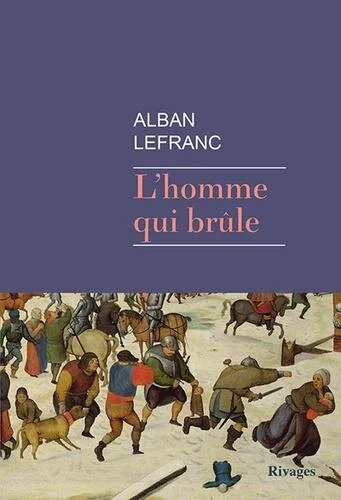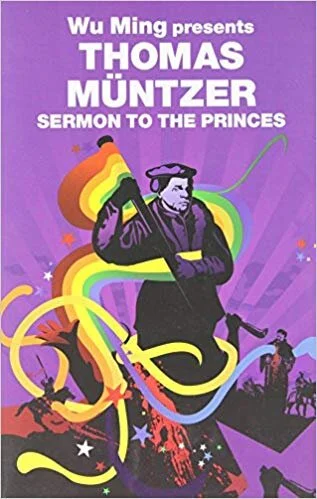L'Homme qui brûle, un livre qui reste à écrire d'Alban Lefranc…
La chronique hilarante et énervée d’une dissolution obsessionnelle, d’un engloutissement du sens dans le nombrilisme, pour mieux en faire émerger un autre rapport de l’esprit et des corps souffrants.
Il ne reste rien de l’énorme cratère creusé par l’explosion. Trois pelleteuses déblaient les derniers gravats dans la rue Rambuteau. En quatre mois à peine, des escaliers mécaniques ont surgi dans le boyau de verre. Les passagers descendent à la vue de tous, presque à la verticale, de la rue jusqu’aux quais des lignes A, B et D. Des patrouilles de militaires en uniforme gris moucheté de noir examinent les bagages. J’ouvre ma sacoche. Des agents de la mairie distribuent des questionnaires « dans une démarche d’association des usagers au choix du monument commémoratif aux victimes ». Je franchis un portique de détecteur de métaux dans la chaleur écrasante. Nous ne vivons plus dans une époque mais dans un délai.
Écrivain largement confidentiel (auteur d’un texte unique consacré à Jeanne d’Arc), titulaire d’une bourse généreuse de l’Institut national du roman français, Luc Jardie travaille, à plein temps ou presque, au PROJET. Son écriture en cours, centrée sur la figure de Thomas Münzer (le prédicateur allemand révolté du XVIème siècle, celui qui hanta Friedrich Engels et Ernst Bloch, et, plus récemment, les Wu Ming de « L’Œil de Carafa » et l’Éric Vuillard de « La guerre des pauvres »), est peu à peu parasitée – ou enrichie selon le point de vue adopté – par l’irruption d’éléments obsessionnels surgissant de sa propre vie ralentie et de sa prodigieuse et éclectique culture.
J’ai apporté le livre d’Ernst Bloch que je ne peux lire qu’à la maison Heine. Ich lese Ernst Bloch im Heinrich-Heine-Haus, face à la pelouse d’un vert insolent, profonde sous le soleil dur. J’ai essayé chez moi, en vain. Sur le trajet à la rigueur, quand le wagon n’est pas trop bondé, rarement. Je pose sur la table de verre le volume, Thomas Münzer, théologien de la révolution. Thomas Münzer seul importe. Thomas Münzer, le sujet du livre. Thomas Münzer, Ernst Bloch, dans la maison Heinrich-Heine, voilà la structure, voilà la trame. Münzer, Bloch, HHH. Thomas Münzer constitue un élément essentiel, la pierre angulaire du PROJET. Il ne faut lâcher Münzer sous aucun prétexte. Quatre syllabes : Thomas Münzer. Là. J’inspire, je garde, j’expire. Je relis la quatrième de couverture.
Luc Jardie : Paul Meurisse dans L’armée des ombres (Jean-Pierre Melville, 1969)
Avec ce roman publié en août 2019 chez Rivages, son cinquième, Alban Lefranc conçoit ce Luc Jardie-ci en déconstruction soignée et terriblement ironique du marasme intérieur houellebecquien. Le « PROJET », central ici, est un texte millénariste total et largement fantasmé, restant toujours à écrire, alors qu’il absorbe des pans entiers de la culture et de la vie de l’écrivain désenchanté : sa mère abusive qui a voulu faire de lui un missile (une « brique ») tout entier voué à la réussite scolaire puis matérielle, Mavra, sa petite amie électronique rencontrée sur un quai de gare, Megan Smile, la pornstar californienne qui l’obsède davantage encore – et dont les nombreuses interviews lui fournissent son propre guide de développement personnel -, Jérôme, l’ami d’enfance, celui des bons et des mauvais coups, désormais désireux d’épouser sa dernière conquête, une escort girl de très haut vol, Jean-Pierre Melville – son « Armée des ombres » comme son « Samouraï », Henri Meschonnic et sa traduction de la Bible, Alexandre, le colocataire en voie de disparition, ou encore Woody Allen, Alfred Hitchcock, Ivan Lendl, Marc Dorcel, les TED talks, Abel Ferrara, Michel Foucault, Zozo et Zézette, Guy Debord, Carl Schmitt, Carlo Ginzburg. Et Günther Anders et « L’obsolescence de l’homme », bien sûr : « Nous ne vivons plus dans une époque mais dans un délai ».
Alain Delon dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville
Quand la voix de quelqu’un vient vous chercher dans votre refuge de la Cité internationale au milieu de l’herbe et des tilleuls pour vous dire : « On boit du Ruinart, mon pote, je suis déchiré, putain », c’est qu’il vous connaît, qu’il a des habitudes de paroles avec vous, et s’il vous connaît, vous le connaissez vous aussi, forcément, et vous l’avez rencontré, d’une manière ou d’une autre, la preuve : vous lui répondez : « Chouette, c’est cool. » Voilà des faits implacables avec lesquels il faut accepter de vivre.
Dans ce Paris gangrené par le terrorisme à grande échelle et par l’État policier qui en découle presque naturellement, tout en arpentant le quartier des Buttes-Chaumont, en flâneur ou en jogger, Luc Jardie le fictif poursuit et transforme, à grands coups de pensées et de hashtags, les quêtes du corps qu’incarnaient, chacun à leur manière, les personnages précédents d’Alban Lefranc, personnages réels mais tous hautement travaillés – au corps, précisément – : corps devenu triomphant de Mohamed Ali (« Le ring invisible », 2013), corps martyrisé de Rainer Werner Fassbinder (« La mort en fanfare », 2005), corps explosif de Maurice Pialat (« L’amour la gueule ouverte », 2015), corps diaphane de Nico (« Vous n’étiez pas là », 2009), corps « suicidé » de Gudrun Ensslin (« Si les bouches se ferment », 2006) ou corps métastasé du gourou d’Apple (« Steve Jobs », 2016).
Depuis mon texte sur maman, dont je reste persuadé qu’il m’avait été commandé par Trust qui voulait sans doute me jouer une bonne farce, LE PROJET a gagné en complexité. LE PROJET fera une large part aux millénarismes, bien sûr, car ma volonté que tout finisse, volonté à l’état le plus simple, le plus brut, volonté la moins sublimée du monde, pure pulsion du pire, a besoin de se trouver des modèles plus dignes. Thomas Münzer, sûr de l’imminence de la moisson, Thomas Münzer sans aucun rapport avec ma pulsion, Thomas Münzer me rehausse pourtant à mes propres yeux. Je me rends bien compte que maman a pris une importance croissante dans LE PROJET. Elle occupe une sorte de fonction étrange mais indéniable. Une tache indélébile, une sorte d’espèce de fonction de tache indélébile. Travailler sur Münzer pourrait éloigner maman un peu. Je vois bien que je suis presque entièrement fantôme, je ne suis pas dupe. Les mots me manquent, le vide remplit mon corps à ras bord, mais je m’efforce. Je traîne quelque chose d’humain derrière moi comme un poids mort dont je ne peux me débarrasser. À certains moments, parfois une heure ou deux d’affilée, en me privant de machine, je peux prendre des notes sur LE PROJET, dans mon cahier bleu, notes provisoirement réunies sous le titre de DONNEZ-MOI UN CORPS.
Comme une « Auberge espagnole » de Cedric Klapisch qui aurait singulièrement mal tourné (et dans laquelle Érasme aurait été subrepticement remplacé par Thomas Münzer), « L’homme qui brûle » raconte en direct et depuis l’intérieur une surchauffe, une incandescence, une dissolution et un échec. Le tour de force d’Alban Lefranc, naissant de la virtuosité de sa langue et de son agilité dans les coqs-à-l’âne apparents et les digressions qui n’en sont pas, est de s’emparer d’un morose paradigme houellebecquien (jusque dans son usage des attentats terroristes), de la tentation globale du désabusement et de la fausse cogitation tournant en rond autour d’un nombril exclusif, pour en extraire un véritable questionnement, une série d’interrogations heurtées, chaotiques, mais néanmoins orientées avec ruse, pour rejoindre peut-être, de l’autre côté du spectre, le fascinant « Un œil en moins » de Nathalie Quintane. Le sens finit bien par s’imposer de lui-même, contre toutes attentes et contre toutes projections, lorsque le vide capitaliste résiduel a été rendu parfaitement visible. Et il faut une sacrée dose de poésie rageuse et électrique, de maîtrise de la dérision et du second degré, d’art de la mise en scène et de l’abîme pour, comme ici, y parvenir avec autant de justesse.
La fille du charcutier de gros bourg avait voulu m’inscrire à des cours d’éducation physique, mais elle avait constaté avec ravissement que son rejeton n’avait pas de corps. C’est plutôt une bonne chose, cette absence de corps, avait joui vastement dans l’espace la voix de la fille du charcutier. Dans le Figaro Magazine du week-end, elle avait lu un reportage sur quatre garçons qui avaient eu leur bac avec mention très bien à Louis-le-Grand. Louis-le-Grand, à Paris, est un lycée d’élite, un établissement d’excellence suprême où les meilleurs professeurs de France enseignent à des classes extraordinairement motivées, dans des classes où brille un très beau parquet ciré. Ah ! ça ne bavasse pas dans les classes de Louis-le-Grand, ça ne flirte pas, ça ne se met pas de main dans les culottes. Les élèves de Louis-le-Grand montent et descendent de très beaux escaliers à double volée de marbre, comme dans Les disparus de Saint-Agil. On n’entend pas une mouche voler dans les couloirs. Pas une mouche ! Les quatre mentions très bien avaient tous des lunettes à grosse monture, la peau grêlée de boutons sanglants grattés à l’ongle, un épais duvet brun au-dessus de la lèvre supérieure. Un des garçons me fixait. Ses yeux noirs et myopes me disaient que j’étais sur la bonne voie.
« Continue, continue mon gars.
– Je suis dispensé de sport depuis trois ans, je lui répondais, j’ai une scoliose et ma vue baisse.
– C’est bien, c’est bien mon gars, continue », luisaient les yeux sur la photo de l’article.
La fille du charcutier avait découpé l’article du Figaro Magazine, je l’avais rangé dans le premier tiroir central de mon bureau pour pouvoir le relire régulièrement et regarder la grande photo ouvrant l’article, la photo tout à fait royale. Internat de Louis-le-Grand, Paris, brique fendant l’air : voici l’objectif. Lunettes à double foyer, peau grêlée par des maladies bizarres, épaules qui tombent : voilà le chemin. Après leur bac mention très bien, les quatre garçons avaient été contactés par des écoles américaines qui feraient d’eux des triomphants, relatait l’article. Vers trente ans, ils s’achèteraient un corps et jouiraient sur des filles entièrement nues. Ils ne mourraient jamais.
Ce qu’en dit Éric Loret dans Le Monde des Livres est ici. Ce qu’en dit Christine Marcandier dans Diacritik est ici.
Alban Lefranc
Alban Lefranc - L'homme qui brûle - éditions Rivages,
Charybde 2 le 30/10/19
l’acheter ici