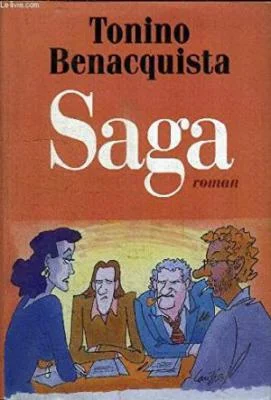Saga : la loi du marché dans les séries télé
Un redoutable et hilarant jeu avec les affres et les paradoxes de la création collective et des lois du marché, à propos de séries télévisées.
Lequel de nous quatre est le plus intimidé ? Moi, à coup sûr, vu la nuit blanche que je viens de passer à attendre ce rendez-vous. Mais aucun ne donne l’impression d’être franchement à l’aise. Nous nous regardons en chiens de faïence, assis dans deux canapés en vis-à-vis, sans même chercher à faire connaissance.
Mathilde Pellerin a l’air de se demander ce qu’elle fait là. Une fois ou deux elle s’est redressée comme pour partir, sans savoir elle-même ce qui la retenait. Je crois que ce qui la gêne dans la situation est d’ordre purement physique : ces trois corps d’hommes qui se sont imposés d’eux-mêmes dans ce bureau minable. Trois regards inconnus. Scrutateurs.
Jérôme Durietz, lui, on sait très bien ce qui le maintient cloué sur ce canapé : le besoin de fric. Certains peuvent afficher un souverain mépris face à leur propre indigence mais Durietz n’est pas de cette race-là et se trahit au moindre geste. Il a caché ses poignets de chemise en nous serrant la main, il a fait semblant de chercher de la monnaie au fond de ses poches devant la machine à café, et quand je lui en ai offert un, il l’a siroté comme s’il n’en avait pas bu depuis trop longtemps. J’ai eu envie de lui avancer un peu d’argent, rien que pour le voir se détendre, parce que sa façon de calculer chaque instant a vite commencé à me porter sur les nerfs. Dieu seul sait où ils sont allés le dégoter.
Celui qui m’intrigue le plus, c’est Louis Stanick. Le seul qui ait essayé de mettre tout le monde à l’aise avec un petit speech, façon doyen des jours de rentrée. Un privilège de l’âge, faut croire. Il a passé la cinquantaine de peu, il est grand et se tient droit comme un I, une moustache et une paire de lunettes en écaille lui donnent un petit air à la Groucho Marx. Il est le seul des trois dont j’ai retrouvé la trace dans les annuaires professionnels. Les cinq lignes qui lui sont consacrées dans le Larousse du cinéma disent qu’il a beaucoup travaillé en Italie dans les années soixante-dix, mais les titres de sa filmographie ne m’ont rien évoqué. De retour en France, il a écrit un long-métrage qui n’est jamais sorti, et puis plus grand-chose jusqu’à se retrouver ici, dans ce bureau bizarre. Son C.V. est tellement mince qu’il peut tenir sur un papier à rouler. Même si le mien n’en est qu’à la première ligne, je me fais le serment de ne pas finir comme Louis Stanick.
Quatre scénaristes de cinéma et de télévision se retrouvent un beau matin dans un bureau légèrement sordide du 7ème arrondissement parisien, attendant le directeur de la fiction d’une grande chaîne télévisée, qui vient de s’apercevoir que faute du respect immédiat ou presque du quota de création nationale, il sera soumis à d’importantes pénalités financières. Le couteau sous la gorge de ce point de vue, il leur confie la mission presque absurde – mais hautement sensée au strict plan de la rentabilité – de réaliser « Saga », une série qui sera diffusée à un horaire impossible, dont le scénario importe peu, mais qui doit satisfaire un seul impératif : coûter le moins cher possible, autant dire presque rien.
Compagnie de la Mauvaise Foi, Genève, 2013
Deux heures plus tard, la Saga n’en est pas encore au stade de la gestation, mais nous, ses géniteurs, avons franchi la première étape de l’approche amoureuse avant la grande copulation. Une approche cauteleuse, faite de regards appuyés qui s’étudient les uns les autres, de propositions hésitantes, au risque du ridicule. Nous avons fait comme tout le monde, partir des évidences et des lieux communs pour nous en éloigner avec un délicieux sentiment d’interdit. Entre nous quatre, il a très vite été question d’argent, de violence, et surtout, de sexe. Nous n’avons rien inventé sur les thèmes de départ, mais ils ont l’avantage d’être là sans qu’on les cherche. Sans être astreints à séduire autrui, il reste le plaisir de nous faire rêver nous-mêmes, dernier rempart contre l’ennui et la mauvaise humeur. Prendre du plaisir à imaginer un tombereau de fariboles, c’est trouver d’emblée une dynamique de travail à long terme. Une tendance s’est affirmée tout de suite : ne refuser aucune proposition, si farfelue soit-elle.
Nourrie par les failles et les circonstances personnelles de chacun des quatre scénaristes (dont un prologue rusé à fourni à la lectrice ou au lecteur certain des tenants, en attendant la révélation bien ultérieure de plusieurs aboutissants aux allures de mise en abîme), la série prend vie, de manière bientôt inattendue, devenant une toute autre aventure que celle initialement programmée, changeant progressivement les perceptions du public comme celles des commanditaires, jusqu’à prendre une ampleur et une importance socio-politique insoupçonnables initialement.
Première édition en espagnol
Louis ne réagit pas et se lève. Regarde par la fenêtre, allume une gauloise.
– Vous ne pensez pas qu’il serait temps de nous occuper de Loli Callahan ?
– La mère des gosses ? Celle qui a disparu depuis quinze ans ?
J’aurais dû m’en douter. Louis veut donner à Walter une chance de revoir celle qu’il n’a plus. Il y a une part de nous dans chacun des personnages de la Saga. Et si l’art imite la vie, tant mieux.
– Elle est morte depuis longtemps, dit Louis. Le plan de Walter était simple : il a caché cette mort aux enfants pour ne pas les traumatiser, il leur a raconté que leur mère est partie mais qu’elle reviendra. Il s’est donné dix ou quinze ans pour tomber amoureux d’une autre, et lui demander de se faire passer pour Loli aux yeux de ses enfants qui vont enfin retrouver une mère.
– C’est ça que tu appelles simple ?
Pour le moins tordu, mais pourquoi pas ?
– Je trouve ça assez joli, dit Mathilde. Le rôle qu’il lui demande de jouer est pour cette femme une bouée de sauvetage. Elle s’appelle… Eva. Elle a terriblement souffert par amour. Elle a une vie d’une banalité effrayante et, bien sûr, elle n’a jamais eu d’enfant. Être Loli, c’est la chance de son existence. Une aventurière qui a préféré sa vie à sa famille mais qui revient pour se faire pardonner ? Il n’y a pas plus beau rôle pour une femme qui n’attendait plus rien. Les gosses vont l’adorer, le père va l’adorer. Vous vous rendez compte de tout ce paquet d’amour qui va lui tomber dessus, à cette malheureuse ?
D’où viennent les idées ? Comment naissent les personnages ? Une chose est sûre : il faut être quatre pour engendrer une Saga. Si l’un de nous jette en l’air une envie, une impression, ou un doute, il y aura toujours un collègue pour le rattraper au vol. Qui a créé cette Eva ? Tout le monde. Elle est née d’un souci de Louis, d’une délicatesse de Mathilde, d’un persiflage de Jérôme. Et sans doute un peu de mon silence.
Avec ce roman de 1997, publié dans la collection Blanche chez Gallimard, Tonino Benacquista, jusqu’alors auteur célébré de romans policiers ou noirs (son « La Commedia des ratés » de 1991, notamment, avait été couronné par le Grand Prix de littérature policière), réussissait brillamment son entrée en littérature dite « générale », tout en ne reniant rien de son héritage littéraire initial. Jouant avec une ruse certaine et une bonne humeur communicative (mais non dénuée d’intentions cachées) avec les mécaniques contemporaines de « fabrique des contenus » (étant lui-même scénariste de moins en moins occasionnel depuis la fin des années 80), il nous offre ici une fable noire au rythme enlevé et aux rebondissements malicieux, sur fond de création collective, de mystère de l’imagination et de chocs assumés ou non entre l’esthétique du roman et le marketing de la télévision, au cœur de l’action, des influences et des conflits potentiels. Un roman découvert grâce à Mélanie Fazi, venue jouer les libraires d’un soir chez Charybde un soir de juin 2012 (on peut écouter ses mots à propos de « Saga », ici), qui avait habilement souligné alors le redoutable jeu entre le plausible et l’absurde réjouissant proposé par le romancier.
Tonino Benaquista
Tonino Benaquista - Saga - Folio
Charybde2 le 4/04/18
l'acheter ici