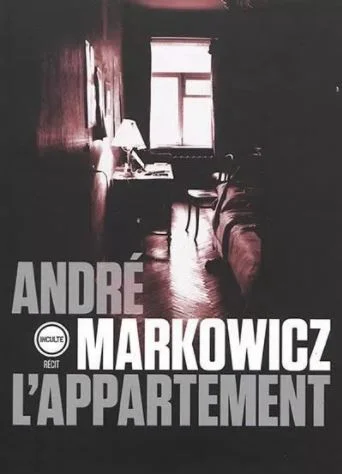Le passé mis en pièces : L'appartement d'André Markowicz par Claro
Parfois, se raconter exige de revenir sur les lieux où a poussé, première, la fleur de tout récit, celle de l'enfance. De rentrer chez soi, ou plutôt de faire à nouveau effraction dans l'appartement où l'on a appris à être soi un jour.
Grotte aux parois tout sauf mutiques, labyrinthe dont on connaît tous les tours et détours, climat intérieur que ni la poussière ni la négligence ne peuvent tout à fait perturber. Pour le traducteur et écrivain André Markowicz, ce lieu n'est autre qu'un appartement de Saint-Pétersbourg où sa grand-mère a habité une grande partie de sa vie. C'est là que s'est forgée la musique secrète de la langue qui l'habite, le russe. Là sans doute qu'est né ce "bruissement de la langue", cet accent survivant à un réel disparu, comme le sentiment d'un membre fantôme. Y revenir, c'est réinvestir une géographie domestique et mentale, mais surtout sensorielle ; c'est retrouver, sous l'apparente déréliction, la peau douce de la jeunesse. Non pour célébrer l'âme défunte des choses et en tirer un phrasé nostalgique, mais pour, comme chez Proust, inviter le passé à respirer encore dans cet autre lui-même qu'est le texte.
L'appartement, qui sort aujourd'hui aux éditions Inculte, nous rappelle si besoin est que le grand traducteur qu'est André Markowicz est avant tout un maître des cadences. Son livre – où la psychogéographie révèle, comme une plaque sensible, le biographique – a la particularité d'être écrit en vers, et l'on sait combien Markowicz sait plier le récit au rythme au point de les faire coïncider en un même précipité. Pour traduire le tétramètre ïambique de l'Eugène Onéguine de Pouchkine, Markowicz avait su créer un octosyllabe d'une étonnante plasticité, un véritable feu follet métrique. Ici, dans L'Appartement, c'est au décasyllabe qu'il a confié le soin de chanter "l'odeur du premier monde", un décasyllabe qui ne cesse de déborder comme un ru sans cesse alimenté par une fonte intime, celle des perceptions retrouvées:
"[…] mais est-ce la Russie, est-ce l'enfance / ou bien les deux ne sont pas dissociables, / tout ce qui est de l'ordre de mes sens / s'est figé là comme une fois pour toutes, / ce qui fait que la suite de la vie, / je veux dire la vie en tant que telle, / s'avère, au bout du compte, un accident, / comme une diversion, une long détour, / ou, justement, non, pas si long que ça, / parce que dès que cette enfance arrive, / 'arrive' et pas 'revient', le temps n'est plus, / il n'a plus d'importance, il est passé / et je suis revenu où je dois être / ou plutôt non – je reviens où je suis /". (p. 117)
Cet "appartement" (mot qui résonne bien vite comme "appartenance"), Markowicz ne s'y enferme pas, il y va et vient comme dans un souvenir offrant d'autres perspectives sur la vie, et c'est depuis son seuil menacé qu'il raconte sa préhension des textes à traduire (en complicité avec Françoise Morvan), qu'il s'agisse de Platonov qu'après une première déception il entend alors mieux et plus fort grâce aux corps portés sur scène, ou de L'idiot, dans lequel il entre "non pas comme un déluge / mais phrase à phrase, par petites doses, / au jour le jour, pour garder l'équilibre".
Le lecteur poussera d'autres portes de cet "appartement" – entrera dans d'autres pièces de la vie de Markowicz, dont certaines situées en Bretagne. Quel que soit l'épisode retracé, on est conquis, ou plutôt convié, par ces vers ivres de rebonds, ces vers qui ricochent au plus profond de la mémoire et parviennent à traduire – à déplacer, bousculer, ranimer – les sensations et les visions, l'intellection et la passion. L'appartement, et c'est ce qui explique sa force d'émotion, est une crépitante leçon de souffle.
Le 7/03/18 par Cannibale Claro
L’appartement était désert. Le vieux
chat que j’avais consigne de garder
dans la cuisine ou le couloir à cause
des poils qu’il répandait à son passage
me regardait avec appréhension
pour ne pas dire hostilité croissante,
ce que je comprenais dès lors
que plus personne à part mon vieil ami
et sa compagne n’étaient plus venus
habiter là depuis qu’il y vivait,
survivant, lui, à sa propriétaire,
la mère décédée de cet ami
voilà cinq ans, et déjà vieux chez elle,
et qu’il y régnait donc sur le rebord
d’une fenêtre comme un chef indien
dans sa réserve, couverture
sur les épaules, longue pipe aux lèvres,
dérangé dans sa mort par quelques jeunes
alcoolisés qui chercheraient querelle
à dieu sait qui. Moi, j’étais juste là
chez moi, ou ce, du moins, qu’en théorie
je devais penser l’être, possédant
un grand appartement dans cette ville
d’où ma famille était originaire,
et pas qu’originaire mais d’où chaque
instant d’éveil, bribe de vie, mémoire
des sens avaient, quoique j’en dise, pris
racine au tout début, et même avant,
comme si c’était là et nulle part
ailleurs que je pouvais m’imaginer
une existence à l’intérieur du monde,
quelque chose d’un tant soit peu normal,
avec, évidemment, une autre langue
que celle qui était la mienne tous
les jours, celle de l’existence même,
si ce n’est que, très loin, dans ma première
enfance, elle était autre, et la musique
en est restée, les rythmes, pas les mots —
les mots aussi, bien sûr, mais la musique
d’abord, une musique abstraite, allez savoir
comment décrire ce qui reste d’une
langue lorsque la langue année après
année s’enkyste parce que le seul
usage est intérieur ou de mémoire
et que la langue dite-maternelle
devient la langue du vieillissement
et comme son fantôme en devenir —
année après année, on s’en rend compte
quand on parle à quelqu’un qui vient de là,
aux tout premiers instants, quand il, ou elle,
a un recul d’un petit centimètre
ou fronce les sourcils, et tout revient
dans l’ordre après deux-trois répliques,
l’accent a disparu, ne reste qu’une
prononciation ni d’ici ni d’ailleurs,
intéressante muséalement,
et nous pouvons parler, bref, j’étais là,
avec ce chat qui menaçait de me
cracher dessus dès que je m’approchais
non pas de lui mais de son canapé
contre le mur terni de la cuisine,
à regarder par la fenêtre en face
la paroi jaune sale de l’immeuble
(car la cuisine avait un canapé
qui servait de banquette, vu l’absence
de chaises : c’étaient donc deux tabourets
et la banquette, siège de celui
qui était mon ami) et m’enfonçant
sans appui pour le dos, j’écoutais une
conversation, je dis « conversation »,
ce devait être deux-trois phrases, de
toute façon, je la prenais au vol
(j’avais laissé la « fortotchka » ouverte,
car les fenêtres russes, bien que doubles,
restent ouvertes généralement
par un petit fragment, une lucarne
ou quoi, qui a sa fermeture propre
dans le carreau en haut à droite, c’est
ce qu’on appelle « fortotchka », un nom
dont je ne sais pas même d’où il vient),
et, même là, j’avais perdu des mots,
deux hommes qui parlaient de leur voiture,
trente secondes, moi, comme agrippé
à eux, le temps que je le réalise
avec le claquement des deux portières,
à croire que mon lien avec le monde
c’était ces gars que je ne voyais pas,
dont je n’avais pas même les paroles,
juste l’intonation, non, pas les mots
(sans intérêt aucun), juste le fait
qu’ici les gens parlaient toujours la langue,
et cette langue avait été la mienne,
à part que, le vocabulaire automobile,
je l’avais dans ma langue de partage,
pas dans ma langue intime — puisque ma
mère n’aura jamais conduit en russe, —
et tout semblait comme un décor en loques
pareil à l’acte IV de La Mouette
le vieux théâtre qu’il faudrait détruire, —
j’avais juste laissé le temps passer,
sans y penser vraiment, le papier-peint
gardant une ombre grise un peu plus grasse,
les contours de son dos, ou va savoir,
les vieux coussins aussi lustrés par l’âge,
ou justement pas l’âge puisque ces
coussins, ils étaient ceux de mes grands-mères :
je les avais toujours connus où ils
étaient, sur le divan ou les fauteuils
sculptés à tête de sirène, j’ai
toujours l’idée fantôme de mes doigts
qui suivent les méandres des cheveux
d’ébène, la peinture qui s’écaille
sur les fenêtres, les prises dénudées
le temps d’avoir l’argent de les remettre
en place, un genre de déréliction
complète, au bout du compte confortable
puisqu’il leur suffisait de ne rien faire,
de ne rien remarquer au jour le jour,
juste un pied d’un fauteuil soudain qui casse
et qu’on remplace à titre provisoire,
le temps de réfléchir à comment faire
pour réparer au mieux, par quelques livres
dépareillés, j’étais sensé passer
huit jours ici pour essayer de voir,
une nouvelle fois, trois ans plus tard,
la marche à suivre pour l’appartement,
s’il fallait le louer ou le revendre,
refaire des travaux, savoir où mettre
les meubles rescapés du cataclysme,
ceux qu’on avait entreposés depuis
l’automne mil-neuf-cent-quatre-vingt-douze :
ce qui avait été le point d’ancrage
de mon enfance, cette pièce unique
où s’entassaient, dans un ordre immuable
tous les meubles sauvés par mes grand-mères
(car j’ai eu trois grand-mères dans ma vie,
deux sœurs à Léningrad, et ma grand-mère
en France que je n’ai pour ainsi dire pas
connue — je garde d’elle son halo,
la silhouette frêle et la tendresse),
l’appartement communautaire aux longs
couloirs et la cuisine gigantesque
avec ses six réchauds à gaz, soudain,
s’était évaporé quand ma grand-tante
était morte à Paris à cent-un ans.
C’était l’URSS. L’immeuble qu’elle,
elle avait vu construire — elle y avait
emménagé en mil-neuf-cent-dix-huit —,
alors qu’il était ressorti des bombes
quasi intact, presque pas lézardé,
s’était détérioré au fil du temps,
penchait même, j’avais cette impression,
en tout cas l’escalier était bancal,
un escalier de marbre, vérolé,
empuanti — cette odeur âcre et froide
d’urine ou de déréliction tranquille,
vétuste et demandant des travaux lourds,
a été déclaré « mis en péril »,
les habitants ont été relogés
dans des tours de banlieue, et ma grand-tante
recevait un studio dans un immeuble
de trente étages, mais dont l’ascenseur
était en panne depuis plusieurs mois,
bref, mes parents l’ont fait venir en France,
quatre-vingt-dix-neuf ans, et nous avions
compris, par force, qu’elle était aveugle
quoique autonome dans l’appartement
puisque sa vie était un rituel
dans ses moindres détails, que chaque chose
avec sa place propre et des amis
faisaient les quelques courses nécessaires,
ses yeux lui étaient comme superflus,
le contour, le toucher, la place exacte,
et elle-même ne distinguait plus
les taches de couleur qu’elle voyait
et les objets eux-mêmes, — j’y repense,
c’était pareil pour moi, j’essaie de voir,
là, aujourd’hui, de voir, pas de revoir,
et je comprends que rien n’est partageable,
mes yeux glissaient, je n’avais pas besoin
de voir, ou j’étais incapable, puisque
le fait de voir demande une distance, —
qu’auriez-vous voulu faire de ces meubles,
de ces vieux livres, de ces milles choses
qui nous donnaient, à nous, la certitude
qu’on pouvait habiter dans la durée,
avec cet être dont le simple fait
de garder le sommeil l’après-midi
étendait la douceur et le silence,
ouvrait l’écoute au moindre craquement
sous le plancher, à ce souffle inégal
et tout petit, avec de loin en loin,
quelques bribes de mots, ou un murmure
qui se fondait dans la respiration,
laquelle, à elle seule, remplissait
l’espace en moi, créait la seule place
possible, et le seul temps, ces trois semaines
par an que nous étions à Léningrad,
c’était le temps réel, et les cinquante
autres faisaient comme une parenthèse
d’apesanteur, évidemment plus longue,
mais sans contour, juste celui des heures
des jours l’un après l’autre, sans limite,
pas plus gris qu’autre chose, juste pas
là, mais que là, — oui, comment faire,
puisque les règlements interdisaient
de les faire venir chez nous, en France,
puisque personne ne pouvait tout prendre,
et que l’immeuble était lui-même en ruines,
il n’en restait plus même la façade,
bref, d’un seul coup, il ne restait plus rien,
le lieu était un trou, les quelques bribes
étaient éparpillées chez des amis,
je n’avais plus de lien avec le temps,
chargé d’une durée qui n’était mienne
que par la sensation qu’elle était celle
des autres, pas de ma famille seule,
mais celle de ces livres que j’avais
toujours connus avant de les comprendre,
que je palpais, dont je tournais les pages
juste pour en sentir au bout des doigts
le papier lisse et rêche en même temps,
ce siècle qu’on disait d’argent, les noms
de ces recueils dont les feuilles brochées
pouvaient se détacher sans même un geste
brusque, le fait de prendre et de reprendre
le même livre, juste de savoir
qu’il était là…
André Markowicz
publié le 8 janvier dans Displaced Objects