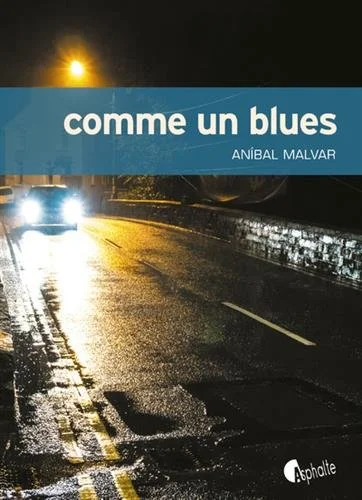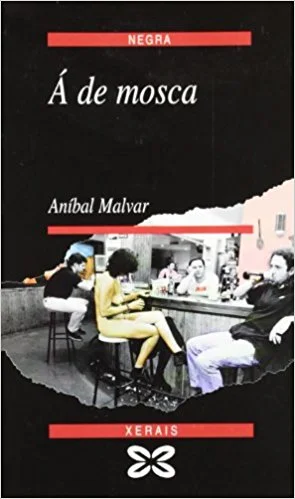Dans les replis contemporains de l’état profond espagnol. Bien noir et superbe.
Publié en 1998, « Comme un blues » est le quatrième et dernier roman à cette date écrit en galicien par Anibal Malvar (son « La ballade des misérables » de 2012, traduit en français chez Asphalte en 2014, l’a été en castillan). Également journaliste et scénariste de bandes dessinées, il nous propose ici, à partir d’un ancrage dans le sol bien particulier de la Galice et de la capitale de la communauté autonome, Saint-Jacques de Compostelle (préférée en 1981 pour ce titre à la plus grande ville de la région, La Corogne), une saisissante incursion dans les replis noirs de « l’état profond » espagnol (on songera à plusieurs reprises à l’excellent personnage de Berthet dans « L’ange gardien » de Jérôme Leroy), et singulièrement de son rôle lors de la transition démocratique de 1975-1982.
À ce moment-là, je savais déjà que j’étais un fils de pute du côté de mon père. Ce que je n’aurais jamais imaginé, c’est qu’un jour je serais obligé de tuer le Vieux, que je le buterais comme il avait buté tant de gens, que j’abattrais et rendrais à la terre celui qui n’aurait jamais dû voir le ciel. Non. À ce moment-là, tout ce qui m’intéressait, c’était de m’allonger les doigts de pied en éventail et de buller. C’était un soir pluvieux d’hiver et je n’avais rien à faire. Ou alors un bilan peut-être, mais ça c’était facile. J’avais quarante-cinq ans, une bouteille de whisky, tout mon temps et rien d’autre. Le bourdonnement d’une circulation tardive accompagnait mes gorgées alanguies de paresse. Les gens rentraient chez eux après le boulot. Ou après avoir cherché du boulot. Je ne savais pas ce qu’on leur mettrait à la télé. Ni ce qui les attendait dans le frigo pour dîner. Ni si leurs enfants ramèneraient de l’école une blague idiote à raconter. Madrid, 1996. Et j’ai déjà dit que c’était l’hiver. L’hiver, l’air de Madrid est fibreux et pas facile à mâcher. Il y a tout le temps des clochards qui meurent de froid et des accidents de voiture à cause du verglas, qui forme une pellicule sur l’asphalte et ne fondra pas avant le premier jour du printemps, lorsque l’oiseau le plus téméraire de mars osera déchirer l’hymen du smog. Dehors il pleuvait donc peu probable qu’il neige pour le moment. Ce serait agréable de voir neiger d’ici, avec un whisky tiède à force de le tripoter et de le siroter. Il neigerait dans quelques jours et le whisky serait toujours là, et moi aussi, alors ça ne faisait rien. Une neige lente et blanche, comme dans un film scandinave, comme une ligne de coke, comme le pas d’une vénérable vieille, blanche et lente. Il neigerait surtout si ce putain de téléphone arrêtait de sonner une fois pour toutes.
Maniant à merveille l’atmosphère poisseuse (actualisée) des meilleurs romans hard-boiled, Anibal Malvar s’appuie sur une histoire presque classique de disparition de jeune fille de la bonne société galicienne qu’il s’agit pour le « privé » ici plus ou moins improvisé – mais aux antécédents indéniables – de retrouver avant que les choses ne deviennent réellement inquiétantes. L’imbroglio prend toute son épaisseur lorsque derrière le fait divers se profile d’abord l’intrication d’une jeunesse dorée pour laquelle l’argent ne compte guère, d’un milieu authentiquement mafieux mêlant petites canailles et fils de famille de grands trafiquants (on songera au rude et savoureux « Les lois de la frontière » de Javier Cercas) et de fantômes doucement échappés des méandres des services secrets des années 1980, à l’époque où la fragile transition démocratique espagnole pouvait encore être aisément menacée par des forces armées hésitant pour partie à quitter définitivement le giron post-franquiste (comme le rappelle magnifiquement, à nouveau, Javier Cercas, dans « Anatomie d’un instant » cette fois, à propos du coup d’état avorté du 23 février 1981, qui se retrouvera fort peu innocemment au centre secret de ce « Comme un blues »).
– Mais pourquoi m’appeler, moi ?
La question était stupide. Ce n’était pas moi qu’avait appelé Alberto Bastida, mais le soldat de Janus, ce monstre à deux faces. J’avais toujours eu la certitude qu’un beau jour, quelqu’un finirait par faire appel à lui, quelqu’un du dehors ou du dedans ; parce que Janus vit désormais avec moi pour toujours, c’est mon ennemi intime, l’être avec lequel je partage chaque verre, chaque bouffée d’air vicié, le tic-tac de ma montre, les tumultes de mon âme nullement immortelle.
Anibal Malvar
Nimbée de sexe, de désir, de regrets et de fidélités, d’idéaux potentiellement dépassés et de kilogrammes de cocaïne frontalière, cette histoire de télescopages tour à tour brutaux et feutrés du passé et du présent prend peu à peu une épaisseur toute shakespearienne, dans la tendre violence des rapports familiaux compliqués comme dans l’inexorable realpolitik de la démocratie parlementaire contemporaine et de ses failles marchandes – et l’écriture pleine d’une justesse à la fois proche et légèrement amusée, même dans les moments les plus improbables, développée par Anibal Malvar, nous conduit naturellement à en redemander d’urgence.
Des contacts, de vieux amis et mon agence. Tout ça, c’était peau de balle. Infoflash, agence de photoreportages couleur. Je déteste la couleur. Mais j’ai passé l’âge d’arpenter les rues avec mon Leica en quête de cadavres mutilés, d’accidents de train, d’ouvriers tombés de l’échafaudage, de candidats au suicide par défenestration ou overdose. J’ai trois mules sous contrat pour faire le boulot ; moi, je ne m’occupe plus que de la compta. Ça fait je ne sais combien de temps que je n’ai pas pris une photo. Alberto Bastida confond agence de presse et repaire de vieux privés alcoolos. Mes mules seraient incapables de retrouver leur propre bite dans la chatte de leur bourgeoise.
La très belle chronique de Encore du Noir est ici, et rend parfaitement justice à cette édition française de 2017, traduite chez Asphalte par Hélène Serrano.
Anibal Malvar - Comme un blues - Asphalte édition
Charybde2 le 11/05/17
l'acheter ici