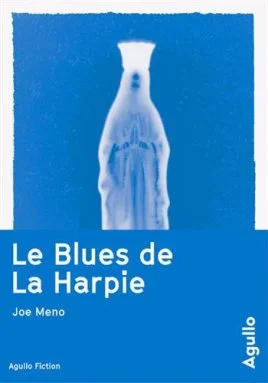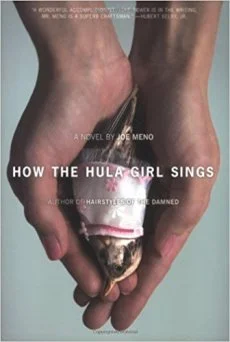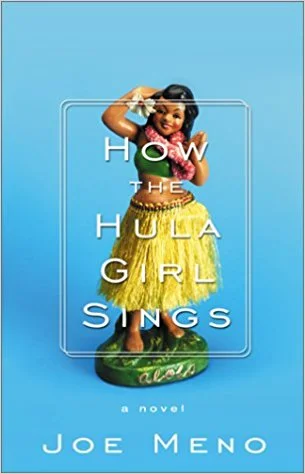La rédemption impossible par temps de crise
Sortir de prison dans une petite ville du Midwest, ou la poésie brutale d’une rédemption qui se dérobe.
Peut-être n’existe-t-il pas sensation de néant et de béance plus intense que la nuit quand tu fonces vers chez toi à quatre-vingts kilomètres/heure, une bouteille de porto ouverte à la main, l’argent de la caisse à tes côtés, et cette Vierge Marie au doux visage de plastique qui te toise depuis son trône ardent sur le tableau de bord en vinyle rouge. Non, il n’y a peut-être pas de place pour tes pauvres rêves de petite frappe au sein de cette nuit incorruptible, aucune.
La Madone a tiré une petite révérence quand j’ai quitté l’autoroute pour prendre La Harpie Road. J’avais les mains moites et le volant en vinyle noir m’échappait. Mes doigts glissaient à cause de ma propre sueur.
Je n’avais jamais volé, vraiment volé, avant.
Je n’en avais jamais ressenti le besoin.
C’est fou ce qu’un homme désespéré serait prêt à faire pour rester sain d’esprit.
Luce Lemay était un petit voyou, plutôt du genre à jeter des bombes à eau sur des voitures à l’arrêt, ou à détourner la monnaie des courses alimentaires. Jusqu’au jour où (pour des raisons qui apparaîtront en temps et en heure) son premier braquage (microscopique et sans arme) tourne mal, lorsqu’il renverse et tue par accident, dans sa fuite automobile, le bébé d’une jeune femme. Trois ans plus tard, libéré pour bonne conduite, il accepte l’offre de son ex-compagnon de prison Junior Breen de le rejoindre pour travailler dans une station-service qui donne une seconde chance aux ex-taulards, à La Harpie, Illinois, le village natal de Luce.
Ils m’ont redonné mon nom de baptême tout entier, mes habits à moi et trois vieilles Viceroy Gold lamentables. Je les avais cachées dans l’ourlet de ma veste de costume rouge. De ma vie, jamais je n’avais goûté de cigarettes aussi rances, je le jure. De petits ectoplasmes de nicotine poussant des gémissements sans filtre se mêlaient aux volutes de fumée, tant elles étaient vieilles ces clopes.
Ils m’ont redonné mon nom tout entier et la vie que j’avais perdue, mais ce landau continuait à rouler, sans chaleur, dans ma tête. Il passa devant moi en vacillant, balançant d’avant en arrière, au moment où je franchissais le portail en métal pour redevenir un homme maître de sa destinée. Je me suis payé un milk-shake à la vanille au Dairy Queen et je l’ai siroté sans me presser, gardant cette paille entre mes dents jusqu’à ce qu’il ne restât plus rien, rien qu’une sensation de froid sur mes dents. Puis je me suis acheté un billet de car à destination de la maison et je me suis installé à l’avant.
Ce trajet me fut aussi clément qu’une plaie béante.
Je restai immobile sur mon siège à mater cet autre détenu que je connaissais vaguement, Jimmy Fargo, occupé à peloter sa petite copine, une fille du cru qui suintait la sueur comme une frite maison, et lui, il la déshabillait juste là sur la rangée de devant, s’échinant à lui donner du bon temps sur ces affreuses housses grisâtres. Sa nana, à Jimmy Fargo, c’était une rouquine replète avec un visage rond et affable et un chemisier blanc déboutonné jusqu’en bas afin d’exhiber sa poitrine opulente et sa chair blanche piquée de taches de rousseur. Il y eut une vague de pure ondulation quand ce sacré Jimmy dégrafa son soutien-gorge. La secousse résonna le long de mes lèvres et dans ma tête.
« Hé oh, un peu de tenue, toi, là-bas ! cria le conducteur, un vieux busard, par-dessus son épaule. Sinon, prochain patelin, je m’arrête et je te livre aux flics histoire qu’ils te renvoient direct derrière les barreaux. »
Publié en 2001, traduit en français en 2017 par Morgane Saysana chez Agullo, le deuxième roman de Joe Meno est peut-être l’une des plus saisissantes tentatives qui soient pour proposer une confrontation poétique et noire entre les univers de la petite délinquance rurale américaine, de la prison et de la petite ville traditionnelle. Ces 300 pages orchestrent admirablement le ballet de la fatalité, de la rédemption délicate ou impossible, du pardon et de l’amour, grâce à des personnages qui, tout en terrant en eux les brutalités carcérales et post-carcérales que l’on peut trouver chez Edward Bunker (« Aucune bête aussi féroce », 1973) ou chez Charles Willeford (« Miami Blues », 1984), possèdent un authentique charme steinbeckien, usant dans leur rapport au monde d’une innocence à géométrie variable et d’une sincérité à toute épreuve, croyant à l’amitié et même à l’amour bien davantage au fond qu’à la convention socio-économique et à la barrière (qui, ailleurs, s’appellerait sans hésiter « de classe »).
Il y avait de petits carrés de pelouse devant chaque maison et des arbres gris qui donnaient un peu d’ombre. Il y avait les voies ferrées qui se déployaient au loin, bordées de poteaux téléphoniques, suivant la courbe de la ligne d’horizon. Enfants, on s’amusait à défier les idiots de marcher sur les rails juste avant le passage d’un train. Si personne de ma connaissance n’y a laissé de plumes, c’était quand même assez stupide comme jeu. Et voilà, elle était là. La Harpie. Une petite ville. Un spectacle très banal, si vous voulez mon avis. Mais il y avait quelque chose sous la surface. Quelque chose de l’ordre du sang ou de l’or. Quelque chose d’assez petit pour tenir dans votre poche. Comme un cancer du poumon ou une pièce porte-bonheur.
Joe Meno
La rédemption se dérobe, les chemins bifurquent, la brutalité se refuse à disparaître, la bêtise, le conformisme et l’avidité ne s’avouent jamais vaincus, et de tout cela, Joe Meno parvient à extraire une bizarre poésie, à la fois sombre et enjouée, pour faire de ce « Blues de La Harpie » un roman curieusement marquant.
Joe Meno - Le Blues de La Harpie - éditions Agullo
Charybde2 le 21/03/17
l'acheter ici