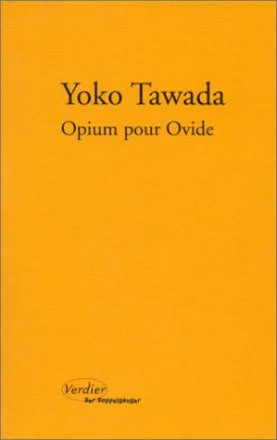Yoko Tawada : Opium pour Ovide
Léda entra dans la baignoire. La porte de la salle de bains était fermée. Léda avait les deux bras paralysés. Cela l’empêchait de se laver, mais elle refusait l’aide d’autrui. Elle ne voulait plus montrer son corps nu, disait-elle, il n’en valait plus la peine. Bien plus tard, une question me vient à l’esprit : on désire plus une vieille maison qu’une maison neuve ; on admire plus souvent un arbre tricentenaire qu’un arbre de trois ans ; plus une théière, un livre et une maison sont anciens, plus on est sensible à leur beauté.
Pourquoi en irait-il autrement des humains ? Elle était peut-être assise dans l’eau, ses ailes déployées pendaient, inertes, sur les bords de la baignoire. Du bec, elle nettoyait ses plumes blanchâtres imperméables. La porte de la salle de bains était verrouillée de l’intérieur.
On apprend que la nouvelle loi, très controversée, a été votée hier. Dorénavant, la caisse d’assurance maladie ne serait plus dans l’obligation de rembourser les frais de traitements médicaux du bas-ventre. Un spécialiste des évolutions sociales a déclaré sur les ondes qu’on verrait dans l’avenir un nombre croissant de transplantations d’organes du bas-ventre vers la partie supérieure du tronc.
Attribué à François Boucher, Léda et le Cygne (vers 1740)
Dans une grande ville allemande, que certains indices ou noms propres occasionnels désignent comme Hambourg, où réside Yoko Tawada depuis ses 22 ans en 1982, à une époque qui est de nos jours ou presque, vingt-deux femmes, en autant de chapitres, tentent de vivre, se croisent, s’échappent, se mêlent, s’affrontent à fleurets mouchetés ou à invectives feutrées, se heurtent à certains carcans de la vie quotidienne et de la conformité – ou de la vie telle quelle doit être menée -, se hérissent, se déforment, rêvent et cauchemardent, dans un rapport à leur corps en perpétuelle métamorphose. Ce sont d’abord leurs noms, grecs et classiques, échappés de récits mythologiques aux souffles puissants, qui les trahissent, et ce dès le premier chapitre focalisé sur Léda, qu’une paralysie des membres supérieurs fait ressembler – si l’on veut – à un cygne : la Germano-Japonaise réécrit ici, avec une perspective unique, joyeusement biscornue et subtilement dérangeante, les « Métamorphoses » d’Ovide.
Léda a souvent mal aux oreilles. Tout appareil électrique bourdonne en douce même si on ne l’entend pas tout de suite. La petite ampoule de la cuisine vivre sans arrêt avec un bruit d’ailes de coléoptère. La pendule au mur et la montre dans le sac font des tic-tac décalés, trébuchants. Nuit et jour, le réfrigérateur gémit. Moins il est rempli, plus son monologue intérieur est bruyant. Léda dit parfois qu’elle brûle de débrancher toutes les prises de la maison. Elle rase la cloison, elle se penche par-dessus la commode, elle regarde derrière le lit, et elle en retire une, et une autre et encore une autre. Mais elles sont bien plus nombreuses qu’on ne croit. Des prises de courant, il y en a sous le vase, derrière le tableau, sur la paume, sur la tête. Même le nombril de Léda a un air de prise de courant. Elle a envie de débrancher son corps.
Apollon et Daphné - Le Bernin
C’est Alain Nicolas, merveilleux critique littéraire au sein du journal L’Humanité, qui m’a fait découvrir ce texte, partie de sa sélection lorsqu’il était venu jouer les libraires d’un soir à la librairie Charybde en avril 2015 (on peut l’écouter ici). Publié en 2000, et traduit en français en 2002 par Bernard Banoun chez Verdier, ce troisième « roman » en allemand (Yoko Tawada écrit aussi des textes en japonais) aurait beaucoup d’arguments pour dérouter la lectrice ou le lecteur, pour le ou la plonger dans un labyrinthe de miroirs à facettes où, Thésée sans fil d’Ariane (l’une des vingt-deux héroïnes ici, justement, celle qui intervient en antépénultième instance), il ou elle demeurerait comme interdit(e). Et pourtant, bribe par bribe, touche de rêve éveillé par touche de cauchemar réprimé, un curieux tableau global se met en place, celui d’une lutte diaphane et pourtant acérée, qui n’est pas celle de dieux et de mortels, mais bien celle de femmes pour avoir le droit d’exister comme elles l’entendent – et non comme elles le devraient (quelle que soit la source réelle de l’injonction, qu’elle qu’en soit la violence apparente ou dissimulée).
Elle essaient de ne pas commettre d’impair avec Léda. Leurs langues se crispent pour éviter les gaffes. Elles s’expriment de manière biscornue et retombent toujours comme de juste sur les phrases qu’elles voulaient éviter : « Coupe-toi donc les cheveux, les pointes sont en piteux état », lance l’une d’elles à Léda. « Si une mère de famille qui travaille savait tout le temps que tu restes au lit sans rien faire », dit une autre. « Une paralysie, c’est encore le meilleur moyen pour avoir de l’argent rapidement », affirme une troisième.
Si Léda n’est pas ici un cygne échappant aux assauts de Jupiter ,mais une handicapée, paralysée partielle, pharmacienne, échappant aux réductions budgétaires de l’aide sociale, si Galanthis n’est pas une servante de Junon condamnée à enfanter par la bouche et devenir belette après avoir été surprise et avoir néanmoins ri en sortant de la chambre du même Jupiter, mais une patiente accidentée de la précédente, si Daphné n’est pas la victime innocente de la rancune de Cupidon envers Apollon, mais une autrice et enseignante cherchant l’actualité improbable de Karl Marx, si Scylla n’est pas la nymphe trahie par la vicieuse jalousie de Circé, mais une bien curieuse antiquaire de fortune, elles et les autres, sans exception, partagent avec leur modèle chez Ovide une faille propre, strictement personnelle, et une blessure sociale et politique, infligée par le monde et souvent par le patriarcat, qu’il se dissimule derrière une convention prétendûment universelle, ou non. Cet « Opium pour Ovide » devient ainsi l’étonnant et foisonnant parcours d’une libération vis-à-vis des châtiments externes et d’un accommodement subtil avec ses idiosyncrasies, en une somptueuse et heurtée quête paradoxale d’un certain tao, sous les signes conjugués d’Henri Michaux et de Jean Cocteau, de Thomas de Quincey et des guerres de l’opium en Chine, de certaines danses et de certains jeux vidéo.
Io reçoit la visite impromptue d’un vieil ami. Il enseigne depuis des années au département de philosophie, il vit sans souci avec sa femme, directrice d’un centre culturel. Son élégante serviette de cuir contient un sac en plastique de chez Aldi, dont il extrait un cadeau pour Io, un livre intitulé Connaissance par les gouffres, la couverture a des couleurs tropicales, les caractères sont en relief. Io feuillette le livre, des bêtes rampantes lui sautent aux yeux, des liquides, des excréments et un goût de pourriture. Elle referme le livre et remercie d’une voix refroidie.
– Tu réprimes tes penchants délicieusement toqués et tu fais semblant d’être devenue quelqu’un d’autre.
– Je ne vois pas ce que tu veux dire.
– Espèce de génisse.
Quand le vieil ami se moque d’Io, on dirait que ça sort d’un livre.
Yoko Tawada
Yoko Tawada - Opium pour Ovide - éditions Verdier
Coup de cœur de Charybde2 le 2/03/17
l'acheter ici