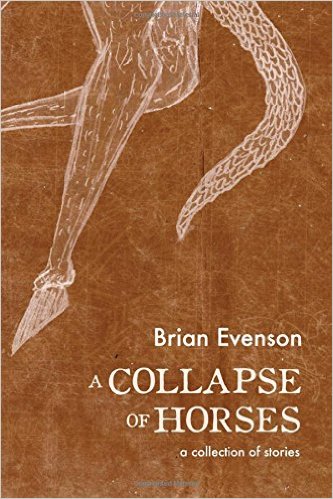Un sommet de l’art de la nouvelle inquiétante et paradoxale.
Rawlay n’était pas loin derrière, mais au détour du sentier, Sugg et le torero s’étaient volatilisés. Il tira les rênes et regarda de plus près la trace du tovero, mais elle s’arrêtait brusquement. Il fit demi-tour et chercha un petit chemin de traverse qu’ils auraient emprunté, mais il ne vit rien. Il lança des jurons, à voix haute cette fois.
« Sugg ! » cria-t-il, et n’obtenant aucune réponse, il sortit son pistolet et tira une fois en l’air. Il attendit que l’écho s’évanouisse, puis tendit l’oreille mais il n’y eut aucune réponse. Il donna quelques petits coups d’éperon pour pousser son cheval également volé à allonger le trot. Il suivit le sentier jusqu’au tournant suivant, mais Sugg n’y était pas non plus. (« Écorce noire »)
L’art de la forme courte chez Brian Evenson, déjà ô combien éclatant dans ses recueils « La langue d’Altmann » (1994) ou « Contagion« (2000), résonne souvent puissamment avec l’inquiétude pourtant d’abord diaphane dont témoigne cette « Écorce noire », dédiée à Laird Hunt (les remerciements en fin d’ouvrage nous informent d’ailleurs que cette nouvelle n’aurait jamais vu le jour sans ses « Bonnes gens »), qui ouvre le recueil « Un rapport », paru en 2016 et traduit en ce début 2017 par Sabine Porte dans la collection Lot 49 du Cherche-Midi : dense, omniprésent et pourtant toujours si ténu, le texte suinte du sentiment que le presque ordinaire, quel que soit le contexte, peut à tout moment déraper sur ses ancres, décrocher et ouvrir un horizon résolument autre, insondable et effrayant.
Quand il se réveilla, la matinée était bien avancée. Ses cils s’étaient collés pendant la nuit et il dut se frotter les yeux avant de pouvoir les ouvrir suffisamment pour y voir clair. Sugg était parti, mais allez savoir comment, Rawley n’en avait aucune idée – ce type était presque incapable de bouger et encore moins de marcher. À l’endroit où il était adossé la veille, la paroi de la grotte était couverte d’une traînée de sang à la forme vaguement humaine. Comme celle qu’il y avait sur le cheval de Sugg. Difficile de croire que Sugg avait encore autant de sang dans les veines, avec tout ce qu’il avait dû perdre. Une telle quantité de sang et avec la forme d’un homme. Un ange de sang, se dit Rawley, puis il secoua la tête pour chasser ces mots de son esprit. (« Écorce noire »)
À travers les quasiment quarante nouvelles des deux recueils précédents, la lectrice ou le lecteur savaient déjà (et les néophytes le découvriront avec bonheur) à quel point Brian Evenson excelle à s’insérer au cœur des motifs d’un genre littéraire pour le subvertir (à grande échelle, il suffit de lire la manière dont il use de la grille scénaristique d’une grande franchise hollywoodienne, dans « Alien : No Exit », pour en être encore davantage convaincu).
Brian Evenson peut jouer sans jamais trébucher avec une variété de registres et de thèmes qui forcent l’admiration : avec du western crépusculaire de voleurs fourbus de chevaux fatigués (« Écorce noire »), avec du soliloque obsessionnel et béant d’une réalité policière et carcérale – et l’on sait tout l’intérêt que porte par exemple Antoine Volodine à l’écriture de Brian Evenson (« Un rapport »), avec des jeux d’enfance plus ou moins bien inspirés – et l’on pourra admirer la coïncidence de cette parution en français avec celle de la redoutable « Maison des épreuves » de Jason Hrivnak (« Le Punir »), avec des cauchemars ordinaires plus dickiens que nature et plus troublants que des vies parallèles, inventant quasiment au passage une étrange notion de chevaux de Schrödinger (« Des alezans effondrés »), avec les abîmes ouverts par la technologie médicale et la manière dont la conscience peut sans doute de moins en moins en rendre compte (« Trois infamies »), avec un sens profond de la fatalité et du conditionnement où l’on pourrait voir poindre un sourire hitchcockien (« Secte »), ou bien, poussant la technique du même réalisateur machiavélique à un autre paroxysme, mêlant « Fenêtre sur cour » et le cadre banal d’un village de vacances, avec l’irruption de l’horreur pure (« Station balnéaire »), avec la substance de l’exploration spatiale et de l’économie minière extra-planétaire, joyeusement et glacialement mêlée au huis clos policier (« La poussière »), avec le curieux fantastique intimiste, tendre et bizarre, que l’on peut trouver aussi, par exemple, chez Lisa Tuttle ou Mélanie Fazi (« CœurD’ours™ »), avec les réalités crépusculaires dans lesquelles les sens se perdent (« Abrasion »), avec les liens multiformes pouvant unir psychisme et anatomie (« Torpeur »), avec les marges basculantes entre le quotidien et l’irréel, au long d’une route changeante et immobile (« Après Reno »), avec une formidable variation sur un thème science-fictif presque classique, quelque part entre le « Pour servir l’homme » de Damon Knight et le « La voix des morts » d’Orson Scott Card, avec même une bouffée d’humour noir et absurde que n’aurait pas reniée le Robert Sheckley de « La clef laxienne » (« N’importe quel cadavre »), avec l’hésitation possible entre maison hantée et voyage psychédélique (« Les gémissements »), avec la confusion inévitable entre certains rêves et certaines pseudo-réalités (« La fenêtre »), avec les impossibles décodages d’une situation lorsque trop de données sont manquantes (« Déclic »), pour finir en transposant d’une manière mathématique et fantastique la toute première nouvelle du recueil, pour en extraire de l’identique et du profondément autre (« Filet de sang »).
Vous savez qu’il y a des gardiens, mais vous ne pouvez pas les concevoir à partir de la main fugitive, parfois pâle, parfois non, que vous voyez deux fois par jour par la fente qui se trouve en bas de votre porte. Il doit y avoir un gardien au bout de cette main, ou plusieurs, bien que cela aussi me semble désormais sujet à caution : il s’agit peut-être d’une fausse main fixée à l’extrémité d’un bâton. Ou d’une vraie main appartenant à un prisonnier, qui lui a été tranchée avant d’être enfoncée sur un bâton pour être manipulée par quelque morbide système de marionnettes. Et non une main de gardien. (« Un rapport »)
La galerie lui parut plus longue au retour. Quand il réintégra l’enceinte du complexe, il était à bout de souffle. Il avait du mal à rassembler ses esprits. Qu’est-ce qui m’arrive ? se demanda-t-il, mais il laissa tomber. C’était absurde de se laisser contaminer par la paranoïa de Gordon. Et si Gordon avait raison, cependant ? S’il y avait un projet secret ? Mais Grimur lui en aurait parlé. Il était chef de la sécurité, il aurait été logique qu’il lui en parle, non ?
Même s’il ne lui en avait pas parlé, Grimur ne pourrait pas le lui cacher. Orvar en était presque sûr.
Il se dirigea vers le bureau, mais il changea d’avis et fit demi-tour pour aller vérifier les filtres.
Quand il mit la main devant la bouche d’aération, il sentit un léger filet d’air, très léger. Il coupa le système, ouvrit les grilles, retira les filtres. Il n’avait pas encore commencé à les nettoyer que Wilkinson était là, à côté de lui.
« Qu’est-ce qui se passe ? demanda Wilkinson. C’est cassé ? – Nettoyage de routine, répondit Orvar. Je fais ça tous les jours. »
Wilkinson fronça les sourcils. « Mais tu l’as déjà fait, aujourd’hui », dit-il.
Orvar hésita. Puis lentement, il lui expliqua qu’en effet il l’avait déjà fait aujourd’hui, mais que la plupart du temps, il le faisait plusieurs fois par jour, juste par précaution. Et pendant ce temps, il se disait : Wilkinson m’observe. Pourquoi ? Wilkinson faisait la même chose avec ses bras que Yaeger tout à l’heure, il n’arrêtait pas de les frotter, mais pas autant. Qu’est-ce qui lui arrive à Wilkinson ? (« La poussière »)
Il frémit. Il regarda de nouveau les panneaux – ou du moins il essaya, mais il n’y en avait tout simplement plus. L’espace d’un instant, il crut qu’il avait quitté l’autoroute par inadvertance. Mais il voyait mal comment et la route sur laquelle il se trouvait avait tout d’une autoroute. Puis il passa devant un morceau en métal cisaillé sur le bas-côté et se demanda si ce n’était pas les restes d’un panneau, si quelqu’un ne les avait pas systématiquement coupés. Des jeunes désœuvrés qui n’avaient rien de mieux à faire, sans doute.
Il jaugea le soleil dans le ciel. Il semblait aussi haut qu’il l’était une heure auparavant et n’avait pas encore amorcé sa descente. Il vérifia la jauge d’essence : entre la moitié et le quart du réservoir. Il continua à rouler en se demandant s’il lui restait assez d’essence jusqu’à la station suivante. Sûrement. À quelle distance pouvait-elle bien être ?
Il ouvrit la boîte à gants pour prendre la carte et y jeter un oeil, mais la carte n’y était pas. Peut-être qu’il l’avait sortie et qu’elle était tombée sous le siège, mais dans ce cas, elle avait dû glisser trop en arrière pour qu’il la récupère, du moins en conduisant. Non, il y aurait bientôt une station-service. Forcément. Il ne devait pas être bien loin d’Elko. Il y avait moins de cinq cents kilomètres de Reno à Elko et il avait fait le plein à Reno. Et Winnemucca était quelque part entre les deux. L’avait-il déjà dépassé sans s’en apercevoir ?
Il avait assez d’essence, il savait qu’il en avait assez. Son cerveau lui jouait des tours, il ne devait pas se laisser avoir. (« Après Reno »)
À son réveil, une pluie de chair vive s’était abattue sur le champ. Elle regarda les fournisseurs progresser lentement vers elle en se dandinant maladroitement dans leur carapace et piquer les bouts déchiquetés qui jonchaient le sol. Tout ce qui avait l’air frais, sans asticot, suffisamment gros pour être attrapé, ils le ramassaient. Ils le fumeraient, le sècheraient pour essayer de le vendre comme ravitaillement. Ce qui était pourri, ils jetaient de la terre dessus en raclant le sol sous leurs pieds, la tête levée vers le ciel. (« N’importe quel cadavre »)
Dix-sept fois successivement, dans ce recueil, Brian Evenson déploie l’extrême brio d’un très grand nouvelliste, maniant au plus haut niveau les deux arts du climat et de la chute. Quelques mots, quelques phrases lui suffisent le plus souvent, même et surtout pour une nouvelle de 2 ou 3 pages, pour installer l’atmosphère dans laquelle il souhaite perdre la lectrice ou le lecteur, pour disposer quelques leurres suffisamment adroits et puissants pour faire bifurquer les sentiers et instiller le doute sur ce dont il est exactement question ici ou là. Et lorsqu’il s’inscrit dans un réseau de motifs connus, parasitant joliment des thèmes classiques du roman policier, de la dérive fantastique ou de la science-fiction pure, il parvient à chaque fois à arracher la surprise finale, en de brutaux – mais pourtant pleinement naturels – retournements scénaristiques, ou en de soudains abîmes psychologiques s’ouvrant à un endroit inattendu, et vous convainc ainsi sans effort que vous avez entre les mains un très grand recueil de création narrative condensée.
Brian Evenson - Un Rapport - Le Cherche Midi éditeur
Coup de cœur de Charybde2
l'acheter chez Charybde, ici