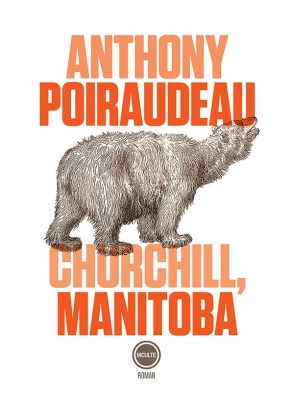Anthony Poiraudeau : nouvelle possibilité de la littérature en baie d'Hudson
Comme beaucoup de personnes, j’ai longtemps rêvé sur les cartes de géographie. Depuis l’enfance, j’ai collectionné mentalement les formes des pays, l’emboîtement de leurs frontières, les courbes des littoraux et le nom des chaînes des montagnes, des fleuves et des villes qui s’y égrènent comme les perles d’un collier, les aplats des plaines, les froncements des reliefs et tous les grands traits du visage de la terre.
J’avais rassemblé la connaissance de cela comme j’avais entrepris de nombreuses et éphémères collections dérisoires, celle des timbres-poste et celle des minéraux, des feuilles d’arbres qu’on classe dans des herbiers ou des pièces de monnaie étrangères que je n’ai jamais su où ranger, mais contrairement à tous ces petits fatras vite remisés au fond de tiroirs – après que j’avais tout à la fois perdu le goût de continuer à les accumuler et obtenu de mes parents qu’ils ne me contraignent pas à les jeter -, le plaisir et le savoir reçus en regardant longuement les cartes de géographie se sont installés en moi de façon suffisamment profonde pour que je ne perde jamais, jusqu’à présent, l’habitude de m’en délecter, car toujours j’ai espéré des atlas et des mappemondes qu’ils me profitent davantage que les collections de timbres.
Parce que sa passion enfantine pour la carte géographique est demeurée intacte à l’âge adulte, parce que l’une d’entre elles, longtemps affichée sur son mur, a provoqué une cristallisation mystérieuse autour du nom de la ville de Churchill, dans l’état canadien du Manitoba, au bord de la baie d’Hudson, parce que les démons bienveillants des lieux et des noms se relaient sans relâche à ses oreilles (en un chassé-croisé exploré aussi par Emmanuel Ruben dans son excellent « Dans les ruines de la carte », à propos de Julien Gracq précisément, qui joue ici un rôle essentiel), Anthony Poiraudeau entreprend un séjour de quatre semaines dans ces confins arctiques, pour en extraire le matériau d’un texte futur qui, peut-être, sublimerait et soignerait cette béance géographique intime, condensée dans une forme d’appel du Grand Nord.
C’est lors de ces divagations imaginaires et répétées face à la carte d’Amérique du Nord que j’ai connu Churchill, et qu’elle a petit à petit pris consistance dans mon esprit. Bien loin au nord sur cette planche murale d’atlas, bien longtemps après que les regards ascendants ont laissé derrière eux la frontière de pointillés noirs qui sépare le rose des États-Unis et le jaune clair du Canada, longtemps encore après qu’on a laissé derrière soi les quelques noms clairsemés de villes et le tracé transversal d’un chemin de fer que la carte nomme « Pacifique canadien », assez loin pour arriver à mi-distance environ de la limite sud du Canada et de l’extrême Nord du monde, alors qu’on aborde les rivages de la baie d’Hudson, la grande mer intérieure descendue de l’océan Arctique, on arrive à un petit point, que la carte marque pourtant et nomme, au bord des eaux boréales, éloigné de tout autre et situé le plus au nord de tous les points que la carte indique sur le rivage de la baie d’Hudson, et qui s’y trouve baptisé : « Fort Churchill ». C’est en le retrouvant à loisir là, indiqué sur la planche d’atlas au bord de son rivage perdu, que le petit port de Churchill est progressivement devenu le point de fuite qui a longtemps polarisé ma vie intérieure vers sa plus étrange échappée.
Avec ces 140 pages publiées en octobre 2017 chez Inculte Dernière Marge, Anthony Poiraudeau nous offre un véritable miracle d’intelligence, de justesse et de vertige, parvenant à mêler avec subtilité des registres vitaux généralement disjoints, transformant les ingrédients de base d’un journal de résidence littéraire en une partition surprenante, machiavélique et bouleversante (on songera à un autre texte qui tord ainsi les règles d’un exercice bien connu, et c’est – sans hasard, sans doute – à nouveau Emmanuel Ruben, avec sa « Jérusalem terrestre »). Ancré dans la passion si ancienne de la carte, et dans les récits de Robert Louis Stevenson et de Jules Verne (un sentiment voisin m’étreint encore à la lecture de « Michel Strogoff », tout particulièrement – et constituait la base du billet Je me souviens qui lui est dédié, ici) qui viennent à son appui, c’est d’abord tout un registre intime qui se déploie précautionneusement, dans un mélange subtil de pudeur et d’auto-ironie, jouant (très sérieusement) avec le mythe de l’écrivain voyageur qui le hante, avec les déconvenues et les découvertes résolument inattendues.
À présent, la baie d’Hudson n’était plus qu’à quelques centaines de mètres de moi, je pouvais presque sentir sa masse lourde et sombre, salée et perpétuellement froide. Je n’avais plus qu’à marcher quelques minutes pour me tenir face à elle. Voir la baie d’Hudson : c’était sûrement la première chose que j’irais faire après avoir déposé mes bagages au logement que j’avais réservé, à quelques rues de là. J’attendis encore un peu avant de quitter les environs de la gare. J’étais loin, à des milliers de kilomètres de tout lieu familier ; plus loin de chez moi que je ne l’avais jamais été, plus au bout du monde et plus éloigné de la nature domestiquée qu’à aucun moment auparavant. J’aurais voulu voir le train repartir, pour sentir se refermer derrière moi la porte que j’avais franchie afin d’arriver jusque-là – pas nécessairement pour jouir de la garantie de ma séparation d’avec le monde que je venais de quitter, plutôt pour mieux me faire accepter la nécessité de rester là, de ne pas quitter ces lieux durant le mois que j’avais décidé d’y passer, et d’aller au bout de l’engagement que j’avais pris. Le train, cependant, n’allait pas repartir avant plusieurs heures, le personnel de bord me l’avait indiqué au cours du voyage, et je finis par quitter les environs de la gare sans attendre qu’un événement m’en donne le signal, et sans voir la machine et ses wagons retourner vers le Sud du Canada en me laissant à quai, comme un bagage oublié à une correspondance par son propriétaire. J’étais intimidé. Après avoir longtemps constitué Churchill, ou du moins l’idée que je me faisais d’elle, en un incomparable refuge mental contre le désespoir, ce qui n’impliquait en rien que je m’y rende véritablement, j’avais – un an plus tôt environ – fomenté un projet qui ferait sortir ce lieu lointain du statut strictement intérieur et intime dont je le dotais pour le déplacer dans le domaine du communicable, et justifierait que j’y entreprenne, finalement, un voyage : je voulus écrire sur Churchill, en raconter l’histoire, en décrire les paysages et déployer ce qu’elle peut présenter, mentalement et physiquement, à une personne qui en ferait son point de fuite.
Lancement d’une fusée au Churchill Research Centre ® Canadian Space Agency
En arpentant inlassablement le terrain, aussi volontairement limité soit-il, l’auteur en quête de domination de son sujet, parmi les possibilités distinctes de désillusion, au milieu des demi-mensonges et des petites vérités de l’économie touristique, confronté aux réalités économiques de l’heure et du lieu, transforme l’obsession en surprise et en production (et je comprends beaucoup mieux, rétrospectivement, l’écriture subtile du fort remarquable « Projet El Pocero » du même auteur, que j’avais en partie mal saisie à l’époque, en 2013). La lectrice ou le lecteur assiste ainsi, en direct, à la mutation accélérée (même au rythme indolent de la cité sub-arctique) d’une folie douce d’auteur acharné à comprendre ses rêves, retrouvant son sens politique premier en découvrant les ravages de l’impérialisme, ici comme ailleurs, et les élucubrations des assimilations forcées se voulant civilisatrices. En revanche, là où un Patrick Deville, dans « Équatoria » ou dans « Kampuchéa », ou plus encore un William T. Vollmann, dans « Les fusils » (texte qui me semble plus que jamais indispensable pour une lectrice ou un lecteur qui auront apprécié autant que moi ce magnifique vaccin-ci), situé sur un terrain au fond fort proche, déploient une économie littéraire de la profusion, du foisonnement et de la multiplication, Anthony Poiraudeau joue en grande finesse d’une mise en scène de la confidence, de l’humilité, de la rareté. Sa rencontre avec les déportations d’Amérindiens dans la deuxième moitié du vingtième siècle, officiellement nommées « relocalisations socio-économiques » par le gouvernement canadien (qui ne consentira des excuses pour ces tragédies qu’en 2016), n’en est ainsi que davantage poignante, intelligente et hautement frappante.
Les Dénés Sayisis au Camp n°10 (Churchill, 1957)
Une fois arrivés à Churchill, les Dénés Sayisi furent tout à fait livrés à eux-mêmes : comme rien n’était fait pour eux, malgré les promesses qui leur avaient été faites, ils commencèrent par planter des tentes au bord de l’estuaire, légèrement à l’écart de l’agglomération, et chassèrent le gibier qu’ils pouvaient trouver, des petits lagopèdes et des bernaches, et à pêcher des poissons dans la rivière. Comme les nombreux chiens qu’ils avaient d’abord pu emmener avec eux erraient souvent dans les rues de la ville et indisposaient les autres habitants, ceux-ci furent bientôt abattus par la police, et les Indiens s’en trouvèrent tout à fait empêchés de s’éloigner en traîneaux de fortune jusqu’à de plus généreux territoires de chasse et de pêche. Ils passèrent dans cette extrême précarité, et sous des tentes de peaux, leur premier hiver à Churchill (où le climat est beaucoup plus rude, et exposé aux vents arctiques, qu’au lac Duck), et puis l’année suivante, en 1957, sans pouvoir exercer leurs aptitudes à la chasse – que la Compagnie de la baie d’Hudson avait longtemps prisées – sur d’autres proies que le petit gibier des environs immédiats, et sans qu’aucune démarche d’intégration à la société moderne leur soit de toute façon accessible, tant ils avaient été soudainement et brutalement forcés de la rejoindre. La plupart d’entre eux, d’ailleurs, ne parlaient pas l’anglais, et ils se trouvaient condamnés d’emblée à être des marginaux dans la société à laquelle on venait de les accoler.
Avec cet ouvrage court, réjouissant et précieux, Anthony Poiraudeau nous offre bien un triple cadeau : un rappel intense de certains crimes passés (et présents : le féminicide des Amérindiennes demeure très contemporain), terriblement ordinaires et si facilement voués aujourd’hui à l’oubli, une grande leçon d’économie de moyens, jouant de l’allusion et de l’indication prudentes plutôt que de l’étalage massif des sources, et, comme une « Préparation du roman » radicalement alternative, une superbe interrogation sur ce qui, chez l’écrivain, peut devenir littérature – et sur les conditions de température et de pression, aussi paradoxales soient-elles, qui rendent possible cette chimie.
Anthony Poiraudeau
Anthony Poiraudeau - Churchill Manitoba - éditions Inculte/Dernière Marge
Charybde2