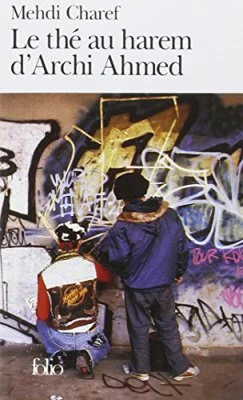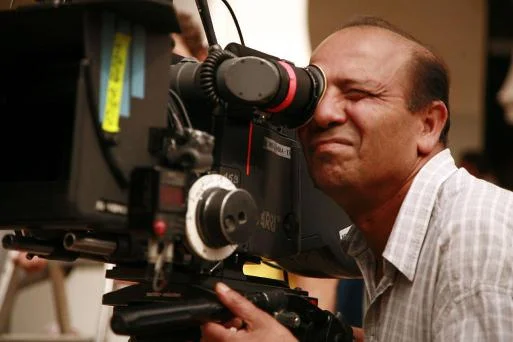Mehdi Charef, le petit quotidien de la haine ordinaire en HLM
Un coup de projecteur cru et fort, tendre et paradoxal, sur le creuset de la haine sociale au début des années 80.
Publié en 1983 au Mercure de France, le premier roman de Mehdi Charef, fils d’immigrés algériens ayant connu les cités provisoires et le grand bidonville de Nanterre dans les années 1960 et 1970, lui-même ouvrier affûteur en usine de 1970 à 1983, est souvent moins connu que le film qu’il en tira lui-même, sur les conseils de Costa-Gavras, en 1985 (c’est d’ailleurs par ce film que j’ai moi-même rencontré pour la première fois l’œuvre de cet auteur singulier).
Début des années 1980, dans ce qui ne s’appelle pas encore couramment une cité (et bien avant l’invention du terme de « sauvageons », dont l’archéologie serait elle-même hélas hautement instructive, comme nous le rappelait par exemple en x l’excellent slammeur D’ de Kabal), mais simplement un ensemble HLM fortement défraîchi, aux confins de Nanterre et de Colombes, héritier plus ou moins de fortune des honteux bidonvilles de la décennie précédente : Madjid, adolescent déscolarisé d’origine algérienne, traîne avec ses potes en attendant de trouver un travail qui ne veut guère de lui. Entassement et promiscuité familiale, conflits de générations, frictions sociales et (à peine) « communautaires » (là aussi, la popularisation de ce terme à partir de la fin des années 1990 mériterait une anthropologie politique à elle seule), racisme instinctif et ravages de l’alcoolisme, misère sexuelle et cynisme obligatoire, délinquance réflexe et code adolescent : le quotidien de Madjid est glauque, cru, dur, et bouché de sérieux cumulo-nimbus aux quatre coins de l’horizon.
– Je vais aller au consulat d’Algérie, elle dit maintenant à son fils, la Malika, en arabe, qu’ils viennent te chercher pour t’emmener au service militaire là-bas ! Tu apprendras ton pays, la langue de tes parents et tu deviendras un homme. Tu veux pas aller au service militaire comme tes copains, ils te feront jamais tes papiers. Tu seras perdu, et moi aussi. Tu n’auras plus le droit d’aller en Algérie, sinon ils te foutront en prison. C’est ce qui va t’arriver ! T’auras plus de pays, t’auras plus de racines. Perdu, tu seras perdu.
Parfois Madjid comprend un mot, une phrase et il répond, abattu, sachant qu’il va faire du mal à sa mère :
– Mais moi j’ai rien demandé ! Tu serais pas venue en France je serais pas ici, je serais pas perdu… Hein ?… Alors fous-moi la paix !
Elle continue sa rengaine, celle qu’elle porte nouée au fond du cœur. Jusqu’à en pleurer souvent.
On frappe à la porte d’entrée.
– Ce qu’il y a ? demande la mère, toujours en colère.
Elle quitte la chambre et Madjid se rallonge sur son lit, convaincu qu’il n’est ni arabe ni français depuis bien longtemps. Il est fils d’immigrés, paumé entre deux cultures, deux histoires, deux langues, deux couleurs de peau, ni blanc ni noir, à s’inventer ses propres racines, ses attaches, se les fabriquer.
Pour l’instant il attend… il attend. Il ne veut pas y penser, il ne supporte pas l’angoisse.
Madjid (Kader Boukhanef)
Mehdi Charef ne nous propose pas ici un essai, sociologique ou politique, mais bien un féroce instantané, dont la brutalité des faits vaut bien des discours, et dont la simplicité apparente, les élans à l’emporte-pièce et la crudité impressionnante ne masquent néanmoins aucune nuance de la complexité socio-politique ici à l’œuvre. Comme dans son roman « Le Harki de Meriem » (1989) ou dans « 1962, le dernier voyage » (2005), au théâtre, comme dans ses films « Marie-Line » (1999) ou « Cartouches gauloises » (2007), il sait à merveille camper des personnages emblématiques et inventer des situations (contre-) exemplaires, sans jamais sacrifier à la caricature. La violence est bien omniprésente, presque à tous les niveaux de la terrible échelle dont les barreaux se désolidarisent sous nos yeux de lectrice ou de lecteur : violences conjugales, violences sexuelles, violences économiques, violences racistes – aucun fard n’est déployé pour habiller d’excuses diverses le terrain des laissés pour compte, abandonnés de la République et des Trente Glorieuses, premières victimes sacrificielles des raidissements capitalistes en gestation (bien avant d’être sociétaux ou culturels, quoiqu’en dise la mode médiatique de nos jours).
Quant à Malika, elle raisonne Levesque, bourré comme une vache, les yeux rouges, haineux, pleins de violence, grimaçant de désespoir et de méchanceté, gueulant à Madjid quand il se décidait à venir :
– Barre-toi, bougnoule, va chez toi, sale bicot, je vais me la faire, cette salope !
Malika n’écoute guère les insultes de Levesque, elle le tient, elle ne le lâche plus jusqu’à ce qu’il s’essouffle.
– Je vais la tuer, cette pute, cette salope !
La salope, la pute, c’est sa femme Élise, le nez en sang, car le premier coup surprend toujours. Après elle les évite tant bien que mal en tournant autour de la table. Quand Levesque est en forme, las de tourner sans pouvoir mettre la main sur Élise, il retourne la table carrément avec tout ce qu’il y a dessus. Alors, là, c’est grave, et les secours doivent faire vite, car il coince sa pauvre femme et lui en met plein la tronche. De quoi se cloîtrer pendant une bonne quinzaine, en attendant que les bleus disparaissent du visage.
Dans ce cloaque où bouillonnent la haine et le désespoir, Mehdi Charef est d’autant plus intelligemment poignant lorsqu’il nous donne à lire, comme incidemment, les nombreuses manifestations d’amour, d’amitié ou de tendresse – qui sont peut-être loin d’être résiduelles ou anecdotiques, en réalité. Dans un tout autre contexte (quoique ?), celui de l’Angleterre post-thatchérienne de la relégation des pauvres et des insuffisamment armés pour la lutte capitaliste, Richard Milward a su aussi, dans son « Pommes » (2007) comme dans son « Block Party » (2009), ces bouffées d’humanité paradoxales et rageuses.
Madjid prend le petit homme par le bras et le ramène sur le trottoir. La bagnole passe. Le jeune homme et son père se remettent sur la chaussée, les bas-côtés étant encombrés par les voitures. Madjid sort deux cigarettes de son paquet, qu’il allume.
Il en donne une à son père. Le vieux prend la cigarette avec la même éternelle expression dans le regard, un mélange de vide et de lointain. Madjid l’observe un instant, pitié et tendresse montent en lui, l’émeuvent pour son malade de père. Le papa a perdu la raison depuis qu’il est tombé du toit qu’il couvrait. Sur la tête. Il n’a plus sa tête, comme dit sa femme. Elle s’en occupe comme d’un enfant, un de plus. Elle le lave, l’habille, le rase, et lui donne quelques sous pour son paquet de gauloises, son verre de rouge.
Sans aucun prêche de sa part, Mehdi Charef nous expose crûment à quel point l’avidité et l’indifférence hautaine des uns engendre fatalement, cruellement, la déshérence et la haine des autres, fût-ce par moteurs économiques et sociaux interposés, loin des trop commodes « pentes culturelles ».
Le Thé au harem d'Archi Ahmed de Mehdi Charef, Folio
Coup de cœur de Charybde2
l'acheter ici