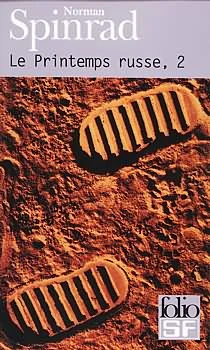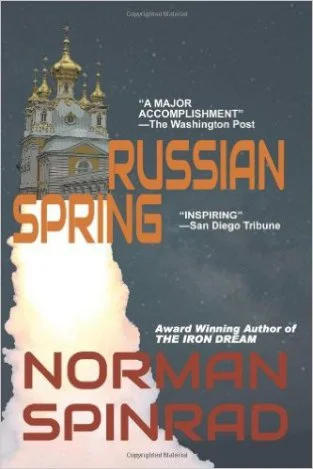Spinrad, le visionnaire de la realpolitk à l'Est
Rêve spatial humain et realpolitik politicienne, dans un roman complexe, poignant, et curieusement intemporel malgré ses ancrages historiques alternatifs.
Troisième lecture, ces jours-ci, de l’un de mes romans préférés de Norman Spinrad, fortement ancré dans ma mythologie intime, après sa découverte en 1992 et une première relecture en 2004 : « Le printemps russe », publié en 1991 et traduit en français l’année suivante par Luc Carissimo chez Denoël dans la bleue collection Présences.
À sa parution, quelques mois avant le putsch « conservateur » de Moscou voulant notamment mettre fin in extremis à la perestroïka et à la glasnost gorbatchéviennes, ce roman audacieux et difficile à classer immédiatement sera sans doute trop souvent considéré comme un ouvrage d’anticipation politique et géopolitique (avec l’adhésion au moins partielle de l’auteur lui-même à cette lecture, comme en témoigne sa préface à l’édition française) : avant que l’URSS n’éclate, le réformisme gorbatchévien parvient à ses fins, et c’est une Union Soviétique économiquement et politiquement assez proche de la Chine d’aujourd’hui (dirigée par l’appareil du Parti communiste, mais utilisant ses ressources sur un mode nettement converti au capitalisme) qui se rapproche de l’Union européenne, puissance dominante face à des États-Unis d’Amérique qui se sont, d’une certaine façon, pris à leur propre piège reaganien de Guerre des Étoiles, croulant sous la dette et la désindustrialisation, entièrement asservie de facto par son complexe militaro-industriel.
L’Amérique devenait le pays du tiers-monde le mieux défendu de la Terre et ses plus brillants citoyens se prêtaient au jeu en pissant dans des bouteilles, tandis que les Russes vendaient leurs Antonov, allaient sur Mars et que la Communauté européenne rêvait d’hôtels de luxe en orbite géostationnaire.
Même si certaines intuitions ou spéculations géopolitiques du roman restent saisissantes plus de vingt-cinq ans après sa publication (la tentation américaine permanente du repli hargneux sur son pré carré, le cynisme fatigué européen, l’oscillation russe entre impérialisme et désostracisation, les réactions possibles face aux indépendances ou aux sécessions – avec une étonnante anticipation, toutes proportions gardées, de la révolution orange ukrainienne de 2004-2005), ce n’est toutefois pas à mon avis l’intérêt profond de ce « Printemps russe », et vouloir l’y réduire serait sans doute une fois de plus confondre la valeur spéculative de la science-fiction avec de simples exercices de prospective ou de futurologie.
L’inévitable, bien entendu, finit par arriver.
L’armée de l’air étudia avec attention le projet avant de passer au stade du prototype et un petit futé pigea ce qui se tramait. Un lundi, par un petit matin blême, la patrouille de contrôle des urines débarqua en force et fit pisser tout le monde dans des éprouvettes.
De tels contrôles surprise n’étaient pas totalement inhabituels, mais quand ils prirent des échantillons sanguins pour corroborer le moindre soupçon d’infraction aux règlements antidrogues, tout le monde comprit que le pot aux roses était découvert.
L’analyse d’urine de Rob se révéla négative, mais on trouva dans son sang des traces infinitésimales de tétrahydrocannabinol, ce qui n’aurait peut-être pas suffi à l’écarter à vie du programme, s’il avait choisi de contester son licenciement devant les tribunaux. De sorte que, plutôt que d’essayer de le coincer directement, les autorités militaires employèrent des moyens détournés.
Elles abandonnèrent le projet P.F.A., avant le stade du prototype, ce qui coûta un paquet à Rockwell, puis elles laissèrent clairement entendre que les chances qu’avait Rockwell de décrocher le programme de remplacement étaient quasiment nulles tant que Rob Post émargeait chez eux. Qui plus est, il ne devait pas lui être permis de démissionner, il fallait qu’il soit proprement viré pour mauvaise gestion des fonds de l’armée.
Ce que firent sans grande réticence les dirigeants de Rockwell quand ils eurent calculé ce que leur avait coûté l’abandon de la P.F.A. Rob Post fut lourdé en fanfare et Rockwell obtint le contrat de la luge orbitale.
Rob, comme en avaient décidé les militaires, ne travailla plus jamais pour le Programme, du moins directement. Il gagnait précairement, sinon pauvrement, sa vie comme consultant technique pour divers projets extérieurs au Programme, grâce à ses nombreuses relations dans la communauté scientifique californienne. En même temps, il organisait ces soirées à peu près tous les mois, pour entretenir, triste et désespéré, ses relations avec ceux qui, comme Jerry, travaillaient toujours pour le Programme.
Ou pour ce qu’il en restait.
La première réussite majeure du roman, intacte à la troisième lecture, est celle d’un ressenti intime, à la fois politique, technique et humain, de la manière dont fonctionnent les complexes militaro-industriels au sein du capitalisme tardif. Loin de la simple dénonciation abrupte, Norman Spinrad fait l’effort réel – comme d’ailleurs le Kim Stanley Robinson de « La Côte dorée », à peu près à la même époque (1989), mais avec un ton différent, plus nettement documentaire, comme le montrera l’apothéose de sa « Trilogie climatique » en 2004-2007 – d’appréhender en profondeur les mécanismes humains et financiers à l’œuvre dans le domaine – comme on les retrouve par exemple, bien loin de la science-fiction, dans la puissante biographie consacrée au maverick John Boyd par Robert Coram (« The Fighter Pilot Who Changed the Art of War », 2002).
Par ailleurs, dans le même ordre d’idées mais obliquement, on peut noter la finesse avec laquelle Norman Spinrad est capable d’appréhender, d’anticiper et de transfigurer les mécanismes corporate contemporains, de leur juridicisation croissante et de l’interpénétration des dites ressources humaines et des interprétations pénales de pans entiers du « business », à rapprocher de la patte d’un Walter Jon Williams (« Câblé », 1986) ou d’un Bruce Sterling (« Les mailles du réseau », 1988), proximité qui ne surprendra guère si l’on se souvient à la fois que l’auteur, dès sont « Jack Barron et l’éternité » de 1969, est un fin observateur de la pratique réelle du pouvoir dans nos sociétés, d’une part, et qu’il fit largement figure de précurseur, de compagnon de route et de protecteur de ses cadets du mouvement littéraire cyberpunk, à bien des égards, d’autre part.
« Vous avez pris connaissance des termes de l’amendement à la Loi sur la sécurité nationale, Mr. Reed ?
– Non. Je ne suis pas juriste et je ne m’intéresse pas à la politique. »
Coldwater tapa autre chose sur son ordinateur. « Selon nos renseignements, vous avez reçu une proposition officielle d’emploi de la part de l’Agence spatiale européenne…
– Comment avez-vous trouvé ça ? laissa échapper Jerry qui le regretta aussitôt.
– Ce n’est pas du ressort de mon service, Mr. Reed, déclara Coldwater d’un ton hésitant. Niez-vous la chose ? »
Jerry réfléchit un instant. Manifestement, ils étaient au courant de tout, jusqu’au montant du salaire et aux avantages en nature. Il ne servait à rien de chercher à jouer au plus fin, pas plus, d’ailleurs, que de leur faciliter le travail.
« Non, dit-il. Est-ce un crime ?
– Pas tant que vous n’avez pas accepté. Étant donné que vous avez eu connaissance d’un projet militaire de moyenne sécurité, il vous est interdit par la Loi sur la sécurité nationale d’accepter un emploi en dehors des États-Unis ou dans une entreprise étrangère opérant sur le territoire national. Si vous agissiez ainsi, vous pourriez être accusé d’espionnage et poursuivi en conséquence. L’ESA vous ayant fait une telle proposition, vous êtes requis de signer une déclaration sous serment comme quoi vous n’allez pas accepter si vous voulez conserver un passeport américain valide. »
Il chercha dans un tiroir, en sortit un document qu’il fit glisser vers Jerry, puis prit un stylo-bille dans sa poche intérieure et le posa à côté du papier.
« Et si je refuse de signer ?
– Je me verrai alors dans l’obligation d’exiger que vous me remettiez votre passeport.
– Et si je ne le fais pas ? »
La deuxième grande réussite, et sans doute la plus durable et la plus spectaculaire, du « Printemps russe », c’est sans doute d’avoir saisi en profondeur, toute vibrante, la composante intime du rêve spatial humain. À travers la figure de l’Américain Jerry Reed, exilé en Europe pour pouvoir continuer à travailler sur un programme spatial digne de ce nom, écartelé entre ses sentiments privés, sa famille, son amour de la science et de l’espace, et les intérêts économiques et politiques déployés autour de lui (même si c’est souvent « loin au-dessus » de lui), Norman Spinrad nous a offert pour longtemps une quintessence du vital rêve adolescent confronté aux réalités hostiles, naviguant entre les obstacles réels et ceux issus de la propre naïveté du rêveur, mais si profondément nécessaire – rejoignant et incarnant entre autres, dans les chairs et l’âme meurtries de son protagoniste, tant les réflexions, d’une Ursula K. Le Guin dans « Le langage de la nuit » ou d’un Fredric Jameson dans « Archéologies du futur », que les constats plus critiques du Thomas Disch de « On SF », ou l’épopée scientifique récapitulative et exploratoire du Kim Stanley Robinson de « La trilogie martienne ».
La politique ! La politique politicienne ! Pourquoi ne pouvait-on pas laisser les gens libres de faire ce qu’ils voulaient ?
On l’avait assurément laissé faire ce qu’il voulait durant la phase de conception du projet Icare. Ian Bannister était un ingénieur compétent qui dirigeait son équipe de façon strictement pragmatique, il appréciait l’exigence que Jerry avait de la luge orbitale et ce dernier était heureux comme un poisson dans l’eau.
La politique politicienne n’avait pas pointé le nez avant la fin de la phase de recherche, quand le prototype de remorqueur spatial avait été déclaré prêt pour la production et l’équipe de conception dispersée.
Une grande fête avait été organisée dans l’atelier du Bourget pour célébrer l’achèvement du projet. Le bar était dressé sur des tréteaux devant le prototype, le champagne coulait à flots, on avait porté de nombreux toasts au fruit de leur long labeur et tout le monde était un peu parti quand Nicola Brandusi avait pris la parole pour les remercier du travail accompli et annoncer leurs nouvelles affectations.
Bannister était promu directeur de projet adjoint de l’équipe de conception préliminaire d’Espaceville. Kurt Froehner était chargé de superviser la mise au point du dernier étage du réservoir des fusées Energia. Brizot se voyait confier les systèmes de manœuvre et Constantine le collier d’arrimage du réservoir.
Jerry attendait avec une impatience croissante que Brandusi en arrive à lui. Tous ceux de l’équipe, jusqu’au dernier, semblaient avoir obtenu un poste intéressant sur le projet Espaceville ou les citernes de ravitaillement, et ils le méritaient bien. Mais qu’allait-il lui rester ?
« Alain Parmentier a été nommé ingénieur en chef des essais au sol des systèmes de guidage et de propulsion du projet Icare et Jerry Reed sera son adjoint, promotion assortie d’une augmentation de 500 écus par mois… »
Cet affront avait été annoncé avec un sourire béat, comme s’il s’agissait d’un morceau de choix. Jerry en était resté bouche bée tandis que Brandusi passait en vitesse au suivant de sa liste.
Les essais au sol ! Tester du matériel existant ! Ce n’était pas juste ! C’était une insulte ! Il était concepteur, pas simple technicien du contrôle de qualité ! Sans lui, les systèmes de guidage et de propulsion n’existeraient même pas !
Si l’on ajoute à cela une belle histoire de famille, de transmission et de passion, une fibre libertaire où le sexe joue pleinement son rôle, une fascination pour l’intellectuel progressiste américain mythique dès lors qu’il sait vraiment jouer au poker, et une drôle de déclaration d’amour à la ville de Paris, on obtient bien in fine un grand, un très grand roman, constellé de défauts réels et cependant mineurs, mais fermement installé dans l’un des noyaux essentiels de la science-fiction, si ce n’est de la littérature dans son ensemble, celui consistant à donner les munitions permettant aux rêves de vivre, pour le meilleur de l’humanité.
Le Printemps russe de Norman Spinrad, éditions Denoël/Folio SF
Coup de cœur de Charybde2
l'acheter ici