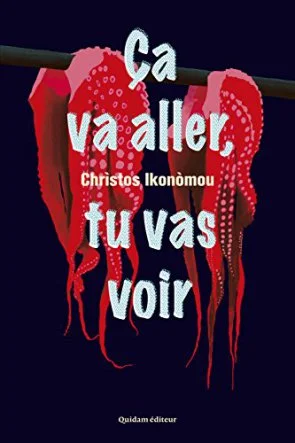Pire que le Pirée ? Athènes dans sa violente pauvreté, vue par Chrìstos Ikonòmou
Au Pirée, de nos jours, on ne va pas bien du tout.
Publié en 2010, traduit en français en 2016 chez Quidam par Michel Volkovitch, le deuxième recueil de nouvelles du Grec Chrìstos Ikonòmou nous entraîne dans les rades des quartiers populaires du Pirée, de nos jours, là où des hommes et des femmes, volubiles ou presque mutiques, à demi-mot ou dans de longs et intenses monologues, autour d’un verre d’ouzo ou de tsipouro, tentent encore un peu de vivre et d’exister, de résister encore un peu à la pauvreté qui les submerge inexorablement, cumulant plusieurs petits boulots comme autant de jongleurs tristes, ou assistant médusés à l’effritement de la valeur de leurs retraites, baignés par la rumeur, au loin, de riches qui s’empiffrent en répétant à l’occasion les mantras du bénéfique ruissellement capitaliste.
Entretemps il y a du nouveau dans le quartier. La semaine dernière la municipalité a distribué ces grandes bennes bleues pour le recyclage une au coin de chaque rue avec des brochures et des sacs spéciaux pour les papiers et les conserves qu’ils disent. Le progrès. Et jeudi soir on était chez Satanas quand l’amiral est venu nous demander si on savait ce qui est arrivé à Sofrònis, celui qui habite à côté de l’école.
Non, a dit Vàyos. Il est mort ?
Il a pété les plombs le malheureux a dit l’amiral. Hier soir mon fils rentrait du boulot et il tombe sur lui en train de se démener pour se glisser dans la poubelle du recyclage. Il est arrivé juste à temps. Qu’est-ce que tu fais là mon vieux Tàssos ? qu’il lui dit. Tu es devenu fou ? Tu veux aller dans les ordures ? Et l’autre qu’est-ce qu’il lui dit ? Laisse-moi Stèfanos. Laisse-moi s’il te plaît. L’homme qui laisse mourir sa femme sans l’aider faut le jeter aux ordures. Laisse-les m’emmener pour me recycler je deviendrai peut-être meilleur. Écoutez les gars. Écoutez ce qui se passe dans le monde. Mon fils a eu un mal fou à le calmer. Après ça il paraît qu’il s’est assis dans un coin en riant tout seul comme un malade. On ne va pas bien du tout. Voilà ce que j’ai à dire. On ne va pas bien du tout. (« Mao »)
Seize nouvelles acharnées, dosant avec une extrême exactitude la violence des échanges– dans un milieu qui n’est plus, depuis longtemps, tempéré – et la solidarité instinctive de celles et ceux qui n’ont plus grand-chose à perdre, même si elle est authentiquement en lambeaux désormais. Seize nouvelles qui font d’un cochon-tirelire un emblème poignant, tragique et dérisoire (« Èlli, fais quelque chose, nourris le cochon rose »), qui s’accrochent à un conte d’Andersen pour conserver une bribe de sens à une existence en voie de dissolution avancée (« Le petit soldat de plomb »), qui oscillent furieusement entre le crime et la folie dans la nuit insomniaque et obsessionnelle (« Mao »), qui tentent de calmer provisoirement la faim et la honte autour d’un mythique billet de cinquante euros (« Et un œuf Kinder pour le petit »), qui finissent par concevoir une boucle absurde de protestation sous-symbolique (« Pancarte sur manche à balai »), qui voient dans une machine à glaçons le résumé de ce qu’est devenue la vie (« Le sang de l’oignon »), qui constatent avec résignation rêveuse qu’il y a un fond sous le fond (« Ça va aller, tu vas voir »), qui réduisent le monde à la dimension d’une file d’attente nocturne devant la Sécurité sociale (« Ce qu’ils avaient sur eux »), qui contemplent dans les changements survenus à un carrefour la vie qui a elle-même sombré (« Moustache au charbon », une des plus belles nouvelles du recueil), qui voient des rêves pourtant modestes disparaître brutalement en cendres (« Étrangères exotiques »), qui voient le nœud coulant d’une amarre comme un résumé de ce qu’est devenu une existence (« Pour les pauvres »), qui mesurent le sens exact de la métaphore consistant à être enfermé à l’extérieur de la vie (« Le lien entre les corps »), qui doivent se résoudre à brûler même les plus ténus des rêves d’enfance (« Sors et brûle ça »), qui attendent une fin muette (« Pipol are strendj »), qui avalent, concrètement, des clous (« Le salaire des pingouins »), ou qui en viennent enfin à considérer le hasard de l’expropriation comme une forme d’ultime bénédiction (« Petit bout par petit bout, ils me prennent tout »).
Tàkis travaille ici comme serveur le soir de cinq heures à minuit ou une heure ou point d’heure. Le matin il travaille à la mairie en CDI. Il a deux boulots parce qu’il a deux enfants. Sa femme Vàsso est morte quarante-neuf jours plus tôt. Elle était en voiture à Fàliro quand elle a eu un infarctus et un passant l’a emmenée au Metropolitan – elle était encore vivante elle luttait ne cédait pas – mais là un problème s’est posé car on a refusé de la prendre en charge si l’homme ne payait pas son admission une histoire comme ça et le type a protesté naturellement – il ne la connaissait pas il passait par là quelle chose absurde on lui demandait là – et tandis que les pourparlers traînaient Vàsso est morte là dans le couloir de l’hosto entre des inconnus, loin de Tàkis et de ses enfants et Tàkis dit que s’il était un homme un vrai s’il avait deux sous de dignité il aurait dû le même jour entrer dans l’hosto avec deux grenades et faire sauter tout le bordel et ses habitants, médecins infirmières directeurs, tous ces guignols et quelques autres encore. S’il était un homme un vrai s’il avait le sens de l’honneur s’il n’avait pas deux enfants et des prêts à rembourser et son appartement sous hypothèque. (« Moustache au charbon »)
Chrìstos Ikonòmou
Il n’y a guère d’issues, ici : si la faconde et la gouaille du langage constituent bien un ultime soutien, elles sont à chaque détour engoncées dans une résignation teigneuse et mortifère, dans le seul souci de la survie – et plus toujours, désormais. On peut évoquer à bon droit le souvenir des grands personnages de Robert Guédiguian, assistant depuis leurs réduits de l’Estaque marseillaise, à la mise en place fanfaronne d’un nouveau système économique dans lequel l’humain est, plus que jamais, jetable – plutôt que recyclable. Mais vint gans ont passé : il faut immédiatement y ajouter la dose de désespoir cruel et de colère rentrée qui irrigue maintenant, par exemple, le « Victoria n’existe pas » de Yannis Tsirbas. Même le soleil est loin, masqué, caché, enfoui dans une perpétuelle et laiteuse grisaille. Il n’y a plus de place ici pour les anciennes forces frugales de la nature, qu’elles aient été le « Zorba » de Kazantzakis ou le « Colosse de Maroussi » d’Henry Miller. La superbe postface de Michel Volkovitch fournit l’indispensable éclairage crépusculaire à l’issue du recueil : il n’y a plus, ici, de révolte, autre que très ponctuelle et très inefficace. La peur économique règne partout en maître.
Le nuage grandit encore et nous cache la mer.
Un faux sapin dégringole du balcon d’en face et tombe en tournoyant sans bruit dans le vide. Je crois que c’est la chose la plus terrifiante que j’aie vue de ma vie.
Mais non, dis-je. Le plus terrifiant, c’est le travail. C’est attendre la paie tous les 15 et les 30 du mois. Diviser ta vie en tranches de quinze jours. Savoir que si ça les fait bander, les patrons, de ne pas te payer une fois ou deux ou dix tu ne peux rien y faire. Ta vie entière est entre leurs mains. Diviser ta vie en tranches de quinze jours. C’est ça le plus terrifiant.
Je rentre, dit Lèna. Je ne supporte pas quand tu parles comme ça. Je ne veux pas voir ça. Allons viens je te dis.
Mais nous n’allons nulle part. Nos verres à la main nous restons silencieux à regarder la pluie qui approche venue du couchant. Nous regardons le rideau de pluie noir qui se referme lentement sans bruit et qui lentement sans bruit engloutit les formes les couleurs et la rumeur du couchant.
Ce qu’en dit superbement Lou Dev dans Un dernier livre avant la fin du monde est ici.
Ça va aller, tu vas voir de Chrìstos Ikonòmou, éditions Quidam
Coup de cœur de Charybde2
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.