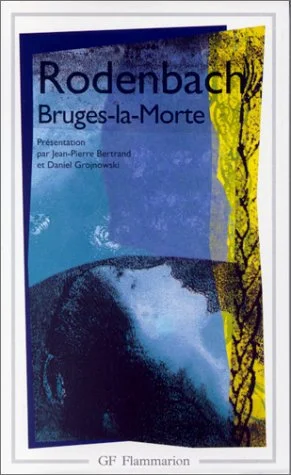Georges Rodenbach : Bruges XIXe en prémisse surréaliste romanesque
La femme aimée et la ville, toutes deux défuntes, unies en un symbolisme extrême et curieusement émouvant.
Publié en 1892, le roman le plus célèbre du poète symboliste belge Georges Rodenbach demeure encore aujourd’hui une étoile mystérieuse de la littérature. Très court (on parlerait sans doute aujourd’hui plutôt de novella), il offre à la fois un condensé puissant de toute une mythographie « fin de siècle », rempli de désespoir pris au sérieux et de mélancolie ultime, qui en fait un compagnon de route essentialisé de son ami Joris Karl Huysmans, la fascination pour l’occultisme en moins, et d’une critique sociale – qui ne dit jamais son nom – incarnée dans la ville de Bruges, véritable anti-héroïne de ce récit d’amour mis à l’épreuve de la mort, approchant du fantastique – sans en utiliser aucun ingrédient identifiable -, qui saura aussi toucher plus tard l’André Breton de « Nadja » (1928) – et qui dénote une étrange correspondance avec le George du Maurier de « Peter Ibbetson » (1891).
Le jour déclinait, assombrissant les corridors de la grande demeure silencieuse mettant des écrans de crêpe aux vitres.
Hugues Viane se disposa à sortir, comme il en avait l’habitude quotidienne à la fin des après-midi. Inoccupé, solitaire, il passait toute la journée dans sa chambre, une vaste pièce au premier étage, dont les fenêtres donnaient sur le quai du Rosaire, au long duquel s’alignait sa maison, mirée dans l’eau.
Il lisait un peu : des revues, de vieux livres ; fumait beaucoup ; rêvassait à la croisée ouverte par les temps gris, perdu dans ses souvenirs.
Voilà cinq ans qu’il vivait ainsi, depuis qu’il était venu se fixer à Bruges, au lendemain de la mort de sa femme. Cinq ans déjà ! Et il se répétait à lui-même : « Veuf ! Être veuf ! Je suis le veuf ! » Mot irrémédiable et bref ! d’une seule syllabe, sans écho. Mot impair et qui désigne bien l’être dépareillé.
Pour lui, la séparation avait été terrible : il avait connu l’amour dans le luxe, les loisirs, le voyage, les pays neufs renouvelant l’idylle. Non seulement le délice paisible d’une vie conjugale exemplaire, mais la passion intacte, la fièvre continuée, le baiser à peine assagi, l’accord des âmes, distantes et jointes pourtant, comme les quais parallèles d’un canal qui mêle leurs deux reflets.
Hugues Viane, veuf et amoureux fou éternel, est ainsi venu s’enterrer à Bruges, « ville morte », pour y veiller sur le mausolée de feue son épouse, mental en lui et physique en une chevelure flamboyante et néanmoins mortuaire. Menant une vie réglée comme une véritable partition de la mélancolie, il semble tout disposer à s’éteindre doucement, sans bruit, au fil des canaux de la « Venise du Nord », gloire passée devenue authentiquement secondaire par la fuite de la mer à quelques kilomètres.
Mais plus tard, resté seul, il s’était ressouvenu de Bruges et avait eu l’intuition instantanée qu’il fallait s’y fixer désormais. Une équation mystérieuse s’établissait. À l’épouse morte devait correspondre une ville morte. Son grand deuil exigeait un tel décor. La vie ne lui serait supportable qu’ici. Il y était venu d’instinct. Que le monde, ailleurs, s’agite, bruisse, allume ses fêtes, tresse ses mille rumeurs. Il avait besoin de silence infini et d’une existence si monotone qu’elle ne lui donnerait presque plus la sensation de vivre.
Fernand Khnopff, « Bruges – L’entrée du béguinage », 1904.
La rencontre, d’abord comme une ombre esquissée, puis comme une véritable obsession, d’une actrice de théâtre présentant une ressemblance fulgurante avec la morte crée toutefois rapidement une spirale mouvante qui entraîne en elle le veuf, au grand scandale étouffé de la ville retenant son souffle – ville bardée de convenances, de bienséances et d’extrêmes religiosités, qu’incarne à la perfection l’emblématique vieille servante du veuf, et à la perplexité de la lectrice ou du lecteur voyant se dérouler, inexorablement, ce qui se devine très vite comme un drame intime de première grandeur.
La ville, elle aussi, aimée et belle jadis, incarnait de la sorte ses regrets. Bruges était sa morte. Et sa morte était Bruges. Tout s’unifiait en une destinée pareille. C’était Bruges-la-Morte, elle-même mise au tombeau de ses quais de pierre, avec les artères froidies de ses canaux, quand avait cessé d’y battre la grande pulsation de la mer.
Concentré extrême des thématiques qui hantèrent les poètes de la fin du XIXe siècle, épuré jusqu’au diaphane dans son écriture, offrant une palette vive (alors même que tout y est proposé en teintes passées) de motifs qui deviendront au fil du temps les clichés post-romantiques d’une époque enfuie, « Bruges-la-morte » conserve un curieux pouvoir d’émotion, que renforce son caractère de roman illustré de photographies, unique pour l’époque (et alors totalement déroutant – les notes de la superbe édition Garnier-Flammarion conduite par Jean-Pierre Bertrand et Daniel Grojnowski en 1998 témoignent de l’embarras à peine poli des critiques de l’époque face à cette incongruité presque incompréhensible). Passée la légère incrédulité d’une lecture contemporaine confrontée à cette beauté volontairement fanée et à cette vie menée au ralenti assumé, on peut néanmoins sans peine reprendre les mots de Stéphane Mallarmé, ami et admirateur de Georges Rodenbach, adressés à l’auteur : « Votre histoire humaine si savante par instants s’évapore ; et la cité en tant que le fantôme élargi continue, on reprend conscience aux personnages, cela avec une certitude très subtile qui instaure un pur effet. Toute la tentative contemporaine de lecture est de faire aboutir le poème au roman, le roman au poème, mais sans doute avec une juxtaposition moins exacte qu’ici ; et sans votre magie. ».
Adapté au cinéma une première fois en 1915 par Evgueni Bauer, le roman a donné lieu au beau film « Brugge. Die Stille » de Roland Verhavert en 1981.
Georges Rodenbach
Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach, Garnier-Flammarion poche
Coup de cœur de Charybde2
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.