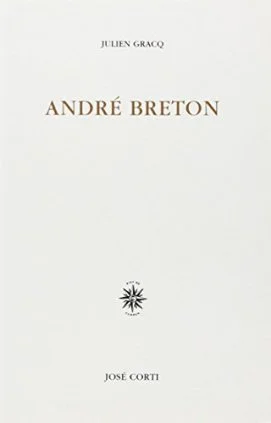Le Commandeur Breton par Julien Gracq
Sur André Breton, la première grande œuvre critique de Julien Gracq.
Écrite en 1946 durant quelques mois de relâche entre deux affectations de l’Éducation Nationale, publiée en 1948 chez José Corti, cette étude sur André Breton est la première grande incursion de Julien Gracq dans la critique littéraire.
Comme cela fut noté à l’époque, c’est à un André Breton relativement « passé de mode », après guerre, que l’auteur entend ici, de plus d’une façon, rendre justice. Mais le sous-titre, « Quelques aspects de l’écrivain », affirme sans ambages qu’il s’agira avant tout d’écriture, et non pas de mérite politique ou humain. En définissant de son mieux, au plus près des textes, ce qui caractérise le verbe d’André Breton, c’est aussi, en creux, ce qui l’y intéresse, lui, Julien Gracq, qu’il dessine au long de ces 200 pages d’une belle densité, et, déjà, annonçant peut-être ses écrits ultérieurs « non-fictionnels », un programme et une méthode assignés à la critique qu’il ébauche ainsi.
La dernière scène de Don Juan pourrait servir à illustrer d’une manière tragique une tentation congénitale à l’artiste. Il vient toujours dans sa carrière un moment assez dramatique où s’invite d’elle-même à souper au coin de son feu une statue qui n’est autre que la sienne, dont la poignée de main pétrifie, et dont quelque chose du regard médusant passe avec un éclat glacial dans un des vers les plus célèbres de Mallarmé. Une lutte épuisante, jusqu’à la dernière seconde, contre l’étreinte paralysante de l’homme de pierre fait souvent – et on serait tenté de dire : à notre époque surtout – la trame pathétique de toute une vie d’artiste en fuite devant sa propre effigie, acharné à ne pas se laisser rejoindre au moins avant le seuil final – à ne pas se laisser dévorer avant l’heure par le monstre qui croît et se fortifie du sang qu’il perd. À un abandon sans vergogne au premier signe des bras de marbre se reconnaissent sans doute ces siècles classiques qu’on s’acharne à nous représenter comme si sévères pour eux-mêmes. Mais pour nous, le coureur en dût-il se désunir disgracieusement, nous mettons une joie angoissée à suivre ces zigzags de bête forcée, obstinée encore à donner le change, à brouiller les pistes – et à la seconde même où il est terrassé, quelque chose en nous de très profond surgit pour lui prêter le mot final du Caligula de Camus : « Je suis encore vivant ».
Il n’est guère d’écrivain vivant qui s’adonne aussi libéralement que Breton à cette passion de bouger qui consterne aussi fâcheusement les critiques que les photographes.
En cinq parties, Julien Gracq élucide en virtuose l’importance, bien au-delà de la métaphore, du « mouvement » chez André Breton (distinguant habilement la manière dont celui de mots et celui des idées organisent y organisent leur incessant télescopage), des entrées en résonance, jusque dans le détail de l’écriture, avec l’hégélianisme (et ainsi le marxisme) qui en irrigue les cavités sous-jacentes, de sa revendication de l’aventure par les mots, à l’opposé de la tentation du « journal », ou encore de l’omniprésence de l’électricité et du magnétisme, atteignant nombre de métaphores en leur essence intime.
Le culte de la poésie s’est renforcé en eux dans la proportion exacte où elle leur est apparue, de plus en plus clairement, comme un moyen de sortie, un outil propre à briser idéalement certaines limites. Dans la mesure même où elle s’identifie pour lui à un « esprit d’aventure au-delà de toutes les aventures », Breton est perpétuellement tenté d’en déceler le surgissement partout où s’ouvrent pour lui les failles par lesquelles on peut espérer d’échapper à l’humaine condition. Elle triomphe dans la folie (L’Immaculée Conception), étincelle dans le « hasard objectif », dans la « trouvaille » – brille de tous ses feux dans « l’amour fou », comme dans toute entreprise de libération de l’homme. (Monnerot indique avec justesse que, de manière obscure, pour les surréalistes, la poésie « communique » avec la révolution). Ce que Breton en vient finalement à baptiser « poésie », c’est tout fil d’Ariane dont un bout traîne à portée de sa main et permet de l’aider à sortir du labyrinthe.
Déjà perce ici la rare faculté de Julien Gracq d’établir une profonde empathie critique avec un texte, ou un ensemble de textes, de leur rendre justice dans la plus parfaite honnêteté, tout en les courbant avec succès en vue de ses propres desseins littéraires, mouvement qu’il ira amplifiant au fil du temps et de ses écrits ultérieurs.
On multiplierait sans grande peine les exemples de ce retournement de l’exigence syntaxique. Breton n’est certes pas le premier à l’avoir ainsi employée à la façon d’un piège continuel, apte à saisir ce qui se meut perpétuellement aux confins du contenu délibéré de la phrase, à l’avoir mise au service d’une langue qui se veut avant tout agglutinante. D’autres avant lui avaient utilisé à l’occasion cette vertu de la syntaxe d’être – autant qu’à discipliner le contenu concerté d’une phrase – propre à certains usages externes. Mais on s’avise à partir de lui qu’il est possible de concevoir une lame assez flexible, assez souple – quoique du meilleur métal – pour passer à travers tous les joints, tous les défauts de l’armure logique. Mais à Breton revient sans doute le mérite d’avoir le premier tenu délibérément entre ses doigts l’armature de la langue française, qu’il a su rendre infiniment flexible, à la façon d’une baguette de coudrier.
André Breton de Julien Gracq (éditions José Corti)
Coup de cœur de Charybde2
pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.