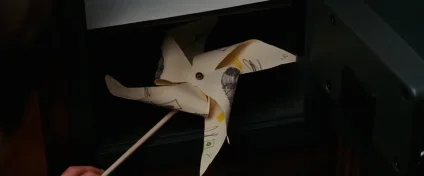Lucie Taïeb : la peur au fond des mots
Vivre avec la peur, même ou surtout en rêve : comment en inventer la lutte ?
Publié en février 2016 aux éditions de l’Ogre, le premier roman de Lucie Taïeb frappe fort, au cœur cauchemardesque pourtant diffus des peurs quotidiennes avec lesquelles nous sommes toujours davantage forcés d’apprendre à vivre.
Prise dans un faisceau de rêves qui n’en sont guère, de visions nocturnes à la vraisemblable terrible rémanence, la narratrice, traductrice de l’anglais au français pour vivre, se débat dans la langue qui la force à chercher et simultanément lui refuse la sécurité et le coffre-fort personnel mythique, enjeu des extracteurs d’ « Inception », qui tous deux renvoient au « Safe » du titre.
Hugues Jallon, dans son puissant « Zone de combat » (2007) avait mis en scène avec un bonheur malicieux et insidieux l’émission feutrée de la Peur, la multitude de canaux et d’objets qu’elle utilise, du point de vue de ses dispensateurs éclairés. Paul Virilio en avait proposé, avec son « L’administration de la peur » (2010), une robuste incision philosophique. Serge Quadruppani n’hésitait pas, sans aucun complotisme de bas étage, à détailler la structuration politique qui en est faite, dans son « La politique de la peur » (2011).
Lucie Taïeb est à ma connaissance la première à se pencher vraiment, avec une redoutable lucidité poétique, sur la réception intime de cette peur diffusée à grande échelle, sur ses effets au plus profond – jusque dans nos rêves -, sur les séquelles potentielles que l’on est en droit d’imaginer, et sur les ébauches de lutte qu’il s’agirait de parvenir à imaginer en secret.
Au commencement, elle avait choisi de traduire pour cesser d’avoir peur. Ces mots ne seraient pas les siens, ces images ne seraient pas de celles qui la hantaient. Cette stratégie n’avait pas eu l’effet escompté : stériliser son imagination, cautériser l’angoisse, à la source. Même après des journées de travail abrutissant, passées devant l’ordinateur, d’une langue à l’autre, et en retour, les images persistaient, résistantes à toute fatigue, porteuses d’une infinité de possibilités. Le monde possible, non le monde réel. Non pas son monde.
Tueur en série retors, violeur opportuniste de parking ou de chemin déserté, intrus brisant les chaînes de sécurité à la porte de l’appartement, mais aussi attentat terroriste commis au hasard de la maximisation de l’impact médiatique, pandémie toujours prête à jaillir des virus congolais de la selve profonde ou des élevages chinois de volailles à l’hygiène réputée douteuse, jusqu’à l’inévitable – même si toujours repoussé jusqu’ici – crash de l’avion tombant tout à coup vers l’océan, lost in translation en un sens plus littéral que jamais. La peur, omniprésente, s’infiltre partout. Épidémie elle-même, son pouvoir de contamination est presque sans limite : ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés.
Dans ce tissu délétère de rêve et de réalité autour de la peur brute ou raffinée, qui n’a rien, comme chez le Norman Spinrad du « Temps du rêve » (2012), d’un fatal accident industriel du divertissement calibré (quoique l’omniprésence de certaines de ces figures de la peur – films-catastrophes et tueurs en série notamment – dans le loisir de masse puisse logiquement rendre songeur), mais bien plutôt comme la conséquence presque inexorable, d’une anomie généralisée dont il est obligatoire de nier le caractère profondément politique, jusque dans l’intime, Lucie Taïeb a su repérer deux fissures supplémentaires, souvent ignorées, qui donnent à son instrument poétique un tranchant encore plus acéré : la part silencieuse et la part féminine.
Ce sont les « Sept corbeaux » des frères Grimm, dont l’auteur hante son texte, qui rendent en effet le mieux compte de deux réalités particulièrement contemporaines. La peur, d’abord, se vit aujourd’hui, massivement, et en dehors de rares célébrations cathartiques au lendemain de catastrophes particulièrement spectaculaires, crashs ou attentats, en solitaire. L’individualisation de la jouissance, du mérite et du destin passe aussi par l’individualisation de l’inquiétude et de la souffrance anticipée. La vraie peur doit se taire socialement, et se confier aux bons soins des appareils sécuritaires, qui n’en traitent bien entendu qu’une infinitésimale partie, quand ils ne contribuent pas à la développer par ailleurs. La peur, ensuite, s’attaque particulièrement aux femmes, non pas pour des raisons intrinsèques ou « identitaires », bien entendu, mais parce que la société actuelle, répugnant bien plus qu’elle ne l’avoue à se moderniser en ce domaine, continue à vulnérabiliser de son mieux la femme dans son intimité, pour mieux désamorcer par avance sa force sociale et politique. Les répugnantes et néanmoins continuelles insinuations (quand elles ne deviennent pas de véritables combats socio-judiciaires) autour du harcèlement et – surtout – du viol en témoignent hélas cruellement à longueur de journaux, télévisés ou imprimés.
La jeune fille interdite de parole, la bouche scellée de la jeune fille : « Elle a cueilli les lys et par sa faute ses frères sont transformés en corbeaux. Mais si elle reste sept ans sans parler ni sourire, le sort sera rompu. Elle peut accepter ou refuser. Si elle accepte et dit un seul mot avant la fin des sept années, au moment précis où ce mot franchira ses lèvres, ses sept frères, set corbeaux, mourront. » Elle se tait et personne ne meurt, ses frères retrouvent forme humaine elle a accepté, sept années durant, toutes les calomnies, tous les mensonges sans se défendre elle s’est abstraite elle s’est oubliée elle a endormi toute sa violence, son exaspération, l’insouciance coquette de celle qui cueille des lys, elle a appris l’humilité, les héroïnes des contes apprennent toujours l’humilité l’humiliation le silence de soi le sommeil.
Seulement, un jour, cela prend fin.
Ne se contentant pas d’un désenchantement amer, même feutré au tentant pastel du renoncement, Lucie Taïeb fait davantage qu’esquisser, dans les interstices de ces rêves, des chemins et des possibilités concrètes – très concrètes malgré, ou peut-être à cause de, leur déguisement onirique revendiqué. Il y a matière ici à constituer d’imprenables forteresses mémorielles individuelles – en refusant les diktats en fin de l’histoire ou en anhistoricité toujours prompts à bondir sur leurs proies -, prêtes dès lors à prendre ou reprendre une lutte collective – ailleurs toujours à discréditer, précisément -, lutte collective dans laquelle l’amitié et l’amour, très loin des solipsismes saint-valentiniens de la consommation à outrance, ont tout leur rôle à jouer, dans la reconquête à inventer d’urgence d’un rêve général, comme le diraient aussi avec force et malice une Nathalie Peyrebonne ou une Sigolène Vinson.
Nous sommes peu nombreux, nos regards sont brillants. C’est la première des réunions nocturnes qui causeront notre perte, réunions secrètes dont il ne sera plus jamais question, ni ici, ni ailleurs, où tente de s’organiser, non par l’offensive mais par l’inertie, une forme de résistance à ce qui approche et ne manquera pas de nous engloutir. Elle est mon amie et c’est elle qui ce soir prend la parole, une lune très ronde entre, claire, par le soupirail, j’entends la voix de mon amie : des jours plus durs sont à venir. Il ne s’agira pas d’une lutte ouverte, mais souterraine, d’une contagion espérée. Nos souvenirs seront nos armes. revoyez à présent toute chose saillante, toute chose tranchante, qui inexplicablement aura marqué votre mémoire, parce que plus intense, ou parce qu’elle recelait une part de vérité qui ne vous a pas encore été révélée. Fermez les yeux, plongez au plus profond. Le jour viendra où nous serons dépourvus, séparés, désolés, où nous n’aurons plus rien que cette manne, ce qui nous constitue, où nous puisons ce soir la force de nous réunir, où nous trouverons, alors, celle de ne pas sombrer.
Surprenant, bouleversant sans aucun recours à un pathos trafiqué, courageusement poétique et politique au plus noble sens des termes, « Safe » est un grand roman, méticuleusement déroutant, et d’une lucidité indispensable.
Ce qu’en dit avec une grande intelligence Jean-Philippe Cazier dans Diacritik est ici. Ce qu’en dit superbement aussi Éric Darsan sur son blog est ici.
Safe de Lucie Taïeb aux éditions de l'Ogre
Coup de cœur Charybde2
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.