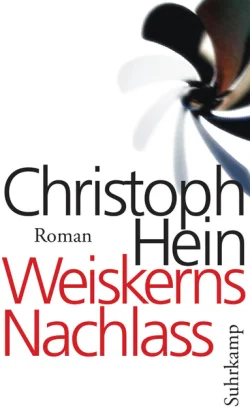Professeur d'université et précaire de lassitude… par Christoph Hein
La débâcle d’un intellectuel précaire, naïf et obsolète, au royaume de l’argent.
Enseignant à l’université de Leipzig, Rüdiger Stolzenburg s’approche de la soixantaine. Cet intellectuel précaire n’a obtenu à ce stade de sa carrière qu’un demi-poste de professeur dans un département aujourd’hui fragilisé par l’orientation de l’université vers un enseignement uniquement «rentable». Menacé de perdre son demi-poste du fait de son âge et du fait que la culture n’intéresse plus personne, il a renoncé à l’ambition de passionner ses élèves, rattrapé à son tour par la lassitude et l’ennui.
«Dans son vocabulaire un nouveau concept était apparu, un terme qui lui aurait fait horreur quelques années auparavant, un terme qui avait été jusque-là incompatible avec sa culture, son éducation, sa conception de l’université et de l’enseignement, sa conception de l’homme et de la vie. J’en apprends tous les jours, se disait-il, lorsqu’il employa pour la première fois le terme de «tirer», lorsqu’il dit à une collègue qu’il avait encore un semestre à tirer. Ce jour-là il avait sursauté, mais comme sa collègue n’avait pas réagi face à cette étrange expression, et comme le choix de ce mot ne la dérangeait apparemment pas, il se moqua de lui-même. En réalité il y a longtemps qu’il en était arrivé à «tirer» ses heures de cours et de séminaire, bien avant d’avoir prononcé ce mot pour la première fois. Il avait vieilli, était devenu cynique, ou, selon l’expression qu’il préférait, il savait s’adapter.»
Friedrich Wilhelm Weiskern, l’auteur dramatique et librettiste oublié du XVIIIème siècle qui passionne Stolzenburg, et dont il rêve de publier une édition complète des œuvres et de la correspondance, n’intéresse personne, aucun éditeur et sans doute guère plus qu’une poignée de lecteurs. Obligé de multiplier les à-côtés – articles et conférences – pour s’en sortir, Stolzenburg est acculé au bord de la perdition, lorsque le fisc allemand lui réclame des arriérés d’impôts alors qu’il n’a pas le moindre sou d’économies.
Le conseiller juridique et fiscal qui l’aide à s’en sortir, et l’invitation intéressée à une soirée de l’un de ses étudiants totalement hermétique au savoir, mais issu d’une famille excessivement riche, lui font côtoyer brièvement un monde dominé par l’argent et la corruption. Désarçonné par cette société où la culture n’en finit plus de se désagréger et par sa situation financière en bordure du gouffre, Stolzenburg est naïvement prêt à se raccrocher à tout espoir salvateur qu’il croît apercevoir lorsqu’il reçoit d’un inconnu la proposition d’acquérir des lettres manuscrites de Friedrich Wilhelm Weiskern.
«Il faut que tu le saches, la seule chose gratuite dans la vie, c’est le fromage dans le piège à souris.»
La débâcle intellectuelle ne s’accompagne pas encore du naufrage du physique. À cinquante-neuf ans Rüdiger Stolzenburg n’a ni embonpoint ni rides et il continue de collectionner les rencontres amoureuses. Pourtant cet homme qui n’a jamais voulu rester plus de quelques mois avec une femme pour éviter la promiscuité prolongée et l’inévitable érosion du désir qui l’accompagne est lui-même entièrement frappé d’une forme d’obsolescence et de disgrâce y compris dans ses rapports avec les femmes.
Écrivain phare de l’ancienne RDA né en 1944, Christoph Hein a mis en garde dès 1989 contre l’euphorie qui suivit la chute du mur de Berlin et contre les dangers de la furia néo-libérale sans opposition et désormais sans frein, notamment dans son précédent roman paru en 2000, «Willenbrock».
Publié en 2011, et traduit en 2016 par Nicole Bary pour les éditions Métailié, «Le noyau blanc» forme le portrait caustique d’un homme vieillissant et inadapté dans un monde où l’argent, la corruption et la violence règlementent les rapports sociaux et qui pour beaucoup prend l’aspect d’une jungle. Le sel et le charme amer du récit de cette débâcle d’un homme attaqué de toutes parts viennent de la distance toujours maintenue envers le réel, une clef pour continuer de vivre dans l’époque désenchantée du capitalisme triomphant si bien racontée par Svetlana Alexievitch dans «La fin de l’homme rouge».
Christoph Hein