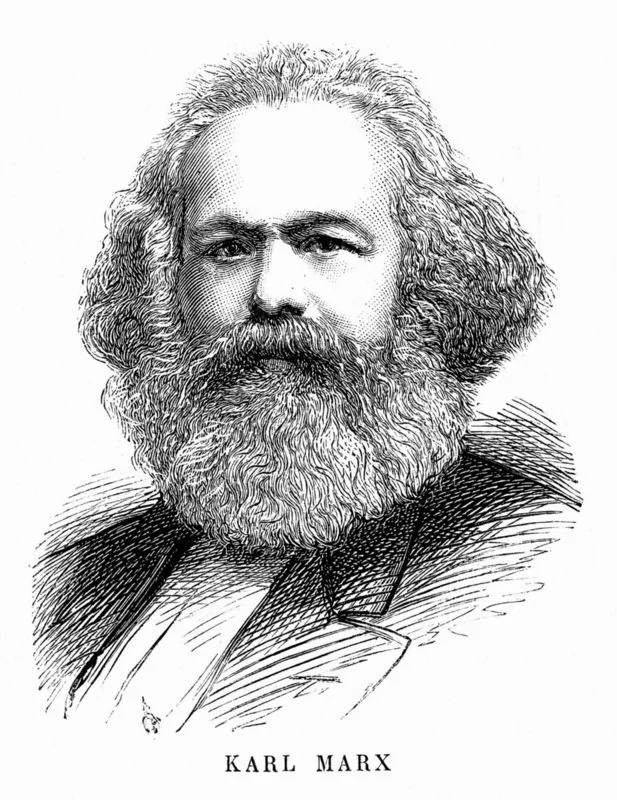Karl Marx n'était pas "réaliste socialiste". La preuve, son roman : "Scorpion et Félix".
« JE SUIS MARXISTE, TENDANCE GROUCHO »
Anonyme (sur un mur de l’université de Nanterre, mai 1968)
« Pour qui a connu Marx, aucune légende n’est plus ridicule que celle qui le représente comme un homme hargneux, sombre, inflexible et inabordable, une sorte de Jupiter tonnant retranché dans l’Olympe d’une solitude impénétrable, constamment occupé à lancer ses foudres et sans jamais le moindre sourire sur les lèvres. Une description pareille du plus gai et joyeux des hommes, de l’homme à l’humour pétillant et au rire contagieux, du plus gentil, tendre et sympathique des camarades de jeu constitue une source permanente de stupéfaction et d’amusement pour quiconque l’ait connu. »
Eleanor Marx-Avelling (1895)
« Il manifestait une prédilection particulière pour les romans humoristiques et d’aventure. »
Paul Lafargue (1890)
La barbe broussailleuse et les sourcils touffus à coup sûr n’aident pas. Ni soixante-dix ans d’art officiel soviétique. Dès qu’on le nomme, le couple Marx/littérature évoque immédiatement une atmosphère lourde, celle d’une pièce mal aérée, qui sent le moisi, tandis qu’une grisaille s’étale uniformément sur les livres, les peintres, les objets d’art et les mouvements esthétiques. Bien avant tel ou tel chef d’œuvre de l’art occidental, nous pensons, dans le meilleur des cas, à la pédagogie de bonne volonté du Musée Puskin, avec ses riches moulages en plâtre. Car, en dépit de tous les efforts que l’on puisse faire, au début du XXIe siècle il est difficile de ne pas associer le marxisme à une idée de littérature asphyxique et pénitentielle : et ceci même pour ceux qui n’ont cessé de sympathiser avec les idées politiques et la théorie économique de l’auteur du Capital.
Cela résulte en partie du fait que nous avons tous l’impression de savoir déjà tout ce qu’il y a à savoir à ce propos : la structure qui impose son empreinte sur la superstructure, le poids de l’idéologie (d’autant plus fort qu’elle est moins ressentie), l’avertissement que l’être détermine la conscience … Les maîtres du soupçon (Marx, Freud, Nietzche, selon une célèbre définition de Paul Ricœur) ont été également d’inflexibles monistes qui nous ont invités à ramener la phénoménologie multiple des formes à un seul et unique principe – ceci étant, suivant les différents cas, la vie économique, le désir sexuel, la volonté de puissance. Le XXe siècle a été leur siècle. Mais c’est précisément au contact de manifestations artistiques que cette approche se montre inadéquate, car elle gomme précisément ce qui compte le plus ici : les différences, infimes et pourtant décisives, qui existent entre les innombrables singularités dont la littérature est faite. C’est la raison pour laquelle de grands critiques marxistes ou freudiens, ou qui se sont définis en tant que tels (à partir de Sebastiano Timpanaro et Giacomo Debenedetti, pour ne citer que des auteurs italiens), n’ont pas fait défaut, mais le rapport entre leur talent critique et leur affiliation à une école a été un élément tout au plus accessoire. Beaucoup plus qu’à travers tel ou tel autre précepte (donc beaucoup plus qu’à travers l’élaboration d’une méthode rigoureuse), les maîtres du soupçon ont marqué d’une manière indélébile la réflexion sur les arts du XXe siècle, car leurs œuvres ont alimenté ce climat de méfiance envers leurs propres jugements qui est le fondement de toute grande activité critique. Lorsque pour Marx aussi arrivera le moment des bilans, il sera difficile ne pas reconnaître que le rôle joué par le matérialisme historique dans la compréhension des phénomènes esthétiques a été loin d’être négligeable : ne serait-ce que dans la promotion d’un climat favorable aux interrogations décisives.
Plus on s’éloigne du XXe siècle, plus on s’en rend compte, tant il devient évident que la sensation de fermeture et « l’odeur de moisi » dépendent beaucoup plus de tous ceux qui ont voulu transformer les intuitions souvent aphoristiques de Marx en un système autosuffisant chargé de règles, de dogmes et de prescriptions. En effet, dès que nous consultons les ouvrages de Marx afin d’y rechercher ses opinions sur la littérature (le libérant des incrustations infinies des exégètes qui se sont mesurés avec ses pages les plus connues), voilà que la fenêtre s’ouvre et que l’air se renouvelle. Ce sont surtout les témoignages de ceux qui ont bien connu Marx et qui dans leurs écrits nous ont laissé un portrait non conventionnel de la passion sincère qu’il nourrissait pour la littérature, comme sa fille Eleanor, son gendre Paul Lafargue ou Wilhelm Liebcknecht, qui nous donnent cette impression d’un rapport spontané avec les œuvres. On ne saurait trouver un meilleur accès aux goûts de Marx que celui fourni par leurs récits, dans lesquels le polyglotte passionné de poésie a le dessus sur le froid punisseur de l’économie politique bourgeoise. Il s’agit souvent de détails que nous ne pourrions connaître autrement. En lisant leurs pages nous découvrons par exemple que Marx (qui écrivait correctement en allemand, français et anglais et lisait sans difficulté l’italien, l’espagnol et le russe) était un puriste sévère du point de vue linguistique, qu’il ne tolérait aucun solécisme et aucune cacophonie. Les anecdotes privées se mélangent souvent avec des informations précieuses sur sa formation et ses habitudes de lecture. On découvre, par exemple, que le jeune Marx était surnommé « Roland furieux » à cause de son caractère impétueux ; que pendant les années de la maturité, il dédiait chaque jour un peu de temps à la lecture de ses auteurs préférés, en langue originale (Goethe, Lessing, Shakespeare, Dante, Cervantès) ; ou encore qu’il connaissait par cœur presque toute la Divine Comédie ainsi qu’un nombre impressionnant de vers de son ami Heine ou de Goethe, qu’il citait souvent avec une grande spontanéité au beau milieu d’une conversation (son poème allemand préféré était le Faust, mais parmi les Allemands de la dernière génération il estimait beaucoup aussi Adelbert von Chamisso et Friedrich Ruckert). Il n’allait pas souvent au théâtre, mais il organisait souvent à la maison des représentations« amateur » avec ses amis, quand cela lui plaisait de jouer Shakespeare en public (même s’il n’est jamais parvenu à se débarrasser de son accent allemand et, au dire des présents, qu’il insistait pour charger excessivement les scènes) ; tous les ans, il relisait Eschyle en grec et connaissait bien la dramaturgie espagnole du XVIe siècle, en particulier Calderon de la Barca, Lope de Vega et Tirso de Molina. Quand il dut déménager en Angleterre, il avait perfectionné son anglais en notant diligemment sur un carnet toutes les expressions les plus caractéristiques de Shakespeare (il avait réservé le même traitement au polémiste William Cobbet) ; mais parmi les interprètes d’Hamlet, il avait une admiration particulière pour l’italien Tommaso Salvini. Père dévoué, il se délectait à lire Homère à ses enfants, la saga des Nibelungen, le Don Quichotte, Les mille et une nuits, Shakespeare, la Bible, Fenimore Cooper et les poésies de Robert Burns ; en plus de Cervantès, parmi les romanciers il avait une prédilection pour Walter Scott (en particulier Old Morality), Balzac et Fielding, sans dédaigner pour autant Paul de Kock, Charles Lever et Alexandre Dumas père. Malgré un penchant pour le roman du XVIIe siècle (d’où son amour pour Fielding), il mettait Balzac au dessus de tous les auteurs apparus après le Don Quichotte et avait l’habitude de répéter que, dès qu’il aurait terminé son ouvrage économique, il écrirait une critique de la Comédie humaine, dans laquelle il voyait apparaître déjà des types humains qui auraient atteint leur forme la plus accomplie sous la période de Napoléon III. Parmi les ouvrages de Balzac, Le chef d’œuvre inconnu l’obsédait en particulier, car il craignait de se reconnaître dans la figure du peintre génial qui, à force de retoucher sans cesse une peinture à la recherche de la perfection, en venait uniquement à créer un amas indifférencié de couleurs. Parmi les romanciers anglais, il aimait beaucoup Charlotte et Emily Brontë (moins George Eliot), alors que parmi les Russes ses préférés étaient Puskin, Gogol, Saltykov-Scedrin et Turgenev (il considérait ce dernier comme l’interprète le plus authentique de l’âme russe).
On peut trouver d’autres opinions, bien entendu, dans les textes écrits en collaboration avec Friedrich Engels, depuis la critique implacable contre Eugene Sue et ses Mystères de Paris faite dans la Sainte Famille (1845), jusqu’à l’analyse du drame de Ferdinand Lasalle sur Franz von Sikingen, – ce dernier était critiqué pour avoir appliqué le modèle schillérien de la confrontation entre personnages, alors qu’il aurait mieux fait de présenter la contradiction tragique comme étant le résultat direct des rapports de force et des conditions économiques de l’Allemagne du XVIe siècle. Peu de choses, au fond : de même, dans le mare magnum de l’œuvre de Marx, peu significatifs sont les écrits de jeunesse sur Shakespeare et Chateaubriand, ou la réflexion sur la littérature universelle et l’héritage des Anciens de l’Introduction à la critique de l’économie politique, où l’on attribue le statut de classique hors temps aux Grecs sur la base du fait que leur art appartiendrait à l’« enfance de l’humanité dans le moment le plus beau de son développement » et que sa condition originelle suscite une fascination qui ne périt pas avec le temps. Une explication insatisfaisante et hâtive, qui ne nous semble rien de plus qu’un raccourci (dont les tons sont très proches de Vico) pour résoudre la contradiction entre historicisme et classicisme et passer à autre chose, même si c’est bien autour de cette question que tourne toute la réflexion philosophique de Gyorgy Lukacs (ce qui prouve que parfois en philosophie les doutes peuvent être plus importants que les réponses).
La vérité – banalement – est que Marx n’a jamais pensé fonder une méthode d’analyse littéraire et que, en réalité, une grande partie des jugements qui lui sont attribués, plus ou moins à juste titre, n’ont jamais été formulés par lui-même. Le réalisme comme forme centrale de la modernité, l’opposition entre Balzac progressiste (le narrateur) et Balzac réactionnaire (l’homme) ou la critique de la superficialité du naturalisme de Zola appartiennent uniquement à Engels. Nous trouvons ces trois aspects dans quelques lettres privées écrites entre 1885 et 1888, quand, après la mort de Marx, le vieux révolutionnaire acceptait de se prononcer sur les sujets les plus différents, sans exclure a priori les questions esthétiques. Cette mise au point est aussi importante parce que les intellectuels socialistes et communistes du XXe siècle auraient fait un peu comme les correspondants épistolaires d’Engels désireux d’élargir les découvertes de Marx et de son compagnon de travail aux secteurs disciplinaires auxquels les deux s’étaient intéressés uniquement de manière marginale, même au prix de construire un système théorique à partir de quelques éléments occasionnels. En ce qui concerne ses succès tout autant que ses misères, l’histoire de l’esthétique marxiste du XXe siècle est aussi l’histoire de cette tentative quelque peu désespérée de fonder une interprétation matérialiste de l’art sur les ouvrages des pères du mouvement ouvrier.
Naturellement, que le philosophe de Trèves n’ait jamais développé sa propre théorie esthétique n’implique pas que l’enquête de ses rapports avec la littérature ne soit pas du plus grand intérêt. Il suffit d’avoir lu quelques-uns de ses ouvrages principaux pour voir comment les chefs d’œuvre de la tradition occidentale nourrissent son écriture. Autrement dit, si on peut apprécier un ouvrage littéraire sans recourir à Marx, nous serions difficilement à même de comprendre ses écrits sans avoir accordé un minimum d’attention à la manière dont les auteurs les plus aimés le secourent dans les moments les plus difficiles et l’aident à donner forme à sa pensée. Dans un essai quelque peu oublié, Siegbert S. Prawer a montré par exemple que Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (le livre qui s’ouvre en disant que les événements historiques se répètent deux fois, la première fois comme tragédie, la deuxième comme farce) est littéralement pétri d’images théâtrales : « effets dramatiques », « deuxième plan », « avant-scène », « masque », « scénario », « ouverture », « fermeture », « fantasmes » qui apparaissent « dans les derniers actes » d’un opéra, « chœur », « soliste », « comédie d’intrigue », « comédie de cour », « déclamation »… La liste pourrait continuer sans peine : Odilon Barrot qui, afin de ne pas perdre son fauteuil au ministère, arrive à concevoir « des stratagèmes dignes de Beaumarchais » ; l’Assemblée Nationale qui nourrit à l’égard des assemblées provinciales « les mêmes espoirs que les nonnes à l’égard des Pendours dans la Henriade de Voltaire » ; la transformation des « hommes et des événements » en un « Schlemil à l’envers », c’est-à dire en « ombres auxquelles on a enlevé le corps » (au contraire de ce qui se passe dans le roman préféré de Pirandello écrit par Chamisso) ; l’empereur démocratique sous forme de joueur de fifre qui a besoin de « popularité parmi ses sujets » et qui est disposé pour cette raison à les lier à lui-même « avec le désordre bohémien qui fleurit sous ses auspices » (ce dernier exemple est tiré du premier livre du Capital) …
Puisqu’il s’agit justement d’une attitude commune (et puisque les indices des noms des éditions italiennes permettent également à quiconque de trouver d’autres exemples), il est inutile d’allonger trop la liste. Il peut être plus intéressant par contre de comprendre les raisons pour lesquelles Marx a cherché toute sa vie à communiquer ses propres idées en utilisant des images provenant de la littérature comme peu d’autres penseurs politiques de son temps (on ne trouve rien de similaire dans les écrits d’un Alexis de Tocqueville ou d’un John Stuart Mill). Parmi ces raisons, on en reconnaît, d’emblée, au moins trois qui ont sans aucun doute influencé son choix d’adopter ce style argumentatif, et qui n’ont rien à voir avec le désir de faire une impression sur ses lecteurs en montrant une formation humaniste de premier ordre, y compris pour les standards très élevés de l’université allemande de l’époque. Il convient de les présenter suivant leur ordre croissant d’importance.
Les citations littéraires sont avant tout fonctionnelles à la satyre (et nous savons combien Marx aimait ce moyen de contestation face à ses propres adversaires) : elles sont, autrement dit, l’un des instruments mis au service de la polémique, afin de rendre les « armes de la critique » plus affilées. Marx n’ignore pas que le renvoi à telle ou à telle autre figure exemplaire de la littérature confère une vivacité singulière à son discours, de la même manière qu’il n’hésite pas à recourir à des similitudes et des métaphores afin de se moquer des argumentations intéressées des économistes et des politiciens libéraux. Dans le Capital, par exemple, les entrepreneurs sont décrits comme des « Shylock distingués », les bourgeois comme des « Sancho Pansa fidèles aux lieux communs », tandis qu’Edmund Potter est comparé au général hypocrite de Intrigue et amour de Schiller. Ailleurs, les comparaisons sont ouvertement ironiques, notamment quand, toujours dans le Capital, Marx nous parle du capitaliste comme d’un « pénitent moderne de Visnu », ou qu’il exalte Andrew Ure comme « le Pindare de l’usine automatique », Isaac Pinto comme « le Pindare de la bourse d’Amsterdam » et les entrepreneurs de Liverpool comme « les Pindare de la traite des esclaves ». Ailleurs encore, la poésie ne fournit au contraire qu’une phrase particulièrement icastique, comme quand le « nihil creari posse de nihilo » de Lucrèce est évoqué pour décrire la conversion de la force de travail en travail, ou quand la psychologie des propriétaires de marchandises est décrite à travers la phrase de Faust (« Au commencement était l’action ») ; dans ce cas-là – significativement – l’ambigu Shylock est mis en cause deux fois dans l’espace d’une dizaine de pages, une première fois pour donner voix au capital, puis afin de mettre son éloquence au service d’un travailleur exproprié des plus élémentaires moyens de survie (comme s’il n’était possible d’assigner au protagoniste du Merchant of Venice que le rôle de victime ou de bourreau). Ce sont les seuls cas dans lesquels nous pouvons avoir parfois l’impression que la citation a une fonction purement ornementale, et qu’elle n’ajoute rien au raisonnement, mise à part un surplus de participation émotive (par exemple, quand Marx décrit les conditions de travail inhumaines dans les usines d’allumettes à travers un renvoi trop prévisible à l’Enfer de Dante). La rhétorique littéraire, d’ailleurs, sert aussi à cela.
En second lieu, il faut reconnaître dans ce goût pour la littérature un legs clair de l’hégélianisme de Marx. Hegel avait vu dans le grand art la capacité d’offrir une représentation sensible de l’Idée et il n’avait pas hésité à se servir des personnages les plus célèbres de la tragédie ou du roman pour mettre en scène les points essentiels de l’histoire humaine (Antigone et Créon comme images du conflit originaire entre la famille et l’État ; Sancho Pansa et Don Quichotte comme illustration de la dialectique esclave-maître…). Dans son sillage, Marx se sert aussi de certains héros de la littérature afin de représenter par leurs péripéties les grands conflits de l’Histoire. Voici par exemple toujours Don Quichotte, qui dans le Capital ne renvoie plus à l’opposition esclave-maître, mais bien à l’impossibilité de pratiquer un style de vie particulier quand les conditions socio-économiques qui le soutenaient se sont désormais effondrées (« Déjà Don Quichotte a eu à se repentir pour avoir cru que la chevalerie errante était compatible avec toutes les formes économiques de la société1 ») ; voici Prométhée en tant que symbole de l’ouvrier rivé au rocher« d’une manière plus solide que les coins de Vulcain2 » ; voici enfin Robinson Crusoé, dont les aventures admirables sur une île déserte constituent selon Marx le paradigme même de la théorie économique bourgeoise dans la plus articulée et célèbre lecture allégorique du Capital. Au cours des années 1990, un livre comme Myths of Modern Individualism de Ian Watt sera redevable à une telle approche.
Le troisième usage des citations littéraires est toutefois celui qui m’apparaît comme le plus important dans la perspective de Marx. Si le premier livre du Capital (mais pas uniquement) abonde de références aux auteurs les plus différents c’est aussi parce que Marx continue de mener sa bataille contre Hegel, au nom du renversement de l’hégélianisme auquel il avait consacré ses énergies à partir des années 1840. Exploiter les chefs d’œuvre de la littérature occidentale en tant que sources pour une enquête de nature souvent trop technique signifie également montrer comment la donnée économique, malgré son invisibilité, peut se cacher dans les recoins les plus inattendus. Même les textes le plus élevés de la tradition européenne parlent de travail, d’exploitation et d’enrichissement car le pouvoir d’influence de la structure ne lâche jamais prise et laisse son empreinte là où on s’y attendrait le moins. C’est ce qui arrive quand Marx cite (en grec!) Homère et Archiloque en relation avec la valeur d’usage et la valeur d’échange (ou, mieux, en tant qu’épreuve du peu d’attention que les anciens prêtaient à la deuxième), ou le vieux usurier Gobsek (du roman homonyme de Balzac) à propos de l’inutilité de thésauriser de la marchandise en dehors du circuit d’échange. Dans tous ces cas, la description du mécanisme de la circulation des marchandises fonctionnerait tout aussi bien sans le renvoi au dialogue entre Saint Pietro et Dante dans le Paradis, de la même manière que la notion de valeur est suffisamment claire pour ne pas citer le Timon d’Athènes de Shakespeare, le Pluton d’Aristophane ou l’Antigone de Sophocle : pourtant Marx a saisi que, pour le philosophe, affirmer l’importance de ces ouvrages signifie avant tout promouvoir une conception matérialiste de l’homme en tant qu’être enraciné dans un réseau de rapports de force économiques. Contre la tendance partagée par un grand nombre de lecteurs à négliger ces aspects au profit d’une conception du classique soustrait à l’effet du temps, il n’y a aucun grand ouvrage de la tradition occidentale dans lequel il ne soit pas possible de trouver les traces des dynamiques de la violence et des lois de l’exploitation de l’homme sur l’homme : et Marx n’hésite pas à nous le rappeler.
Pour parler du rapport de Marx avec la littérature, en dehors des témoignages des amis et des affirmations directes, nous disposons d’un troisième élément – en général moins considéré par les spécialistes, mais sans doute aussi important que les autres. Le jeune Marx avait cultivé le rêve de devenir un écrivain, et nous avons conservé de sa période universitaire une dizaine de poésies lyriques, dont la plupart étaient adressées à sa fiancée de l’époque (et future femme) Jenny von Westphalen, ainsi qu’un fragment dramatique resté inachevé, Oulanem. Au cours des années suivantes Marx abandonna complètement l’écriture créative, mais il ne perdit jamais le goût pour la technique poétique. Eleanor Marx raconte par exemple que, au cours de sa période parisienne quand il avait arrêté d’écrire des vers, Heine (qui appartenait à la génération précédente et qui était déjà, à cette époque-là, un poète affirmé) aimait corriger toutes ses compositions avec son père, qui avait la réputation d’être un juge exigeant et, en raison de cela, était d’autant plus précieux dans le difficile processus de réécriture :
Heine et Marx étaient capables de relire à l’infini une courte poésie de huit lignes, en discutant d’une manière acharnée sur un mot ou un autre, en travaillant et en limant jusqu’à ce que tout ne soit parfaitement poli et jusqu’à ce que le poème ne porte plus aucune trace du travail de finition3.
Tout en étant liée au témoignage partial d’Eleanor, la haute opinion dans laquelle Heine tenait Marx (ne serait ce qu’en tant que lecteur connaissant parfaitement les mystères de l’écriture poétique) ne doit pas être prise à la légère quand on lit les poésies pour Jenny. Les enjeux en sont beaucoup plus importants qu’on ne l’aurait cru. Même en faisant abstraction de la valeur (sans aucun doute pas exceptionnelle) de ces compositions, à la lumière du poids décisif que les jugements esthétiques de Marx ont eu dans la théorie et la pratique littéraires du XXe siècle, elles méritent la plus grande attention, car elles nous font entrer dans son laboratoire littéraire et nous offrent une perspective inédite sur ses goûts. Si l’on est tenté de se débarrasser rapidement des juvenilia de Marx en les considérant comme un exercice de jeunesse sans suite, il est important de rester prudents surtout en ce qui concerne le texte le plus significatif de cette période d’expérimentations littéraires : un morceau de roman écrit dans les premiers mois de 1837 dont le titre est quelque peu mystérieux au premier abord, Scorpion et Félix (des noms des deux protagonistes), et qui est resté inédit jusqu’en 1929. À chaque fois qu’il a été publié, ce libellé singulier a jeté ses éditeurs dans l’embarras. Ces derniers ont essayé de se prémunir contre les acheteurs en soutenant que – malgré les apparences – les pages du volume contiennent l’ « édition intégrale » du texte de Marx. Pourquoi un tel choix ? Il suffit de feuilleter le roman pour s’apercevoir tout de suite quelle est la difficulté que l’on essaie de contourner par cette mise au point. Scorpion et Félix commence au chapitre X du premier et (à vrai dire) seul livre, par une allusion explicite à ce qui vient de se passer dans le chapitre précédent ; on passe ensuite au douzième chapitre et au sixième, au dix-neuvième au vingt-unième … quelque chose manque, pense d’emblée le lecteur : le texte a été coupé, ou du moins il est incomplet. Bien évidemment, puisque Marx n’a jamais publié son livre, rien n’empêche de croire qu’au moins une partie de ces « trous » auraient été remplis, mais, une fois la lecture terminée, on a plutôt l’impression que ces lacunes (ou du moins une partie d’entre elles) faisaient partie du plan de Scorpion et Félix depuis le début. Nous sommes aux prises, autrement dit, avec un texte délibérément extravagant : une histoire qui n’a pas de véritable commencement et qui ne mène à aucune conclusion, un livre exceptionnellement digressif, dans lequel chapitre après chapitre le narrateur multiplie les faux indices et cultive des attentes pour mieux les décevoir. Un roman conçu délibérément pour n’aboutir nulle part, pour se perdre dans une série virtuellement infinie de gloses, de corrections, d’exemplifications et de discussions qui surgissent à chaque page dans la mince intrigue, en freinant tout développement narratif par un discours sur les bienfaits présumés du principe du majorat depuis peu réintroduit par le gouvernement prussien, par une parodie de l’empirisme de Hume ou par un long excursus philologique sur les possibles étymologies (toutes absurdes) du nom de l’un des personnages, le tailleur Merten …
L’ironie de Marx cible avant tout le roman lui-même. Le livre semble avancer, de nouveaux personnages entrent en scène mais, bien que la narration progresse, le lecteur n’arrive pas à trouver un seul point d’appui fiable. Au contraire, plus les chapitres s’accumulent plus il devient difficile de suivre les interventions du narrateur, qui se réjouit de nous mettre sur le mauvais chemin à chaque fois que nous pensons avoir enfin saisi le nœud du problème et que nous entrevoyons au milieu des gloses et des postilles un début d’intrigue. Rien à faire : selon son goût et son état d’âme, soit le lecteur détestera Scorpion et Félix, soit il lui reconnaîtra le mérite d’avoir porté aux extrêmes conséquences sa critique des conventions (narratives ou non) et de lui avoir transmis un sentiment singulier d’irréalité. Dans tous les cas, quel que soit son verdict final concernant l’humour de Scorpion et Félix, il sera obligé de reconnaître qu’il a affaire à un Marx romancier qui se situe aux antipodes du modèle de littérature purement mimétique que nous sommes habitués à associer avec le réalisme socialiste.
D’où est venu à Marx l’idée d’un roman aussi peu conventionnel ? Par son extrémisme, Scorpion et Félix s’inscrit en réalité dans un courant du roman européen dont l’importance est loin d’être négligeable. Le jeune Marx est l’un des nombreux écrivains européens de sa génération à avoir subi l’influence de l’un des romans les plus importants du XVIIIe siècle : Tristam Shandy de Laurence Sterne, paru en neuf volumes entre 1759 et 1767 et rapidement traduit dans des langues d’importance majeure (en allemand entre 1763 et 1767 et à nouveau en 1774, en français entre 1776 et 1885, en néerlandais entre 1776 et 1779, en danois à partir de 1794, en russe entre 1804 et 1807, en hongrois à partir de 1824, en italien dès 1829…). Le roman de Sterne (qui selon certains s’inspirerait de la narration de l’Arioste dans Le Roland furieux, poussant à l’extrême cette tendance à interrompre le récit ou à renouer librement les fils de l’histoire après les avoir laissé tomber avec une apparente négligence) est écrit de la même manière que Scorpion et Félix et il y a peu de doutes que c’est à lui que Marx s’est adressé lors de la création de son court livre : l’ordre des chapitres renversé, les longs détours, la multiplication des cadres, les réécritures parodiques des stéréotypes du roman d’amour du XVIIe siècle (Fielding en tête), vis-à-vis duquel, en montrant le caractère conventionnel de chaque intrigue, Sterne était l’un des plus impitoyables réfractaires.
La fascination exercée par Tristam Shandy sur les lecteurs de toute l’Europe est encore plus profonde que ce que les données sur les traductions (intégrales ou partielles) laissent croire. On s’en aperçoit surtout en repérant les imitations qui en ont été faites. En France, à partir de 1765, Denis Diderot travailla pendant presque vingt ans à l’écriture d’un roman ouvertement inspiré du modèle sternien et destiné à devenir lui-même l’un des grands classiques du XVIIIe siècle, Jacques le fataliste et son maître (publié en allemand, d’abord, partiellement et de manière anonyme en 1792, huit ans après la mort de l’auteur, puis dans son intégralité en 1796). Ce fut surtout sur le côté droit du Rhin, toutefois, que le Tristam trouva un climat favorable à sa diffusion et à sa reproduction. A partir des années 1790, l’intrigue digressive de Sterne devient la spécificité des nombreux romans publiés avec beaucoup de succès par Jean Paul (pseudonyme de Johannes Paul Richter), au point que bientôt, dans les discussions des contemporains, leurs noms commencèrent à circuler conjointement. Tout le monde ou presque aimait le Tristam Shandy et nombreux étaient ceux qui appréciaient les variations sur le prototype proposées par Jean Paul ; qu’on les estimât tous les deux ou qu’on respectât le premier seulement, à partir de ce moment en Allemagne un discours sur l’un était impossible s’il n’impliquait pas immédiatement l’autre.
À cheval entre deux siècles, Sterne avait déjà arrêté d’être un auteur pour incarner une fonction, c’est-à-dire une idée de littérature. On doit une telle métamorphose surtout à l’un des pères du mouvement romantique, Whilelm Schlegel, qui éleva tout de suite Tristam Shandy au rang de modèle absolu, et en fit l’un de rares livres contemporains (avec ceux de Goethe, de Diderot et de Jean Paul) digne de figurer parmi les classiques. Pour Schlegel, le roman était destiné à devenir le genre romantique par excellence : de lui on attendait l’œuvre d’art de l’avenir, à condition que l’on évite les intrigues plates et sentimentales de Fielding et que l’on se serve de la liberté de la prose afin de démanteler le système des genres littéraires hérité du classicisme (épique – lyrique – dramatique). Le grand livre romantique n’existe toujours pas, mais Schlegel se déclarait certain de connaître la recette qui l’aurait produit : le caractère fragmentaire et métalittéraire, l’exhibition exagérée des mécanismes littéraires, l’humour transcendantal comme instrument pour atteindre à l’absolu, le Witz, la rencontre entre l’œuvre d’art et la recherche de l’œuvre d’art (entre le programme et sa réalisation)… Il semblerait que de telles opinions aient été écrites en pensant au Tristam Shandy et ce sont justement Sterne et son disciple allemand Jean Paul qui font l’objet d’une défense passionnée de l’accusation de n’être qu’un « fourre-tout bariolé de Witz maladif », qu’on trouve dans une Lettre sur le roman que Schlegel inclut dans son Entretien sur la poésie (1800).
Il convient d’en lire au moins quelques passages. Antoine, l’un des protagonistes, commence par évoquer l’accusation, formulée par son amie Amalia, contre Jean Paul et contre toute la tradition du Tristam Shandy :
vous avez dit que leur mince histoire est trop mal mise en scène pour compter comme telle, l’on est réduit à la deviner. Voudrait-on néanmoins en faire le simple récit, que l’on obtiendrait tout au plus des confessions : l’individualité de l’homme y est bien trop visible, et pour comble, quelle individualité !
Je passe le dernier point, car à son tour il n’est qu’affaire d’individualité. Je vous accorde le fourre-tout bariolé de Witz maladif, mais je le prends sous ma garde, et j’affirme hautement que de tels « grotesques » et de telles confessions sont encore les seuls produits romantiques de notre époque sans romantisme4.
Antoine reproche à Amanda d’avoir corrompu son goût en lisant « l’indigne bric-à-brac » des romanciers intéressés uniquement à raconter une histoire (il se réfère en particulier à Fielding). Cela n’a pas toujours été le cas pourtant :
En revanche, vous vous rappelez peut-être qu’il fut un temps quand vous aimiez Sterne, où vous vous délectiez à adopter sa manière, moitié à l’imiter, moitié à le railler. J’ai encore quelques plaisants petits billets de vous dans ce style et je les garderai soigneusement. […] Vous le sentez vous-même : la délectation que vous procurait l’humour de Sterne est pure, et d’une toute autre nature que la tension de curiosité qui peut nous astreindre à lire un livre foncièrement mauvais au moment même où moins le jugeons tel. Et voyez si cette délectation ne s’apparentait pas à celle que nous éprouvions souvent à contempler ces spirituelles décorations fantastiques appelées arabesques5.
Après un éloge (prévisible à ce point) de Jacques le fataliste, Schlegel conclut son raisonnement par une affirmation tranchante qui confie aux disciples de Sterne, moins la grandeur des classiques du XVIe et XVIIe siècles, que leur devoir d’éduquer les lecteurs modernes à les comprendre correctement : « Celui qui est à même de les aimer […] s’approche de la compréhension du divin Witz ou de la fantaisie d’Arioste, de Cervantès ou de Shakespeare6».
Aucun autre écrivain, sans doute, n’a été plus important que Sterne dans la codification du goût romantique, au moins en ce qui concerne les frères Schlegel et leur groupe d’amis actifs au sein de la revue « Athenaeum » entre 1798 et 1800 : il a été l’auteur au travers duquel établir une généalogie alternative, capable de se soustraire aux règles d’Aristote et d’Horace et, pour cette raison, à même de légitimer cet art de la modernité que les jeunes romantiques étaient justement en train de chercher, en remettant en question trois siècles de classicisme. Dans sa prédilection, toutefois, Schlegel n’était nullement isolé. En plus de Jean Paul, parmi les admirateurs allemands de Tristam Shandy, il faut évoquer une personne destinée à exercer la plus grande influence sur l’auteur du Capital et à nouer avec lui une amitié solide, bien que tourmentée : Heinrich Heine, rencontré en 1843 à Paris, où ils étaient tous deux exilés. Bien avant leur rencontre en France, le Heine que Marx admirait était l’auteur de livres tel que Idées. Le livre Le Grand (1827), qui reprenait ouvertement le modèle sternien, et le théoricien d’un humour absolu dans lequel devaient fusionner le sublime et le ridicule, selon les principes énoncés par Schlegel. Cela n’est pas surprenant que les deux hommes se soient entendus tout de suite, même en dehors de la politique.
Par son ton parodique (presque tous les personnages mis en scène sont parodiques, comme la cuisinière Grete, inspirée de la Gretschen du Faust, et Félix lui-même, qui reprend le nom du fils de Whilem Meister dans le roman homonyme de Goethe), Scorpion et Félix se situe dans ce climat d’adoration pour Sterne : entre Jean Paul, Heine et Schlegel. À cette période, en Allemagne, on retrouve Tristam Shandy un peu partout, au point qu’il n’était pas possible formuler un jugement littéraire sans prendre position, implicitement ou explicitement, en sa faveur ou en sa défaveur. Comme si cela ne suffisait pas, en 1835-36, pendant un semestre, le jeune Marx avait suivi à l’université les cours de littérature du frère de Friedrich Schlegel, August Wilhelm, un autre grand théoricien de l’art de son temps, connu surtout grâce à son Cours de littérature dramatique (1809). Cet élément rend le choix d’imiter Sterne même quelque peu prévisible.
Tout le monde, évidemment, ne partageait pas les mêmes opinions, y compris quand elles s’exprimaient plutôt unanimement en faveur de Tristam Shandy. Les familles les plus nombreuses sont parfois aussi les plus querelleuses. Pour cette raison, comme nous l’avons indiqué, il est possible que les sterniens allemands, bien que se reconnaissant dans le même « père », n’aiment pas de la même manière tous leurs frères littéraires. C’est ce qui s’est passé pour Marx vis-à-vis de Jean Paul. Contrairement à Schlegel, Marx n’aimait pas du tout l’auteur d’Hesperus et de Siebenkäs, qu’il qualifiera plus tard de « pharmacien de la littérature » dans un article connu contre Carlyle coécrit avec Engels. Nous pouvons nous demander si cette antipathie ne dépende aussi du fait que Marx reconnaissait peut-être chez Jean Paul certains de ses propres défauts. On pourrait citer à la lettre un jugement célèbre de Heine au ton doux amer à propos de la prose de Jean Paul, et le reprendre pour Scorpion et Félix car il va jusqu’à en fournir peut-être la description la plus parfaite :
Les phrases, chez Jean Paul, ressemblent à une série de chambrettes minuscules qui sont parfois à tel point étroites que quand une idée en rencontre une autre elles se cassent la tête réciproquement ; un nombre élevé de crochets pendent du plafond, auxquels Jean Paul accroche des pensées de toute sorte ; enfin dans les murs se trouvent beaucoup de tiroirs secrets où il cache des sentiments. Il n’y a pas d’écrivain allemand à ce point riche en pensées et en sentiments, et toutefois il ne leur permet jamais de mûrir (…), des pensées et des sentiments qui deviendraient des arbres gigantesques, si on leur laissait le temps de prendre racine et de déployer leurs branches, leurs feuilles et fleurs ; et au contraire il les arrache quand ils ne sont encore que de toutes petites plantes, souvent juste de jeunes pousses. De cette manière de bois de l’esprit entiers nous sont présentés comme s’il s’agissait d’un tas de légumes dans une assiette. Mais il s’agit d’un régime saugrenu, inimaginable, car non pas tous les estomacs supportent les jeunes chênes, les cèdres, les palmiers et les bananiers dans une quantité pareille.
De la même manière que chez Jean Paul, le problème de Scorpion et Félix semble être celui de la gestion adéquate de l’héritage de Sterne. Autrement dit, si Diderot et Heine avaient réussi à récréer dans leurs écrits cette forme très particulière de concordia discors, qui est le trait le plus admirable du Tristam Shandy (un désordre de surface qui cache un ordre d’un niveau plus élevé), cet équilibre paradoxal est la première chose qui se perd quand les écrivains ne sont plus capables de rétablir l’ordre dans la machine romanesque et qu’ils deviennent victimes du chaos qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer, tels des apprentis sorciers maladroits. C’est à coup sûr le cas de Scorpion et Félix, mais beaucoup pensaient que les livres de Jean Paul avaient exactement le même défaut.
Il est difficile aujourd’hui de se faire trop d’illusions sur la qualité littéraire de Scorpion et Félix. Marx lui-même se rendit compte assez tôt que son roman n’était pas à la hauteur du modèle choisi. Déjà peu de mois après la composition, il exprime ses doutes dans une lettre au père Heinrich datée du 10 novembre 1837 :
À la fin du semestre j’ai essayé à nouveau les danses des muses et la musique des satyres, et déjà dans ce dernier cahier que je vous ai envoyé, l’idéalisme transparaît de partout, à travers un humour forcé (Scorpion et Félix), à travers un drame fantastique raté (Oulanem), jusqu’à ce que, finalement, l’idéalisme se renverse complètement et se transforme en un art tout à fait formel, presque toujours sans objets réels d’inspiration, sans l’avancement passionné des idées.
Il s’agit d’un document important qui, à partir de 1929, c’est-à-dire à partir du moment où la publication de Scorpion et Félix mit dans l’embarras plus d’un des disciples de Marx, a été cité de nombreuses fois comme preuve d’une conversion rapide et définitive à une nouvelle poétique. Il n’est pas difficile de comprendre les raisons pour lesquelles un texte expérimental tel que Scorpion et Félix pouvait gêner les militants et les intellectuels socialistes et communistes qui s’inspiraient de la pensée de Marx. Au lieu du théoricien sévère de la lutte de classe, c’est un garçon impertinent qui émergeait de ces pages, hostile à l’hypocrisie de la province allemande et au code civil prussien (et jusqu’ici cela pouvait allait), mais incliné à railler avec le même plaisir l’œuvre du grand Goethe et l’érudition académique : une sorte de nihiliste, résolu à n’épargner avec son humour rien ni personne. Un Marx qui – disons-le clairement – parmi les communistes de ces années-là n’aurait pu plaire qu’à André Breton et aux surréalistes. Un repentir était donc nécessaire et la lettre au père semblait fournir la preuve que le « jeune » s’était « rangé », et qu’il avait abandonné le rôle du moqueur et du goliard pour celui de révolutionnaire conscient du sérieux de sa propre grande mission.
Une telle lecture, qui jusqu’à il y a quelques années a été confirmée par toutes les biographies marxiennes, ne tient désormais plus débout. La déception envers son propre travail n’entraîne pas un revirement envers ses propres modèles, et encore moins une abjure radicale d’une tradition humoristique à laquelle Marx aurait été attaché toute sa vie durant. Dans la lettre au père, en effet, il ne dit jamais que le projet originaire était incorrect, et il n’oppose pas non plus à la leçon sternienne suivie dans ces pages-là une nouvelle poétique, réaliste cette fois-ci (bien que ceci ait été souvent dit). Car le jeune Karl se limite uniquement à remarquer que sa tentative de suivre l’exemple de Sterne (mais aussi de Heine et de Diderot) a abouti encore une fois à un échec total, sans que l’on puisse tirer de ce résultat aucune conclusion sur la valeur de ces écrivains et de leur leçon. Une défaite douloureuse que l’on pourrait résumer par la formule : « je voulais refaire le Tristam Shandy, et j’ai finis au contraire par imiter Jean Paul ».
Un nombre important de témoignages nous confirment que la passion pour Sterne, Diderot et Heine ne s’était pas estompée au fil des années et que donc elle ne pouvait pas être liquidée comme s’il s’agissait d’un simple engouement juvénile. Les références à Sterne que nous trouvons à plusieurs reprises dans ses écrits ainsi que les témoignages de ceux qui lui furent proches nous démontrent que le Tristam Shandy a inspiré à Marx un amour durable : il s’agit souvent de véritables crypto citations, comme, dans un article de 1848 pour la Neue Rheinische Zeitung où la solennité du nouveau premier ministre est ridiculisée dans le style du Tristam Shandy, et où sa « mystérieuse conduite » est réduite à un stratagème « pour cacher les défauts de l’esprit ». Un « diagnostique » répété deux années plus tard à propos d’Odilon Barrot, le ministre libéral qui avait essayé de sauver la monarchie orléaniste à la veille de la révolution de 1848. Sterne ne disparaît pas non plus de la liste des auctoritates marxiennes au cours des années suivantes, tant il est vrai qu’on le retrouve de nouveau évoqué dans Herr Vogt, en 1860.
Le même discours est valable pour Jacques le fataliste. En 1852 Marx l’envoie par poste à Engels, accompagné du Neveu de Rameau, afin que l’ami, qui ne les connaissait pas encore, puisse les lire à loisir, tandis que nous avons les réponses à un questionnaire de ses filles, dans lequel Marx désigne Eschyle, Shakespeare et Goethe comme ses poètes préférés et Diderot pour seul prosateur. Nous pourrions dire quelque chose de similaire à propos de Heine, même si dans ce cas les témoignages de l’admiration inconditionnelle de Marx pour les ouvrages de son ami sont trop nombreux pour en faire une liste complète, et ceci malgré leur éloignement au fil des années et le mépris sincère que le retour de Heine à la religion des pères avait provoqué chez Marx et Engels. Mis à part cela, ainsi que l’a raconté Eleanor :
Marx était un grand admirateur de Heine. Il aimait le poète autant que ses ouvrages, et il jugeait avec le maximum d’indulgence ses faiblesses politiques. Les poètes, disait-il, sont des types bien étranges, il faut les laisser aller leur chemin, et il ne faut pas les juger avec les critères qu’on adopte pour juger les hommes communs, ni les hommes hors du commun7.
L’importance de Scorpion et Félix – on l’aura compris désormais – est entièrement liée aux modalités à travers lesquelles ce bout de roman nous rend une image de Marx différente de celle qui s’est imposée au cours du XXe siècle, au fur et à mesure que le matérialisme historique élaborait une théorie de l’art et de la littérature. Le jeune Karl n’était pas satisfait du résultat et il est difficile rétrospectivement de lui donner tort : l’humour est souvent forcé, l’intrigue est inexistante, les renvois à l’actualité sont désormais souvent incompréhensibles environ deux siècles plus tard. Nous avons l’impression de nous retrouver plutôt face à une prose goliardique similaire à celle que les étudiants composent souvent dans les universités pour se moquer des professeurs et de leurs camarades. Si Scorpion et Félix mérite en somme notre attention c’est uniquement parce que, malgré tous ses défauts, le roman de Marx se présente comme le plus cuisant démenti des préceptes et du système de règles qui a été bâti en son nom, au cours du XXe siècle.
Il faudra reconnaître tout d’abord que Scorpion et Félix est une production de jeunesse, avec tous les défauts qui lui sont intrinsèques, mais que sa faiblesse n’a rien à voir avec le choix en faveur de l’humour, de la poétique du fragment et du rythme irrégulier de la narration. Il n’y a, autrement dit, de renvoi à la jeunesse que l’incapacité à contrôler ses propres instruments, mais sûrement pas le projet. Ce qui chez Sterne (mais chez Diderot et chez Heine également, et souvent chez Jean Paul) est un accord parfait entre des pulsions contraires, un exercice d’équilibre délicat, prend ici la forme la plus prévisible de la négation. Ce n’est pas un hasard, enfin, si dans Scorpion et Félix les différents fils s’éloignent pour ne plus se renouer, un peu comme si Marx avait appris uniquement la pars destruens du sternisme, alors que chez tous les écrivains qui se sont inspirés avec succès du Tristam Shandy la multiplication exponentielle des parenthèses n’empêche pas qu’à la fin l’équation soit tout de même résolue, pour la joie de celui qui lit.
C’est pour cette raison qu’inclure officiellement Marx dans la grande famille des disciples de Laurence Sterne signifie bouleverser les critères par lesquels a été faite la théorie du roman au XXe siècle. A partir du moment où, dès les années 1910, la forme du roman a commencé à attirer pour la première fois l’attention des philosophes et des critiques littéraires les plus inclinés à la théorie, peu d’ouvrages ont attiré l’attention comme Tristam Shandy, et le rôle désagréable des détracteurs a presque toujours incombé aux marxistes les plus dogmatiques.
L’essai sans doute le plus beau de L’âme et les formes de Gyorgy Lukács (1910 en hongrois et 1911 en allemand) est tout d’abord dédié à Sterne. Il est titré « Richesse, chaos et formes » et il est écrit sous la forme d’un dialogue : dans la chambre d’université d’une camarade d’une beauté hors du commun, deux étudiants, Joachim et Vincent (tous les deux porte-paroles potentiels des doutes de Lukács), discutent du Tristam Shandy, se disputant, en réalité, le cœur de la jeune fille, qui a le rôle de spectatrice presque muette (quoique loin d’être indifférente). La victoire de Vincent (le défenseur de Sterne) est établie à la fin du dialogue par la conquête de la fille, mais elle est également la preuve que, du point de vue purement discursif (théorique, philosophique), la dispute n’aurait pas trouvé de solution : à moins de considérer, au contraire, la structure aporétique du dialogue comme la meilleure confirmation (la seule possible) des raisons qui ont poussé Lukács à faire de Sterne le maître d’une modernité qu’il considérait, déjà au cours de ces années-là, comme synonyme d’inachevé. C’est justement l’impossibilité d’arriver à une réponse définitive et la nécessité de se déplacer sur un plan différent – existentiel – afin de mettre fin à la dispute, qui confirme la victoire de Sterne. L’amour de la jeune fille serait alors la récompense de celui qui a compris la stérilité d’une opposition abstraite face à l’infinie richesse de la vie : le dénouement d’un contraste qui, reformulé de cette manière, ressemble plus à une ordalie du moyen âge qu’à une querelle académique.
Il n’est pas moins important que – d’une manière complètement indépendante de L’âme et les formes – à peu près autour des mêmes années, l’autre grand théoricien de la forme du roman de la génération de Lukács, à savoir Victor Chklovski, se soit référé lui aussi au Tristam Shandy. De huit ans son cadet (il est né en 1893), Chklovski avait commencé à réfléchir sur les mécanismes du récit à partir de 1916 avec les autres membres de la fameuse « Société pour l’étude du langage poétique » (parmi lesquels figuraient Osip Brik et Boris Ejchenbaum), mais c’est uniquement en 1921 qu’il publie son premier essai sur Sterne, inséré en 1925 dans saThéorie de la prose. Tout en n’étant pas moins antiacadémique et anticonformiste, Chklovski réfléchissait à partir de questions complètement différentes de celles de Lukács. Le Tristam Shandy l’intéressait en tant qu’exemple exceptionnel de roman qui s’amuse à afficher les mécanismes qui rendent possible son déroulement : une machine qui avance avec le capot ouvert et qui, pour cette raison, permet de mettre en évidence mieux que tout autre livre les lois générales du récit. Le paradoxe du Tristam Shandy est qu’il est à la fois un ouvrage presque unique dans l’histoire de la littérature (« Sterne révolutionna la forme à l’extrême. Il se caractérise par la mise à nu du procédé. Aucun prétexte n’est donné à la forme littéraire, qui apparaît franchement en tant que telle8 ») et le prototype, ou même le concentré, de toute possible intrigue romanesque. Au point qu’il conclut : « On affirme ordinairement que Tristam Shandy n’est pas un roman ; affirmer cela, c’est dire que seule l’opéra est de la musique, et que la symphonie est du désordre. Tristam Shandy est le roman le plus caractéristique de la littérature universelle9».
Quand Lukács écrivait l’essai sur Sterne, il n’avait pas encore découvert Marx ; Chklovski, au contraire, avait déjà abouti au communisme dans les années précédant immédiatement la Révolution d’Octobre et le ton quelque peu prophétique de ses analyses témoigne de l’enthousiasme pour les temps nouveaux. C’est la politique, toutefois, qui au cours des années suivantes mènera leurs points de vue sur le Tristam Shandy à diverger. La conversion politique de Lukács se produisit seulement au lendemain de la Grande guerre, quand en 1918, alors âgé de trente-trois ans, l’élève de Georg Simmel entra dans le parti communiste hongrois, mais avec la découverte de Marx sa théorie de l’art allait changer radicalement. On peut dire que le philosophe hongrois comprit que parmi les choses à sacrifier suite à sa prise de position en faveur de l’Union Soviétique figurait justement une idée de littérature qui, jusqu’à ce moment-là, s’était fondée aussi sur la réévaluation philosophique de l’ouvrage de Sterne, comme si l’humour était incompatible avec le sérieux de l’engagement politique. En 1910 Lukács avait reconnu en Sterne l’un des points de repère d’une modernité qu’il fallait entendre désormais comme une totalité réduite en miettes ; l’adhésion au communisme a signifié cependant, dans son cas, le choix d’une littérature très différente du modèle de Tristam Shandy, qui aurait transformé Lukács en un théoricien du retour aux formes fermées du classicisme et d’un art du récit visant à récupérer le caractère impersonnel de l’épique homérique.
Dans ce tournant, nous ne pouvons même pas voir une revanche pure et simple des arguments de Joachim, en particulier de son refus de Sterne au nom d’une conception plus accomplie de l’existence : « ce n’est qu’à l’intérieur de ces limites que se trouve notre vie, et ce qui leur est extérieur n’est que maladie et dissolution. L’anarchie est le mot. C’est pourquoi je la hais et je la combats. Au nom de la vie ; au nom de la richesse de la vie10. » Le nouveau Lukács est désormais aussi lointain de Joachim qu’il l’est de Vincent, car la révolution lui impose des critères de jugement complètement différents, même si on pourrait imaginer sans difficulté que le Lukács plus mûr puisse reprendre certaines des argumentations de l’essai de jeunesse, comme quand on l’entend dire que Sterne
nulle part […] ne vit de valeur ni de non-valeur, et que jamais il ne choisit entre elles. Il ne composa pas ses œuvres, car la condition préalable la plus élémentaire de toute conception, le choix – et la capacité d’évaluer –, lui fit défaut. Les écrits de Sterne, s’enflant en une morne absence de choix, sont sans forme parce qu’il aurait pu les poursuivre à l’infini, et sa mort ne signifie – quant à ses œuvres – qu’une fin, pas une conclusion. Les œuvres de Sterne sont sans forme parce qu’elles sont prolongeables à l’infini ; mais il n’y a pas de formes infinies11.
De la même manière, une considération comme la suivante, une fois chargée des sous-entendus impensables en 1910, ne détonnerait pas dans la bouche du Lukács communiste :
Mais la richesse réelle ne consiste qu’en la capacité d’évaluer, et la vraie force dans la force du choix, dans la partie de l’âme libérée des tonalités d’âme épisodique : dans l’éthique ; en ce que l’on peut déterminer des points fixes pour la vie. Et cette force crée avec une puissance souveraine des différences entre les choses, elle crée leur hiérarchie ; cette force qui, à partir de l’âme elle-même, projette un but en avant de ses voies, et figure par là le contenu le plus intime de l’âme, de façon ferme, formée12.
Cependant c’est le ton global qui a changé. À la lumière des événements de 1917, on pouvait croire que la saison des dissonances était sur le point de se conclure. La fracture historique dont Sterne avait été en même temps un symptôme et un interprète d’exception était sur le point de point de se résoudre, et il n’y avait plus de raison de louer un art qui semblait faire du caprice et du libre exercice de sa propre subjectivité ses points de force. C’est ainsi que, en tant que théoricien officiel du réalisme socialiste, Lukács aurait fait tirer le rideau sur Sterne, presque comme si un critique marxiste ne pouvait plus tolérer cette poétique de la dispersion et du renvoi. Par voie de conséquence Sterne disparut. Si on lui réserve encore une allusion rapide en tant que « disciple » de Cervantès dans ce qui peut être considéré comme le sommet de la réflexion théorique de Lukács, La théorie du roman (écrit en 1914-1915 mais publié uniquement en 1920), au cours des années suivantes le philosophe hongrois, occupé à élaborer la théorie du typique et du reflet, n’aurait plus trouvé de la place dans son système pour Tristam Shandy. Le chemin était tracé de manière très claire. Le grand roman du XIXe siècle avait démontré une vocation à dépasser la « négativité » et à « transcender dans l’épique » ; la victoire de la révolution aurait favorisé ce processus de récupération de l’unité originaire ; la « totalité » perdue aurait été récupérée finalement, à la fin du processus historique, dans la société sans classes. Le reste ne comptait plus : au point que dans les plus de 1600 pages de Ästhetik. in Vier Teilen (1972-76) on ne fait pas une fois mention de Sterne.
Mais était-il si sûr que Sterne – entendu comme synonyme d’humour, de jeu et d’autoréférentialité de la parole littéraire – était forcément incompatible avec Marx ? Comme on a vu, à la lumière de ce que nous savons des goûts du philosophe allemand, il y a de bonnes raisons d’en douter. Au moment où Lukács renia Sterne,Scorpion et Félix n’avait pas encore été publié, mais même après 1929 plusieurs continuèrent à croire que l’engagement politique devait mener nécessairement à l’art apprivoisé que l’Union Soviétique de Staline était en train de promouvoir comme modèle pour les écrivains socialistes de toute la planète. À la limite, si vraiment Marx était l’auteur de ces pages embarrassantes, il fallait supposer que dans les années suivantes il s’était ravisé, car l’homme qui avait écrit le Capital ne pouvait pas être le même que celui qui s’était amusé à se moquer du lecteur avec une série désordonnée de parodies, de jeux de mots et de « bouffonneries transcendantales » (pour reprendre une dernière fois le vocabulaire de Friedrich Schlegel).
L’existence d’un État socialiste impliquait également l’affirmation d’une seule et unique interprétation légitime de la leçon de Marx : jusqu’à ce qui concerne les questions littéraires. La révolution était une chose sérieuse, et même celui qui se consacrait à l’étude des romans ne devait pas perdre de temps avec de telles futilités. Après avoir résolu le scandale, en reléguant Scorpion et Félix aux épreuves juvéniles (comme dans toute hagiographie qui se respecte, Marx aussi avait droit à une jeunesse d’erreurs, dont il devait se racheter, une fois l’appel reçu), c’était le moment de passer au règlement de comptes avec tous ceux qui s’étaient permis de formuler une conception des rapports entre politique et littérature différente de celle qui était dominante sous Staline. Au nom de Marx, en 1930 Chklovski fut contraint de faire l’autocritique des positions qu’il avait exprimées dans la Théorie de la prose (y compris l’éloge de Sterne), abjurant son propre formalisme des années précédentes avec un document titré « Monument à une erreur scientifique ». Au nom de Marx, l’autre grand théoricien du roman actif en Russie dans cette période-là, Michail Bakhtine fut condamné fondamentalement au silence jusque dans les années 1960, quand ses études sur Dostoïevski (1961) et Rabelais (1965), dans lesquelles Sterne occupe une place centrale, virent enfin le jour.
C’est à partir des années 1930 que la théorie de la littérature d’inspiration marxiste lutte afin de se libérer du poids oppressant que le communisme russe lui a imposé en la transformant en philosophie de l’art de l’Union Soviétique. Dans l’opinion commune – notamment à cause de l’effet de l’œuvre d’auteurs tel Lukács – il a été impossible toutefois de séparer complètement ces deux histoires et de libérer l’œuvre de Marx de la tutelle de ses soi-disant disciples. À cause de cela, encore dans la moitié des années 1980, quand le pouvoir soviétique commençait à chanceler, brandir le nom de Sterne et de Diderot pouvait être perçu comme la revendication d’un modèle de littérature à l’opposée de celui professé dans les pays de l’Est. Quand Milan Kundera attaque, dans l’Art du roman (1986), le roman réaliste du XIXe siècle et ses ramifications du XXe siècle au nom d’une liberté d’écriture – que l’auteur de L’insoutenable légèreté de l’être associe au contraire aux grands narrateur du XVIIIe siècle, Sterne et Diderot en tête – sa cible est représentée par toute la tradition de l’hégélianisme philosophique qui avait trouvé justement dans le Lukács tardif son interprète le plus éloquent. On ne fournit pas de noms et le discours concerne tout aussi bien les intellectuels de l’Ouest que ceux de l’Est, mais il n’est pas difficile d’entendre, dans des passages comme le suivant, la voix du dissident et de l’expatrié politique qui a vécu à la première personne la transformation de la philosophie de Marx en un système fait de commandements et d’interdictions :
La sagesse du roman est différente de celle de la philosophie. Le roman est né non pas de l’esprit théorique mais de l’esprit de l’humour. Un des échecs de l’Europe est de n’avoir jamais compris l’art le plus européen – le roman ; ni son esprit, ni ses immenses connaissances et découvertes, ni l’autonomie de son histoire13.
Kundera suggérait que si l’Europe voulait se sauver, il faillait revenir à cet héritage oublié. Ce n’est pas surprenant donc que, plus ou moins dans les mêmes années, l’écrivain tchécoslovaque ait réalisé une adaptation théâtrale de Jacques le fataliste, conséquence presque nécessaire de son diagnostic sur le roman et sur l’esprit de l’Europe. Toutefois, Kundera aurait été étonné de découvrir à quel point Marx – le jeune Marx tout aussi bien que le plus âgé – estimait justement, parmi tous, les narrateurs qui lui étaient les plus chers, Sterne et Diderot, jusqu’à les choisir en tant que modèles pour sa seule tentative d’écriture romanesque. Les drames qui ont marqué l’histoire du XXe siècle reposent aussi sur le tragique de ces équivoques.
Gabriele Pedullà
Traduit de l’italien par Cecilia Benaglia avec l’aimable autorisation de l’auteur. Paru originellement dans Karl Marx, Scorpione e Felice. Romanzo umoristico, Editori Riuniti, Rome, 2011. Cet article a été publié dans le revue Période.
- Note 35 de Le Capital – Livre premier, en ligne :https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-I-4.htm. []
- Le Capital- Livre premier, en ligne https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-25-4.htm []
- Dans Enzensberger, Gesprache mit Marx und Engels (1973). Notre traduction. []
- Schlegel, « Entretient sur la poésie », dans P. Lacoue-Labarthe et J.L. Nancy éd., L’absolue littéraire, théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil,1978, p. 322. []
- Idem. p. 322-323 []
- Idem. Notre traduction. []
- Dans Enzensberger, Gesprache mit Marx und Engels (1973). Notre traduction. []
- V. Chklovski, Sur la théorie de la prose, traduit du russe par G. Verret, Lausanne, Éditions l’Age d’homme, 1973, p. 211. []
- Ibid. p. 244. []
- Georg Lukács, L’âme et les formes, trad. Guy Haarscher, Gallimard, Paris, 1974, p. 211. []
- Ibid, p. 228. []
- Ibid, p. 236. []
- Kundera, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1986, p. 194-195. []