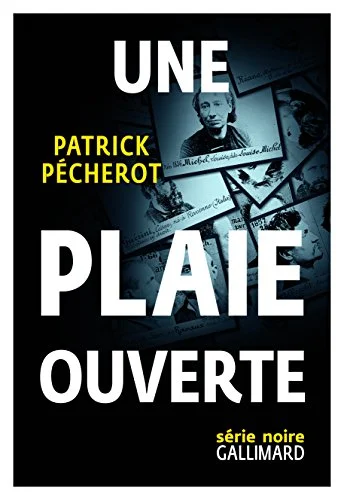« Une plaie ouverte » : le roman noir de la Commune
Traquant le souvenir et la résurgence d’un ex-ami, disparu sans laisser de traces après la Commune à laquelle il avait activement participé, et les traquant, fût-ce par détective Pinkerton interposé, jusque dans les plis d’images improbables arrachées aux hasards des balbutiements de la photographie et du cinéma, jusque dans les shows du Wild Wild West et de ses concurrents de moindre envergure, jusque dans les bribes de communautés utopiques semées aux coins des vastes plaines américaines, un Communard amnistié, des années plus tard, revit ces moments fondateurs désormais enterrés sous les mensonges, les révisionnismes et les réécritures.
Publié en septembre 2015 dans la Série Noire de Gallimard, le neuvième roman de Patrick Pécherot restitue à la perfection ce Paris populaire, ouvrier, bohème ou canaille qui faisait déjà une bonne partie du charme particulier de sa trilogie des « Brouillards », en y insufflant la résonance spécifique que peuvent produire, entrechoqués avec brio, la Commune, l’industrie naissante du divertissement industriel, et Arthur Rimbaud.
C’est quai de la Mégisserie que Marceau avait trouvé les photos. Les tirages papier commençaient à remplacer les plaques sensibles. C’était il y a des siècles. Parmi les vues de Paris et les roses de Redouté, des planches édifiantes : la Commune en images…
La première, il l’avait acquise malgré lui. Comme étranger à son geste. L’assassinat des généraux. Lecomte et Clément-Thomas. Côte à côte. Crânes. Ils regardent la mort en face. Elle va jaillir des fusils qui les mettent en joue. La photographie est truquée. Elle l’a été avec la bonne conscience qu’il n’en est rien. Que les choses se sont ainsi passées. Ou à peu près. Que l’à-peu-près est détail. Et que reconstituer restitue. Fusillés, Clément-Thomas et Lecomte l’ont été. Courageux, tout autant. Qu’on prenne des libertés pour l’illustrer n’a pas d’importance puisque cela est vrai. Ils ne sont pas morts ensemble ? La belle affaire. Ils sont morts en braves et la photo le montre. Ils ont été abattus par leurs soldats ? On gommera les renégats souillant l’uniforme. C’est la Commune qui a fusillé. C’est elle qui sera désignée. Sur le cliché, signé Appert, des gardes nationaux remplacent les mutins. Appert connaissait son affaire. On l’a dit de la police. On a tout dit.
Bien que se rappelant avec une clarté toute cinématographique scènes précises et instants chavirés, lorsque journalistes, artistes, chiffonniers ou piliers de comptoir étaient devenus incarnations d’un peuple provisoirement en marche, côtoyant poètes aguerris et déjà en déshérence, passant là presque par hasard, ou adolescents encore en devenir, machiavéliques avant l’âge, qui n’étaient déjà plus guidés par les haleurs, l’enquêteur sent peu à peu le doute s’insinuer en lui. À la falsification, orchestrée ou instinctive de la grande Histoire, faut-il ajouter un effritement de la petite, de la sienne, naissant d’une mémoire plus incertaine qu’il n’y paraît, d’impossibilités peu à peu avérées, ou de la présence maladive de troubles que la psychiatrie naissante tenterait aussi de corriger ?
Verlaine et Rimbaud en 1873
“Il y avait à la Banque de France une fortune de trois milliards trois cent vingt-trois millions. Que serait-il advenu si la Commune eût pu s’emparer de ce trésor ? » L’article du Matin date du 11 juin 1871. La question qu’il pose n’aura pas de réponse. Et pour cause. Elle est biaisée. Menteuse comme toutes les bavures d’encre grasse sur les unes des journaux. « Si la Commune eût pu… » Il est là l’obscène, le sous-entendu envoyé comme une lettre anonyme. Elle ne pouvait que vouloir, la Commune, ramassis de racailles. Mais son plan a loupé. L’article ne dit pas pourquoi. On le devine : la Commune ratait tout. Même ses mauvais coups. Trop gabegie. Sotte jusque dans la crapulerie. Il en suggère, des vacheries, ce « eût pu ». Mais voilà, si la Commune ne s’est emparée de rien, c’est qu’elle n’a pas voulu. La Commune c’est Paris mais la Banque c’est la France. Alors, respect. L’argent des dépenses courantes, on le demandera poliment. Des avances, voilà ce qu’elle sollicite, la Commune. Le compte de la ville est créditeur, Paris dispose de neuf millions d’avoirs. Le gouverneur de la Banque peut fournir les picaillons réclamés. Rien que de très légal. Beslay veille au grain. Beslay, doyen de la Commune, délégué à la Banque de France, probe, vieux sage proudhonien. Réglo sur toute la ligne. Économe des deniers du pays comme du sang des autres. Pétri de principes, têtu comme un Breton qu’il est, il se méfie des Comités de salut public comme d’une guillotine. Il appartient aux minoritaires avec Vallès, Courbet, Vuillaume… Mais sur la Banque, plus de majorité, plus de minorité. Tout le monde s’accorde : pas touche.”
Avec cette « Plaie ouverte », Patrick Pécherot signe un beau roman de la Commune, à ranger précieusement aux côtés du grand « Cri du Peuple » de Jean Vautrin et Jacques Tardi, ou du « À notre humanité » de Marie Cosnay., mais aussi en filigrane un manifeste de l’industrialisation naissante du divertissement, à rapprocher du « Tristesse de la terre » d’Éric Vuillard. Usant à merveille d’une langue râpeuse et faubourienne, d’un sens théâtral qui se faufile discrètement pour surgir chaque fois que nécessaire, d’une noirceur pouvant facilement déjouer les attentes de la lectrice ou du lecteur, et d’une joyeuse ou pensive insertion d’éléments issus des grands poètes du temps, et au premier chef des deux personnages toujours plus essentiels, malgré les apparences, que sont Verlaine et Rimbaud, il nous offre peut-être surtout un grand roman de l’obsession et de la mémoire, de la trahison et du maquillage, de l’idéal et du réel.
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.