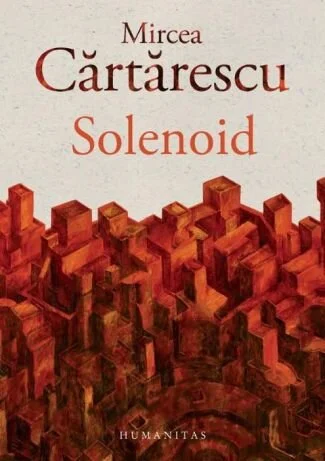Savez-vous chasser les poux avec Mircea Cartarescu ?
Par un narrateur surchauffé se revendiquant anti-écrivain, une fantastique et totalisante vue en coupe d’une capitale de la douleur. Un chef-d’œuvre.
J’ai de nouveau attrapé des poux, cela ne m’étonne même plus, ne m’effraie plus, ne me dégoûte plus. Cela ne fait que me démanger. J’ai des lentes presque tout le temps, j’en fais tomber quand je me coiffe dans la salle de bains : des petits œufs couleur nacrée, à l’éclat sombre sur l’émail du lavabo. Il en reste pas mal entre les dents du peigne, que je nettoie ensuite avec une vieille brosse à dents, celle dont le manche de bois a moisi. Impossible pour moi d’échapper aux poux – je suis enseignant dans une école de la périphérie. La moitié des enfants ont des poux, on les trouve à la rentrée, lors de la visite médicale, quand l’infirmière écarte les mèches avec les gestes experts des chimpanzés – mais sans écraser entre ses dents les carapaces de chitine des insectes capturés. En revanche, elle conseille aux parents une solution crayeuse et blanche, qui sent la chimie, la même que les enseignants finissent par utiliser aussi. En quelques jours, toute l’école en arrive à empester la solution anti-poux.
Ce n’est pas si grave, car au moins nous n’avons pas de punaises, on n’en a pas vu depuis longtemps. Je me souviens d’elles, j’en ai vu de mes propres yeux quand j’avais trois ans, dans la petite maison du quartier Floreasca où j’ai vécu dans les années 1959-1960. Papa me les montrait, quand il soulevait brusquement le matelas du lit. Elles étaient comme des petits grains écarlates, aussi luisants que des fruits des bois, aussi durs que ces baies noires du lierre dont je savais qu’il ne fallait pas les porter à la bouche. Sauf que ces grains entre le matelas et le cadre du lit couraient vite vers les coins sombres et leur précipitation me faisait rire. J’étais impatient que papa soulève de nouveau le lourd matelas par le coin (au changement des draps) pour revoir les petites bêtes dodues. Je rigolais tellement que maman, qui me laissait les cheveux longs et pleins de boucles, me prenait dans ses bras en me lançant d’invisibles postillons affectueux pour me protéger du mauvais œil. Papa apportait ensuite la pompe à lindane et administrait une bonne douche malodorante aux punaises réfugiées dans les jointures du cadre de lit. J’aimais son odeur de bois, du sapin encore gorgé de résine, j’aimais même l’odeur de l’insecticide. Ensuite papa relâchait le matelas et maman venait avec les draps sur les bras. Quand elle en étendait un en travers du lit, il se gonflait et faisait comme un beignet dans lequel je me glissais avec un plaisir inouï. J’attendais que le drap retombe sur moi, lentement, qu’il prenne la forme de mon petit corps, sans se mouler sur chaque détail mais en dessinant des plis compliqués, grands et petits. Les chambres étaient alors vastes comme des hangars et, à l’intérieur, tournaient deux géants qui, on ne sait pourquoi, prenaient soin de moi : maman et papa.
Le narrateur de « Solénoïde » a été enfant, a grandi dans la société socialiste roumaine de 1945-1989, à Bucarest. Naturellement choyé par ses parents, il a connu les logements exigus qui apparaissent néanmoins immenses aux yeux d’un enfant, les séjours précoces en sanatorium de prévention de la tuberculose, avec l’apprentissage ambigu de la collectivité qui en découle, l’adolescence ambiguë, les rêves de gloire littéraire, le désenchantement après l’humiliation d’une lecture publique précoce et infructueuse, puis la résignation dans son poste ingrat de professeur de collège, aux confins d’une banlieue légèrement oubliée. Voilà pour le réalisme et les apparences de ce roman de près de 800 pages. Dessous, ah, dessous… il y a bien entendu un foisonnement somptueux de bien d’autres choses. Non pas la manière dont l’obsession sécuritaire paranoïaque du communisme déchu en dictature englobante put nourrir les cauchemars comme les rêves paradoxaux : c’était là l’un des fils conducteurs les plus apparents des fabuleux « Orbitor » (1996), « L’Œil en feu » (2002) et « L’Aile tatouée » (2007), l’œuvre trifide qui précède et informe ce monstrueux « Solénoïde ». Autre chose… qui ne se raconte pas nécessairement, qui ne se résume certainement pas, mais qui enchante et éblouit, dans les replis même de sa noirceur potentielle.
C’était une école petite, un hybride en forme de L, avec un corps de bâtiment ancien, fissuré, aux carreaux cassés, et, au fond de la cour, un bâtiment récent encore plus désolant. Dans la cour, un panneau de basket descellé dont l’anneau était dépourvu de filet. J’ai ouvert le portail et suis entré. J’ai fait quelques pas sur l’asphalte de la cour de récréation. Le soleil avait justement commencé à descendre, si bien qu’un nimbe de rayons s’était déposé sur le toit du bâtiment ancien. Ils en jaillissaient, tristes, noirs en quelque sorte, car ils n’éclairaient rien et ne faisaient qu’augmenter la solitude inhumaine de ces lieux. J’avais le cœur serré : j’irais dans cette école pétrifiée comme une morgue, j’avancerais, avec le cahier d’appel sous le bras, dans ses couloirs peints en vert foncé, je monterais à l’étage et j’entrerais dans une classe inconnue où trente enfants étrangers, plus étrangers que s’ils étaient d’une autre espèce, m’attendraient. Peut-être même m’attendaient-ils déjà, silencieux sur leurs bancs, avec leurs plumiers en bois, leurs cahiers recouverts de papier bleu. Cette pensée m’a donné la chair de poule et j’ai regagné la rue presque en courant. « De toute façon je ne resterai pas enseignant toute ma vie », me suis-je dit alors que le tramway me ramenait dans le monde blanc, que les arrêts défilaient derrière moi, que les maisons se rapprochaient les unes des autres et que des gens peuplaient de nouveau la Terre. « Tout au plus une année, jusqu’à ce que je sois pris dans une rédaction, dans une revue littéraire. » Et durant mes trois premières années d’enseignement à l’école 86, je n’ai fait que nourrir cette illusion, c’est vrai, tout comme les mères continuent à nourrir leur enfant au lieu de les sevrer. Mon illusion avait grandi avec moi et je ne pouvais m’empêcher – d’une certaine manière, c’est encore le cas – d’ouvrir ma chemise, au moins de temps en temps, pour la laisser me cannibaliser avec volupté. Les années de stage ont passé. Une quarantaine d’années passeront encore et quand je partirai à la retraite, ce sera d’ici. Finalement, ça n’a pas été si dur que ça, jusqu’à présent. J’ai vécu de longues périodes sans poux. Oui, si j’y pense bien, ça n’a pas été si mal dans cette école, et ce qui a été a peut-être été pour le mieux.
On sait, au moins depuis la trilogie « Orbitor », à quel point Mircea Cǎrtǎrescu aime à instiller puis à distiller, dans le moindre interstice laissé ouvert, l’imagination bizarre, voire fantastique, que les personnages intègreront à leur tour avec plus ou moins de naturel, pour nous offrir, consentants ou à leur corps défendant, une vue en coupe particulièrement saisissante de l’objectif ainsi visé. Une Bucarest ville malade certes, mais surtout une Bucarest capitale de la douleur, va ainsi être visitée de fond en comble (presque stricto sensu), depuis les bases de départ anodines ou étranges que constituent un collège banal de quasi-banlieue, une usine désaffectée, une bibliothèque publique (mais l’est-elle ?) et une maisonnette baroque aux recoins insoupçonnables, trônant au coeur d’un quartier périphérique habité par des tziganes déconsidérés, mais nantie, comme quelques autres édifices, d’un solénoïde aussi puissant que mystérieux. Parmi les sectateurs piquettistes, hautement illégaux, protestant massivement contre la mort, dans le labyrinthe des énergies amassées, le narrateur, s’appuyant sur l’ami mathématicien, capable d’éclairer les secrets du Rubik’s Cube, des tesseracts, des algèbres booléennes ou des folies de Charles Howard Hinton, et sur l’amante physicienne, communiant tant avec les mystères magnétiques (et charnels) du solénoïde qu’avec les mécaniques secrètes des fluides qui sont ici à l’œuvre, parviendra-t-il à découvrir ou à dresser son plan d’évasion ?
Mon cahier d’appel sous le bras, je descends vers la salle des profs et, cette fois-ci, le chemin paraît court, on ne peut plus simple, comme si la salle se trouvait juste au coin. Mais ça me prend autant de temps pour y arriver parce que ça grouille d’enfants comme de guêpes au cœur d’un nid, sans répit, des enfants qui crient à t’en percer les tympans. Tu ne peux pas passer, car ils sont collés les uns aux autres comme des siamois, mais tu peux t’élever au-dessus d’eux en un saut habile, que tous les professeurs connaissent et pratiquent – les autres n’ont pas survécu – et alors ils te portent de bras en bras au-dessus de leurs têtes pleines de lentes, en te pelotant sous ta jupe si tu es une femme et en te faisant les poches si tu es un homme, mais finissant par te déposer en sécurité devant la salle des professeurs. Tu lisses tes vêtements, tu effaces ton désespoir de ton visage et tu entres d’un air affable, disposé aux plaisanteries et aux bavardages, comme si rien ne s’était passé.
Si Mircea Cǎrtǎrescu mobilise à point nommé littérature du sanatorium et littérature de l’internat (ni Robert Musil ni Max Blecher ne sont si loin que ça à certains moments), c’est bien, davantage que les labyrinthes borgésiens (même si les bibliothécaires mystérieux sont ici particulièrement instrumentaux) ou les assauts retors et jouissifs d’érudition de Milorad Pavić, sous le signe d’Adolfo Bioy Casares qu’est menée cette vaste opération de chirurgie poétique à coeur ouvert : les souterrains de cette Bucarest bruissent d’inventions de Morel (voire de baroques machines de torture à la « Princess Bride ») et, explicitement, de plans d’évasion. Ruines et espaces désaffectés devenus secrets ou magiques organisent partout la présence du no man’s land, résonnant autant avec le John Burnside de « Scintillation » qu’avec les frères Strougatski ou l’Andreï Tarkovski de « Stalker ». Si l’on ne négligera certainement pas les pièges et appâts psychanalytiques disposés ça et là, en quelques carrefours stratégiques, ce sont bien la microbiologie et la parasitologie qui font ici figure de chevilles ouvrières pour la quête existentielle et poétique du narrateur. Au lieu des ténias de Scott Baker, le sarcopte de la gale, et en guise de laboratoires avancés de transformation biologique, une morgue et un cabinet de dentiste : Mircea Cǎrtǎrescu travaille ses métaphores en profondeur et au long cours, et en extrait une poésie à la fois palimpseste et tourbillonnante, une mécanique des fluides physiques et psychologiques qui opère en fabrique du réel, fabrique du malheur et fabrique de l’illusion (comme chez Chirico, plusieurs fois évoqué, comme chez Lovecraft, qui rôde devant le seuil, ou chez Philip K. Dick, sans voir le bout du labyrinthe, le rêve ici contamine très naturellement le réel). Sous l’égide discrète du Desdichado de Gérard de Nerval et sous celle, flamboyante, des Isachar et Hermana de Franz Kafka, s’attelant à l’indispensable recyclage permanent des mythologies qui nous structurent, toujours à réorienter, tissant mètre à mètre une incroyable toile d’araignée par la mise bout à bout des rencontres, des fenêtres de tir, des coïncidences de dates et de lieux, Mircea Cǎrtǎrescu donne à notre terrier les dimensions d’un univers entier, et par la dissection patiente et néanmoins frénétique de cette Bucarest particulière et universelle, nous encourage secrètement, une fois digérés les effets conjuratoires de onze pages d’appels à l’aide, à donner à notre imagination la puissance transgressive du solénoïde : « Puis il ne resta plus que l’aveuglante lumière des débuts. »
Mes actes seront donc fantomatiques, transparents et indécidables, mais en aucun cas irréels. Je les ai toujours vécus. Ils m’ont tourmenté inutilement. D’une certaine manière, ils m’ont volé ma vie comme l’auraient fait mes livres si j’avais réussi à les écrire. En plus, ils ne sont pas accomplis, ils sont en cours de déroulement, ce qui est une autre source de doute et d’indécision. J’ai des indices, j’ai fait des liens, je commence à entrevoir ce qui ressemble à de la cohérence dans la charade de ma vie. Il est évident que l’on me dit quelque chose, de manière insistante, constante, c’est comme une pression continue sur mon crâne, sur certaines de ses bosses, mais quel est le message, de quelle nature est-il et de qui vient-il ? Que me demande-t-on ? Je me sens parfois comme un petit enfant mis devant un échiquier. Tu as pris le pion blanc, parfait. Mais pourquoi le fourres-tu dans ta bouche ? Pourquoi tu fais pencher l’échiquier, tout va tomber ? Ou peut-être que c’est la solution ? Peut-être que la partie est gagnée par celui qui comprend soudain l’absurdité du jeu et qui le renverse, celui qui tranche le nœud quand tous les autres s’efforcent de le dénouer ?
Je vais donc bâtir ici une histoire de ma vie. Sa partie visible, je le sais mieux que personne, est la moins spectaculaire, la plus terne des vies, la vie qui correspond à mon visage effacé, à mon caractère distant, à mon insignifiance et à mon manque d’avenir. Une allumette presque entièrement consumée, dont ne reste qu’une traînée de cendre blanchâtre. Le professeur de roumain de l’école 86, tout au bout du quartier Colentina. Et pourtant, j’ai des souvenirs qui disent une tout autre histoire, j’ai des rêves qui les fondent et les confirment, et dont l’ensemble a construit dans les souterrains de mon esprit un monde d’événements fantastiques, indéchiffrables et qui malgré tout veulent désespérément être déchiffrés. Comme un étage de ma vie qui se serait écroulé : les câbles sont arrachés et les liens avec les édifices restés à la surface se sont brisés. Dans mes souvenirs d’enfance et d’adolescence, il est des scènes que je ne peux localiser que très difficilement et que je ne comprends toujours pas, comme des pièces de puzzle jetées dans une boîte. Comme des rêves qui attendent leur interprétation.
Il faut souligner le travail exceptionnel de la traductrice Laure Hinckel pour nous offrir ce roman en français (traduction en 2019 chez Noir sur Blanc du texte roumain de 2015). Comme Claro dans le cas d’un autre livre-univers (le « Jérusalem » d’Alan Moore), elle a su non seulement déchiffrer magistralement les méandres parfois retors d’une architecture incroyablement ramifiée et d’une tectonique des plaques souvent fort insidieuse, aux allusions innombrables, mais elle nous propose de surcroît de superbes extraits de son journal de traduction, que l’on pourra retrouver en différents endroits de la toile, par exemple ici ou là.
Puisque je ne suis pas écrivain, j’ai le privilège insondable d’écrire de l’intérieur de mon manuscrit, entouré par lui de toutes parts, sourd et aveugle à tout ce qui viendrait me distraire de mon labeur de forçat. Je n’ai pas de lecteur, je n’ai pas besoin d’apposer ma signature sur un livre. Ici, dans le ventre du manuscrit, errant dans ses intestins enroulés, écoutant ses étranges borborygmes, je sens ma liberté, je sens aussi sa compagne obligatoire : la folie.
Mircea Cartarescu - Solénoïde - éditions Noir sur Blanc,
Charybde2 le 14/11/19
l’acheter chez Charybde ici