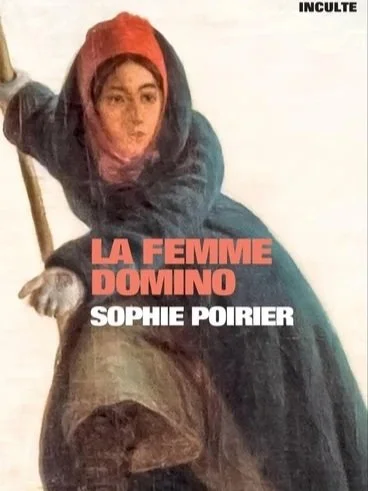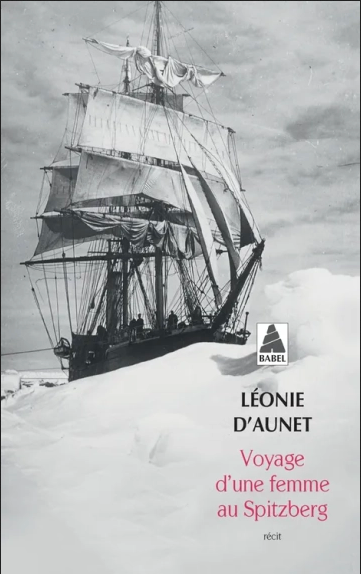Le puzzle équivoque de la femme domino
Exploratrice, écrivaine, maîtresse de grand poète et prisonnière au sens propre, femme libre et femme opprimée : qui fut la femme domino, et que nous dit-elle subrepticement ?
Leurs regards se font face.
En apparence, une même patience.
Mais ne se regardent pas vraiment.
Lui, observe des lignes, le corps, une ombre, que sa main ensuite dessine.
Elle, dans ses pensées, fixe la fenêtre ensoleillée, écoute les recommandations, et : tourner son visage, plutôt le menton vers le bas, oui, maintenant les bras lâchés au lieu de les serrer sur le ventre.
Est-ce qu’on peut faire la statue ainsi toute une vie ?
Il lui a demandé de changer légèrement sa posture. Elle se tourne, penche la tête, obéit au peintre. Il parle délicatement, sans offense. Elle n’est pas gênée, elle se soumet aux propositions qu’il indique.
Il faudra sûrement un mari.
Il suggère un geste. Léonie soulève son jupon. Elle n’a pas honte, elle le remonte jusqu’aux cuisses, les yeux toujours tournés vers cette lumière haute du ciel clair. Au cœur de Paris, des jeunes filles posent pour des artistes, les jupes relevées font partie des histoires et de certains tableaux.
En réalité, elle voudrait s’échapper, sans savoir où aller, mais exister.
Dans l’atelier du peintre, un fatras attirant, des objets amoncelés. Cet homme, plus âgé, a voyagé. Il a ramené une idée du monde et de ses aventures, ici, à Paris, dans un hôtel particulier, 8 place Vendôme. Draperies, vases et plumes, un poignard oriental, des pavillons maritimes, des palmiers italiens… Et ce singe, vivant, sautillant. Quelle surprise.
Il faudrait une aventure.
Le peintre indique la position à prendre : Oui, davantage vers la droite, le buste un peu penché, voilà.
Parmi ses toiles, des scènes exagérant le courage, puis de larges fresques historiques, qui attirent les commandes royales, et bientôt à Versailles selon la volonté de Louis-Philippe. Pas si talentueux selon certains critiques, mais prolifique, adroit, stratège. Il a quarante ans, et il a voyagé dans toute la Méditerranée, jusqu’en Afrique du Nord, en Syrie…
Elle entend quand il exige : Ne bouge plus, Léonie. C’est parfait.
Sinon, la vie sera lente, comme celle de ces femmes auxquelles elle n’a pas envie de ressembler. Elle connaît, à travers les livres et les réputations, celles qui ont une originalité, une liberté. Romancière, comme George Sand. Ou aventurière, comme Henriette d’Angeville grimpant le mont Blanc.
Léonie, modèle à dix-sept ans dans un atelier d’artiste, n’est pas une jeune fille sans éducation. Elle a étudié dans un pensionnat réputé, elle connaît parfaitement l’anglais, elle aime la littérature.
En 1825 à Paris, rue de l’Abbaye, une autre jeune fille a posé, pour un sculpteur dont elle est devenue la maîtresse. Elle s’appelle Juliette, elle fera l’actrice, sans grand succès. Et puis, son destin suivra fidèlement corps et âme celui d’un immense écrivain. Qu’elle surnommait Toto, on peut le lire dans ses si nombreuses lettres, parfois sept fois par jour à lui écrire.
Douze ans après Juliette, Léonie met elle aussi sa silhouette au service de l’art et prend la pose, devant le peintre François-Auguste Biard.
Dans ces années-là, 1837, 1838, Juliette et Léonie ne se connaissent pas. Plus tard, elles seront rivales.
Sur un dessin qui représente Léonie – elle aurait vingt ans -, joues rondes, tête bouclée, on dirait une enfant. Quand elle rencontre Biard à dix-sept ou dix-huit ans, elle a donc ce visage.
Un biographe s’interroge : par quelle intrigue Léonie s’installe dans l’atelier place Vendôme, avec le singe, les tableaux, les objets hétéroclites. Les invités au domicile du peintre croient – ou feignent de croire – qu’ils sont mariés. Pendant les événements de la Commune, de nombreux bâtiments seront détruits au printemps 1871, dont la colonne, un grand nombre de papiers administratifs disparaissent dans les incendies parmi lesquels l’acte de naissance de Léonie. On ne sait pas quel mois de 1820, janvier ou juillet. Son nom d’après un acte de baptême, Aimée Victorine Léonie Pauline de Boysnet dite Léonie Thévenot d’Aunet, du nom du père décédé en décembre 1819 ou janvier 1820 ; sa mère Joséphine, née Orémieulx, épouse de Boysnet, baptise donc Léonie sans doute après ce second mariage. La mère courant d’air part pour toujours en Amérique, sa fille n’a que douze ans…
Il y a des manques dans l’histoire de Léonie, avec des événements éclatants et alors on imagine ce qu’elle traverse, puis sa vie finit, discrètement à se faire oublier.
Quelque chose aussi très tôt, en elle, de naissance presque, qui sème le doute.
En 2022, Sophie Poirier nous avait ébloui d’intelligence et de sensibilité avec « Le Signal », étrange chronique à niveaux multiples d’un immeuble de bord de mer condamné par l’érosion côtière. « La femme domino », publié en avril 2024 chez Inculte Dernière Marge, renouvelle – et au-delà – ce miracle d’écriture, tour à tour pudique (et sachant bien user de la magie du juste suggéré) et jaillissante, en se saisissant de la figure de Léonie d’Aunet (1820-1879), femme de lettres française qui fut notamment – et l’un des enjeux de l’ouvrage sera bien d’assumer et dépasser toute tentation de réduction biographique, justement – jeune femme du peintre François-Auguste Biard (1799-1882), exploratrice et chroniqueuse au Spitzberg (lors de l’expédition Gaimard de 1839), maîtresse de Victor Hugo durant sept années, emprisonnée deux mois puis internée en couvent six mois pour délit d’adultère en 1845 – le célèbre poète, lui, en tant que pair de France, ne peut être réellement inquiété par la justice -, romancière et critique littéraire à partir de 1854, enfin ou surtout.
« La femme domino » (du nom donné au XIXe siècle en France aux femmes écrivant sous pseudonyme) n’est pas une biographie, du tout, même si elle utilise nombre d’éléments biographiques : en suivant les grands et les petits chemins de Léonie d’Aunet, de Hammerfest sur l’itinéraire menant au Spitzberg à la rue Saint-Roch menant au flagrant délit, au scandale et à la prison, du cimetière de Ville-d’Avray au Svalbard Global Seed Vault (sur lequel Xavier Boissel avait su exercer une autre inoubliable mise en fiction), Sophie Poirier poursuit une quête singulière, où tout ou presque sera question de résonances rendant visible dans notre ici et maintenant ce qui était invisibilisé jadis et naguère (il y a à peine deux siècles, tout de même…) – comme s’étaient mis à se renvoyer leurs échos, de manière hautement poétique et productive, dans son travail précédent, l’immeuble abandonné en Bordelais et l’hôtel désaffecté en Grèce.
On dirait une cheffe indienne.
Je zoome sur son visage. Je voudrais caresser sa joue, lui témoigner une affection. Ses cheveux tombent jusqu’aux épaules, une mèche roule sur la poitrine. De son regard, on décèle les yeux clairs. Elle tient dans sa main gauche un éventail plié. A l’annulaire de la main droite, une bague, large, dorée, sculptée. Je n’arrive pas à distinguer la forme, un visage ? une fleur ? Ce n’est évidemment pas une alliance, même si en 1865, date approximative de la photo – entre 1860 et 1865 Atelier Carjat – elle est officiellement encore l’épouse du peintre Biard. Dans certains textes, même aujourd’hui, on s’obstine à la nommer ainsi, Léonie Biard, Léonie du nom du mari, Léonie pourtant séparée de corps depuis 1845. Elle est morte en 1879. Le divorce, puisque interdit jusqu’en 1884, n’a donc jamais été prononcé.
Au début, quand je l’ai découverte, elle existait avec un autre visage que celui de cette photo.
Un portrait, exposé à Versailles, était utilisé pour la représenter, dans des études ou en couverture d’une biographie. Ce visage est différent, plus fin, plus doux. Un peu mièvre.
Mais ce n’est pas elle sur la peinture.
Un expert a enquêté récemment : il s’agit de la deuxième épouse du peintre Biard.
Vous savez à quel point on apprécie sur ce blog la manière dont Perrine Le Querrec peut utiliser le prétexte biographique, par exemple à propos d’Unica Zürn (« Ruines »), de Jeanne L’Étang (« Les trois maisons ») ou d’Hannah Höch (« Les mains d’Hannah »), pour transformer des vies certainement pas équivoques mais en tout cas tout sauf univoques en chemins de haute randonnée pour appréhender autre chose – on pourrait citer aussi, perspectives traversières d’un autre type néanmoins, « S’en aller » de Sophie d’Aubreby ou même « La chanteuse aux trois maris » de Nicolas Richard, pour rester chez Inculte Dernière Marge.
Sophie Poirier nous avait déjà montré précédemment à quel point elle excellait à se saisir d’un lieu (ou de l’échange impalpable entre deux lieux) pour obtenir un effet comparable (un peu à la manière de l’Hélène Gaudy de « Une île, une forteresse » ou de « Grands lieux », mais dans un registre d’écriture et d’efficacité bien différent) : « La femme domino » démontre avec éclat que ce travail peut être poursuivi, ou même amplifié, en s’attachant (en apparence) aux pas d’une personne. Quatre parties (les noms, les voyages, l’écriture, les héritages) pour sortir peu à peu (cela prendra nettement plus d’un siècle encore) d’une définition par le sexe au moyen d’une connaissance par les gouffres, quatre parties pour mesurer que là comme ailleurs les concessions socio-politiques – même évidentes en apparence – ne sont jamais offertes mais toujours arrachées : usant de psychex et de sociex en lieu et place d’urbex, c’est affaire de traces encore – et de piste à humer et à suivre. Si Sophie Poirier questionne en toute lucidité le rôle même de l’impudeur biographique (« au nom de quoi je m’autorise à remplir les silences de Léonie ? »), elle maîtrise déjà comme bien peu la fin de l’innocence politique – et l’art de conter par cercles concentriques et par lumières, aussi bien ondes que particules.
Léonie vibre. À ce moment, encore trépidante des frissons de l’océan Glacial sur lequel elle a navigué, nourrie de tant d’expériences puissantes, de peur et de beauté, expérience physique que non seulement aucune Parisienne n’a connue mais si peu d’hommes ; puis, ses deux enfants à son cou, aimante mère, jeune et submergée de force, encouragée de ce grand voyage.
Et, maintenant, le poète hors du commun tombe à ses pieds, voudrait les embrasser à pleine bouche. Elle flirte délicieusement au milieu des bosquets, le poète prend la nature et le ciel à témoin dans des alexandrins romantiques et un peu niais. Il aime écrire, il écrit tout, il poétise toutes ses amours, et prend soin de coder ses vers – les dates, les noms, les métaphores, les références mythologiques, les rébus -, et les experts passent des années à étudier pour leur plus grand délice, comme si VH avait envisagé cela aussi, la jouissance future qu’il y aurait à le décrypter, dans sa correspondance énorme, ses poèmes en plusieurs tomes, les romans monuments, le théâtre, les discours, les carnets avec les mentions en espagnol où il indique toda pour noter ce qu’il a fait avec telle domestique, ou juste les seins, ou davantage, des initiales, un prénom dans une autre langue, les sommes d’argent données, Toto comme l’appelle Juliette, toda, tout, VH c’est l’appétit, le dévorant, la puissance créatrice hors norme, « une tempête d’homme pire qu’une tempête d’océan ».
Voilà ce qui entre dans la vie de Léonie.
(…)
Pourtant, l’écrivain à bord, ce n’était pas Marmier, c’était elle.
Elle sait, à chaque détail, se découvrant attentive, remuée par des altérités, rieuse de ses propres surprises, laissant la place à ce qui a l’air d’une naïveté mais qui est seulement un regard neuf, de voyageuse neuve, qui éprouve à la fois le mouvement du voyage, ses effets sur le corps et sur les idées qu’on avait, et tout ce qu’on ne connaît pas ; elle sait à chaque moment, effroi ou émerveillement, qu’elle incorpore une matière qu’elle pourra transformer en récit.
Comment le sait-elle ?
Elle a à peine vingt ans lorsqu’elle aborde le rivage du Spitzberg.
Je l’envie.
D’avoir compris si tôt – intuition, pragmatisme, ambition ? – l’utilité de l’expérience de l’inconnu, l’exploration, l’ailleurs. J’ai eu des amies comme ça, radieuses, fantasques, audacieuses, qui complotaient des stratégies – non pas avec des réussites assurées ou des étapes planifiées – mais qui prenaient le chemin du risque, du plus grand, trop grand et alors, qui s’embarquaient comme Léonie pour l’aventure, se mettre en péril, au moins se détacher du socle-racines, rompre avec les mères et les pères, se laisser de l’espace, flairer essayer s’ouvrir, dépasser la barrière, le fil à la patte.
J’ai eu des amies qui devinaient intuitivement que l’inconnu, l’exploration, l’ailleurs, faisaient de soi une autre personne que l’assignation ou le confort.
Pendant que moi, je suis restée longtemps en place.
Hugues Charybde, le 22/05/2024
Sophie Poirier - La Femme domino - éditions Inculte
L’acheter chez Charybde, ici