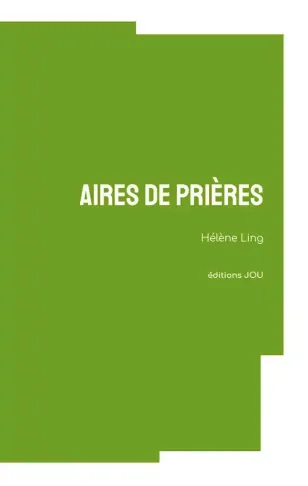Il a pris cheikh en classe affaire…
Dans le confort piégé des classes affaires en tous genres, une formidable leçon de désamorçage des péroraisons les plus auto-satisfaites du capitalisme tardif s’affirmant si élégamment mondialisé. Hilarant et incisif, “Aires de prière” est du grand art discret.
Au milieu d’un couloir de transit, au niveau du terminal 2F de l’aéroport de Roissy, Charles Serjic s’étonna de n’avoir jamais remarqué un petit panneau lumineux, de n’y avoir pas prêté attention, harassé sans doute par les trajets et les rituels d’atterrissage qui rythmaient son existence. Peut-être était-ce lié au moment, au trafic incessant des corps, des chariots à bagages, des molécules climatisées balayées par l’aspiration sans trêve du dedans et du dehors, le long des circuits balisés d’aluminium et de béton, bourdonnants de messages sonores, rehaussés de vide comme les travées d’une cathédrale. La petite enseigne orangée avait fini par lui imposer sa signalétique, son clignement d’œil incongru, même s’il lui fallait s’arrêter un peu pour lire le message, rompant à contrecœur la logique de rationalisation du temps de transport aérien. Elle affichait un message d’un genre particulier – Espace de recueillement / Meditation area.
Conseiller financier de haut vol en investissements internationaux, Charles Serjic, à la vue d’un panonceau qu’il n’avait jusqu’alors jamais remarqué, malgré sa fréquentation assidue de l’aéroport Charles-de-Gaulle (et de bien d’autres), panonceau indiquant un espace de méditation, ou espace de prière œcuménique désormais répandu dans la plupart des grands hubs occidentaux (ou orientaux), voit son flux de pensée, hautement blasé et joliment satisfait de lui-même – à juste titre, ajouterait-il sans doute discrètement -, prendre la direction plutôt inattendue de la sociologie du fait religieux contemporain, et de ses répercussions internationales politiques et économiques. Partageant de ce fait avec nous, lectrice ou lecteur, (ce qu’il estime sans le moindre doute être) sa culture, son sens de l’observation et sa capacité à établir des liens entre données apparemment disjointes, il reconstitue en son for intérieur, tout en allant profiter du salon VIP et de ses attentions, une forme syncrétique (à son tour) de sociologie religieuse contemporaine, qui oscille et s’entrechoque avec une possible éthique du capitalisme, naturellement (car c’est son souvenir universitaire de Max Weber qui provoque le deuxième déclic). Lorsqu’il se retrouve, dans l’avion, à côtoyer une séduisante businesswoman chinoise, il ne peut résister à la tentation de faire étalage auprès d’elle de sa sagacité, espérant obtenir d’elle la promesse d’un dîner à Londres, leur destination commune, le lendemain soir. Mais n’y a-t-il pas d’autres manières de décoder ce qui est en train de se passer ici, à son insu narcissique ?
Par contraste, le local sentait le syncrétisme bon marché, dans une nouvelle forme d’austérité dont le bon vieux Max Weber, qu’il avait beaucoup lu ces années-là, aurait peut-être été le premier surpris ; lui qui avait montré, se souvint-il avec un sourire, comment l’histoire des religions mondiales avait paradoxalement cédé la place à un monde désenchanté, vidé de toute signification stable par les machineries globalisées du capitalisme et de la bureaucratie. Dans l’accélération de ce dernier processus venait s’inscrire la rationalisation des pratiques religieuses, puis leur obsolescence historique à mesure que la vie sociale se modelait sur les structures impersonnelles du système économique.
Peu à peu, au rythme de sa marche et de sa respiration, lui revenaient violemment, en pagaille, les bribes du cours qui l’avait captivé, presque enthousiasmé en ce temps-là – celui du gourou, comme ils l’appelaient, le vieil homme susurrant sa pensée dialectique à mi-voix, ce qui obligeait tous les étudiants entassés dans un local branlant, mal éclairé, parfois accroupis sur le faux parquet, à un silence quasi-religieux. Et en une illumination-éclair, il se rappela ces deux années d’étude, les meilleures de sa vie peut-être, sous les voûtes tamisées du terminal.
Qu’aurait dit le vieux gourou de Nanterre, sans doute déjà mort, se dit-il – de ces espaces standard, en matériau bon marché, de ces cageots d’aéroport ? Le dernier visage des anciennes structures de la foi, lui semblait-il, où se fondaient leurs rites, leurs hiérocraties spectrales et thérapeutiques. Une palette globalisée de confessions se retrouvaient intégrées dans la normalisation des échanges, assimilées et réduites à un parallélépipède aseptisé. La formule contemporaine pour qualifier ce phénomène était le « dialogue interreligieux », si bénéfique à la coexistence pacifique des employés et des clients d’Aéroports de Paris et d’ailleurs.
Il en naissait même une nouvelle gamme de bâtiments, tel celui qui se construisait à Berlin depuis 2009, selon un article du Monde dont il avait enregistré la photographie virtuelle. Elle projetait, sous forme de maquette, un gros cube déconstruit mêlant église, mosquée et synagogue en une structure chauve, incolore, hygiéniste, baptisée The House of One. L’abstraction du nom n’avait d’égale que son indétermination, se dit-il avec une grimace, autant prier dans un conteneur. Cela manquait cruellement de ce qui faisait le charme du culte – la chair, le verbe, les saints, les prophètes, les retables, les statuettes, les stucs, les reliques, les calligraphies, les fresques, les mosaïques et l’encens. En outre, nul ne semblait choqué de ce que les polythéismes et les croyances animistes y soient scandaleusement niés.
La même critique, il fallait bien l’admettre, aurait pu s’appliquer à cette architecture aéroportuaire qu’il était tenu d’arpenter sur des kilomètres chaque mois, à la recherche de sa porte d’embarquement. Fait étrange, il adhérait presque, et non sans une légère émotion, à cette économie syncrétique optimale, si proche de son propre milieu. La capsule de prière, comme le tentaculaire duty-free qui s’étendait devant lui, témoignaient plutôt de la pratique de l’open space, la remise à plat et la transparence supposée des relations de travail. De même, l’histoire des populations, leur imaginaire concurrent s’étaient miraculeusement résorbés en trois ou quatre zones de recueillement, quasi identiques.
Dès 2006, comme le signalait ma collègue et amie Marianne dans sa note de lecture sur ce même blog (à lire ici), le court premier roman d’Hélène Ling, « Lieux-dits », cinglant avec élégance la muséification de Paris, nous impressionnait. Dans son troisième, « Ombre chinoise », en 2018, elle traquait admirablement l’illusion des généalogies et des identités coulées dans le béton des mensonges.
« Aires de prières », publié chez Jou en 2023, est son quatrième roman, et sans doute son plus malicieux à date, reprenant le fil conducteur possible de la mondialisation faussement heureuse, du métissage authentique face aux essentialisations identitaires, directes ou indirectes, et de la boue des clichés, y compris lorsqu’elle se drape dans le pseudo-« intellectualisme », syncrétique et volontiers méprisant, utilitairement matois et presque toujours blasé, des grands serviteurs du capital. En provoquant l’entrechoc d’imaginaires concurrents, qu’ils soient ou non identifiés comme tels, en débusquant les néo-fondamentalismes de toutes espèces qui se lovent au coeur des circuits financiers et commerciaux les plus repus, « Aires de prières » déroule un redoutable tapis de névroses secrètes et de jeux de miroirs délétères qui n’a rien à envier à ceux du « American Psycho » de Brett Easton Ellis ou du fondamental « Mémoires posthumes de Brás Cubas » de Joaquim Maria Machado de Assis. Dans le confort feutré et subtilement fallacieux des classes affaires en tous genres, en ne dédaignant pas un magistral et fort inattendu coup de théâtre final, Hélène Ling nous offre en à peine 80 pages une formidable et goûteuse leçon de ruse de la raison, de contre-cynisme et de dessillement de certains tours et détours du capitalisme tardif qui passeraient sinon si volontiers dans les moeurs. Du grand art, songeur et acéré, politique et retors en diable dans sa fausse bonhomie si élégante.
Lui, en tout cas, s’était demandé avec persévérance, au fil de sa carrière, s’il faisait partie des happy few, s’il serait distingué du commun des mortels par un mérite extraordinaire – Suis-je déjà, sans le savoir, parmi les élus ? aurait-il pu dire tous les lundis matins devant son miroir, et ceci, plusieurs siècles après la mort de Dieu. Se trouver parmi les élus – la formule psychique fonctionnait encore à l’époque du capitalisme le plus mûr, elle lui survivrait peut-être aussi. Sans doute, il le savait bien, le soubassement ontologique de la Grâce s’était perdu – le monde désenchanté au point de devenir proprement suicidaire, avait laissé place à un « polythéisme des valeurs » de moins en moins inventif en solutions de rechange. Mais en même temps, l’élection par l’argent, marque fort incertaine, selon Weber, de la destinée spirituelle, s’était réalisée dans ce monde de façon littérale. Ce devait être le fruit d’un malentendu tragique, une rupture définitive des hommes avec la langue de l’au-delà. Depuis, le signe et la chose s’étaient confondus, la richesse était devenue l’élection divine, qui réalisait ici-bas son ancienne promesse.
Charles ne songeait pas à s’en plaindre, loin de là. Mais il avait souffert, lui aussi. Il avait même connu une seconde période de doute intense, à l’apogée de sa carrière de conseiller financier chez Deloitte. Ce qui l’embarrassait, à cette époque, s’insinuait en lui comme un poison secrété par son propre cerveau, c’était un dérangement interne – en termes logiques, cela portait le même nom : une contradiction. Ses jours et ses nuits s’étaient alors dissociés, presque à son insu. Le jour, le monde entier sombrait dans la déréliction la plus sordide, qu’il passait son temps à nier et à déplorer, alternativement. La nuit, en revanche, en son for intérieur, en son âme et conscience, il se murmurait à lui-même qu’il était resté pur. C’était cela qu’il protégeait comme une jeune vierge, son intimité intacte, son hymen spirituel, l’authenticité de sa conscience. De loin, les envieux et les médisants – et il y en avait à chaque coin de rue, tous les vingt mètres dans ses propres services – pouvaient bien le juger, le calomnier et rire de lui, ils ne le connaissaient pas.
Mais lui-même, il devait parfois l’admettre, ne se connaissait pas bien non plus. Le jour, par exemple, il ne voulait pas savoir que les profits disons appréciables, découlant des fusions-acquisitions dont il était un expert, voire un virtuose, gains qu’il transférait ensuite sur des comptes off-shore fiables – Caraïbes, Delaware, ou tout simplement l’éternelle et swinging London, étaient bien la cause de la décomposition des territoires, des populations et des espèces vivantes qu’il voyait dépérir en temps réel, le soir, dans des documentaires, sur des téléviseurs extra-plats de suites d’hôtel. Il se rappelait ainsi avoir vu une fois, comme dans un film de science-fiction, des tombereaux de poissons éventrés, sur un pont de chalutier, dégorger la masse de déchets plastiques informes qu’ils avaient ingérés et qui recomposaient les organismes et les fonds marins. Il en rêvait même parfois – des formes que pourrait prendre le génie de l’évolution lorsque le vivant serait intimement cousu d’hydrocarbures.
Pour tout cela, il ne voulait pas savoir, derrière les fonds et titres officiels, ce que faisaient réellement les bancs de capitaux flottants qu’il était chargé de nourrir, pas plus qu’il ne voulait connaître l’origine des aliments qu’il mangeait, de l’énergie qu’il consommait, leurs conditions de fabrication, d’achat ni de dégradation. Surtout, il ne voulait jamais entendre parler de déchets. En un mot, il ne voulait rien connaître de sa propre vie, excepté les impressions nerveuses qu’il parvenait encore à gérer, assez bien, à coup de satisfactions narcissiques. Il faisait du sport dans des paysages choisis, il avait des montres de collection, des relations amoureuses satisfaisantes. Il se limitait autant que possible aux mécanismes de base, passant de la tension nerveuse extrême à la détente jubilatoire, recouvrant son fond d’angoisse par une série de plaisirs qui le rassurait sur la continuité des choses. S’il parvenait assez bien à y enfouir la quasi-totalité de sa vie consciente, il en retirait parfois comme un goût d’inachèvement, voire d’hébétude chronique. Parfois, il avait dû se l’avouer, il souffrait comme un damné de cet état schizoïde.
Hugues Charybde le 6/03/2023
Hélène Ling - Aires de prières - éditions Jou
L’acheter ici