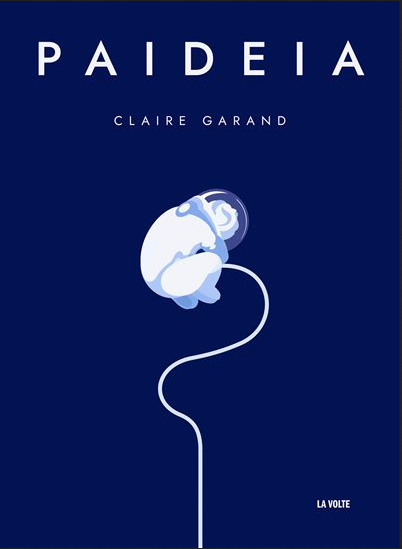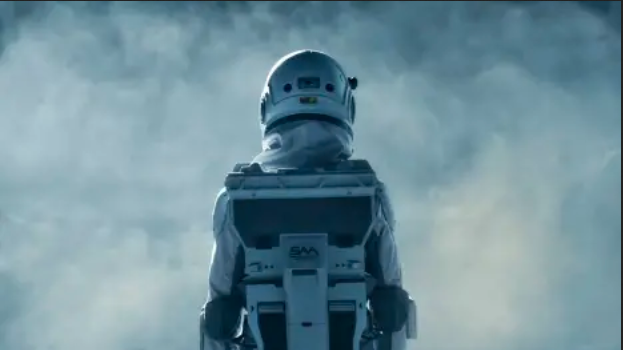Paideia, l'éthique pas toc mais en orbite de Claire Garand
En orbite lunaire, les rêves et les cauchemars d’une gamine affrontent le sort de l’espèce humaine, jadis automatiquement décidé. Imaginaire de la conquête spatiale et asservissement des corps féminins en une étrange fable éthique et politique.
Pas de note de lecture stricto sensu pour ce « Paideia » de Claire Garand, premier roman publié à La Volte en février 2023 : un petit article de ma main vous attend dans Le Monde des Livres du jeudi 2 février (daté du vendredi 3 février, à lire ici). On trouvera donc ci-dessous uniquement quelques extraits et quelques remarques en forme de « notes de bas de page ».
Un jour, avant la Descente.
Une rognure de glace salie avait quitté la queue de la comète avec quelques-unes de ses sœurs. Lancées dans le vide, elles avaient traversé l’univers à pleine vitesse sans frottement. Certaines s’étaient écrasées contre des météorites, d’autres avaient fondu à la surface d’astres morts, de géantes gazeuses ou dans l’atmosphère brûlante et épaisse de mondes où elles s’étaient sublimées en un brouillard grisâtre. D’autres encore, moins chanceuses, s’étaient fait happer par la gravité d’une planète autour de laquelle elles finiraient leurs éons, suspendues seules en attendant la grande contraction. Toujours vaillantes, les restantes persistaient dans le froid et le vide fécond qui seyait à leur nature, à des milliards d’unités astronomiques du lieu de leur décrochement, quand elles s’abattirent soudain de toute leur force sur les dix dernières stations en orbite au-dessus de la Lune variolée.
Nous connaissions toutes la procédure et n’avons pas été surprises au moment où la grêle a frappé dans la nuit artificielle. Je vivais encore un de mes rêves où des colons martiens m’érigeaient une statue à l’entrée du village semi-enterré – la reconnaissance et la ferveur dans leurs regards me réchauffaient le cœur – quand la sirène s’est déclenchée. J’ai ouvert les yeux, allongée dans mon duvet accroché au mur, en balancement paisible sous l’aérateur. Le pouce encore dans la bouche. Ma salive flottait aussi, bulle de petites bulles. Je l’ai essuyée. Le filet qui emballait mes cheveux frisés pour les empêcher de se déployer et d’être aspirés me démangeait derrière les oreilles et au-dessus du front, j’allais garder la trace rouge pendant une heure. Si l’on écartait les touffes épaisses, on distinguait un cercle de peau cicatricielle, là où une mèche avait été arrachée pendant l’un des gages stupides de Vassilissa. Je descendis la tirette de mon sac d’un coup sec mais elle se coinça.
— Par la Terre morte !
J’ai dû la remonter deux fois puis me forcer à la baisser avec une lenteur contraire à mon humeur avant qu’elle se laisse faire.
Sur l’écran noir de l’ordinateur en face de moi, les mots « pluie de micro-météorites » clignotaient en bleu.
… rien de sérieux, pas de quoi gagner le concours…
Mes pensées flottaient comme le reste, mais j’ai commencé à compter. Un, deux…
J’ai secoué ma sale tête, des larmes séchées au coin des paupières, tant la sonnerie me faisait mal aux oreilles. Les révisions pour le contrôle de géologie lunaire avaient mangé une partie de ma nuit, et j’en avais honte. J’avais beau feindre le dilettantisme, mon travail acharné se voyait. L’alerte, ô joie, justifierait mes cernes, et me ferait échapper aux sarcasmes de Vassilissa qui ne claquait des doigts que pour insulter. Mon poing s’est serré en signe d’espoir. Si la chance me souriait deux fois, madame Naïma repousserait même l’examen.
Galvanisée par cette perspective, j’ai redouté soudain une mort stupide, comme celle d’Abigaëlle.
C’était il y a trois ans.
Sa station n’avait pu se dégager à temps d’un champ de météorites et surtout, un caillou plus gros que les autres, un rocher en réalité, avait surgi et écrasé le module de propulsion. Avec mon couple parental, nous siégions aux meilleurs hublots et les vidéos extérieures avaient tout enregistré. Ce souvenir pénible fit pourtant renaître l’optimisme en moi.
… cinq, six…
Une bonne grosse pierre sur le bras robotique suffirait pour le concours, et je profiterais de ma gloire – il fallait voir grand mais pas trop, les impressionner encore plus tard. Le roc venu du cosmos le casserait d’un coup, je l’imaginais comme si mes yeux y assistaient, le métal se brisait net révélant son creux interne et, au-delà du moignon, l’autre bout s’éloignait en tournoyant à quarante-deux degrés des déchets de notre orbite avec la vitesse des fuselages disloqués pendant la guerre lunaire qu’on voit dans les documentaires historiques.
Il faut noter le superbe résultat littéraire obtenu ici par l’autrice en organisant le télescopage de trois univers le plus souvent réputés disjoints : celui de la « vie scientifique en orbite », tel que dépeint avec tant d’acuité par le film « Gravity » (2013) de Alfonso Cuarón, par exemple, celui des « chamailleries » parfois radicales de jeunes enfants entre eux (motif quasiment classique de la littérature, mais dont seul ou presque le Orson Scott Card de « La stratégie Ender » (1985) avait exploré les ramifications dans un contexte hautement spatial) et celui, enfin, de l’échappée à la fois tragique et onirique, curieusement poétique le cas échéant, d’une Terre en perdition vers un univers spatial ouvert et sans limites, dont l’incroyable « Aniara » (1956) du prix Nobel Harry Martinson (avec le film qu’il a inspiré à Pella Kågerman et Hugo Lilja en 2018) constitue sans doute l’heureux archétype.
C’est avec beaucoup de discrétion d’abord, mais avec une balle intensité in fine que Claire Garand questionne les deux faces de la science. Avec moins de cruauté et de manichéisme que ne le pratique par exemple la franchise « Alien » depuis ses débuts, certainement, mais avec une originalité redoutable, en ne posant pas la question de la finalité de la science, mais en laissant une enfant se débattre dans ses rêves et ses cauchemars, ses espoirs et ses désespoirs, avec ses conséquences en tant qu’individu – derrière lequel le destin collectif se voit néanmoins forcé de convenir, fût-ce avec une extrême réticence, de ses limites réelles. Il y a ainsi dans « Paideia » une curieuse forme de passage à la limite du caractère profondément politique de l’usage de la science, au-delà de ses automatismes apparents, ou de ses indiscutables nécessaires (et l’on rejoint ainsi par un angle inattendu tout le travail souterrain de la « Trilogie climatique » de Kim Stanley Robinson).
Claire Garand a su choisir un angle bien particulier pour évoquer la robotique et l’intelligence artificielle, en ne cachant rien de l’aspect mécanique et automatique qui trahit la persistance des algorithmes et de leur logique contestable sous l’apparente omnipotence et sous l’écorce humaine mise en place au préalable. Un discret sondage des méandres informatisés qui rejoint l’un des plus sûrs fils conducteurs de la science-fiction au cours de toutes ces années d’imagination et de questionnement.
Enfin, la sécession des riches et des puissants n’est pas traitée en tant que telle ici, mais fournit une toile de fond inexorable à l’anéantissement, avec beaucoup de talent dans le maniement du chaos auquel l’argent ne permet pas, en réalité, d’échapper – contre tous les délires mégalomaniaques qui encombrent les imaginaires contemporains.
L’alerte de cette fois suivait son cours. La peur de l’abandon tournait dans ma tête comme un programme en tâche de fond. Au bord de l’inquiétude.
Dans ma combinaison, je respirais au rythme de l’aérateur de ma cabine en regardant papa préparer le désarrimage de la navette. Ces gestes familiers, il les accomplissait en descendant en alternance avec maman un jour sur deux pour ne plus me laisser seule. Depuis le temps que nous suivions la procédure, j’aurais pu moi aussi manipuler le tableau de bord. Le hublot donnait sur le cosmos et une ou deux étoiles. On ne voyait rien. Un ennui bizarre me gagna, celui de mes nuits sans rêve de gloire, mêlé d’inquiétude pour maman mais un ennui quand même. Je n’avais pas vraiment peur pour elle, comme si la réalité oscillait. Le sommeil me manquait.
Papa ne manifestait aucune nervosité non plus et attendait la suite sans rien dire. Le trajet de notre navette jusqu’à la station un, la plus proche sur l’orbite, était codé dans le logiciel, le pilotage automatique en route, les accroches désarrimées. En un geste, nous pouvions nous évader et chercher refuge auprès de la un de Hind-courte-sur-pattes ou la quatre de Kanom. Procédure à n’exécuter qu’en cas d’échec du reste, hors de question de brûler de l’ergol en vain. Sans parler de la complexité d’un abordage à cette vitesse dans le vide, un vrai tour de force.
Papa ne disait toujours rien, se connectait à l’ordinateur de bord et se penchait sur le plan de l’astromobile en panne qu’il était des- cendu réparer deux jours plus tôt. Puisqu’il travaillait pendant l’alerte, je ne craignais rien, hélas.
Toute cette agitation gaspillait mon temps.
Pire : si les dix stations traversaient le champ de météorites, les neuf autres fillettes se terraient comme moi dans leur navette, entre les paquets et les combinaisons. Nous respections toutes les mêmes procédures, ensemble, unies, limailles de fer attirées par un aimant identique. Je nous imaginais pelotonnées dans le noir contre un parent, attendant sans crainte la suite. Cette pensée m’a réconfortée et mes paupières ont commencé à se fermer malgré moi. Le rêve d’exploration patientait, tout près. Quelque chose manquait pourtant à ma tranquillité, sans que je devine quoi. Et soudain, j’ai su.
— Tu as vu Lélio ? demandai-je à papa qui a haussé les épaules en souriant, sans répondre, les yeux fixés sur l’ordinateur de bord. La nuit, quand je dormais, mon petit écureuil bleu, qui n’avait jamais sommeil, partait batifoler dans la station, surtout au milieu des câbles. Son jeu favori : s’agripper avec sa queue préhensile et se balancer de l’un à l’autre. La journée, il ne me quittait jamais. Sa fourrure dans mon cou, je la voulais. Les dents de papa bril- lèrent vert dans la pénombre à la lumière de l’écran. La pluie me donnerait tout juste une raison d’alourdir mes cernes et de rater le contrôle.
Papa me secoua.
Combien de temps avais-je dormi ? La sirène s’était tue. Par la porte ouverte de la navette, le visage foncé de maman se penchait, auréolé de ses cheveux blonds. Elle a frotté sa joue gauche contre mon casque, puis la droite, notre petit signe affectueux.
Hugues Charybde le 13/02/2023
Claire Garand - Padeia - éditions La Volte
l’acheter ici