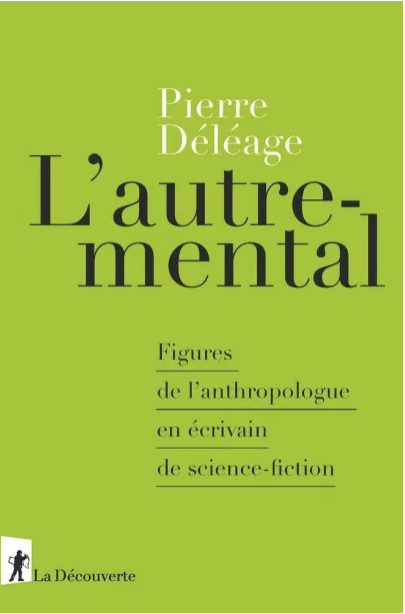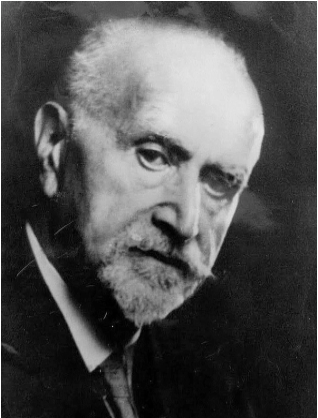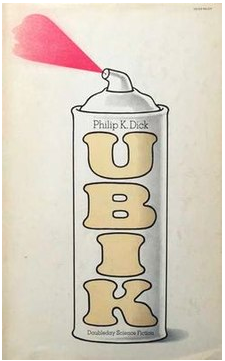Anthropologie dickienne de haut vol
Le somptueux entrechoc du détour science-fictif de Philip K. Dick avec le détour fictionnel de quatre anthropologues dévoyés.
Les Enxet du Chaco paraguayen confondent le rêve et la réalité. Les Hopi d’Arizona considèrent le temps et l’espace comme des concepts relatifs, si bien qu’un enfant de cinq ans trouve les spéculations d’Einstein tout simplement élémentaires. Les Yaqui du Mexique vivent dans un monde magique où l’on peut exister dans deux lieux à la fois. Les jaguars d’Amazonie se voient eux-mêmes comme des humains et pensent que les Amérindiens sont des cochons sauvages.
On dit des anthropologues qu’ils sont par vocation des spécialistes du relativisme. Étudiant les langues, les mythes, les rituels de sociétés au mode de vie le plus éloigné possible du leur, ils sont souvent à la recherche d’une forme de pensée inconnue, véritablement autre, à la fois étrange et saisissante. Il arrive que certains d’entre eux fassent un pas de plus. Plutôt que de décrire les modes de pensée des sociétés qu’ils se proposent d’étudier, ils décident alors de les inventer.
Tel est le cas d’une lignée d’anthropologues, marginale dans la tradition académique, qui rythme le XXe siècle avec une singulière régularité. 1900-1925 : le philosophe Lucien Lévy-Bruhl, en marge de la sociologie française naissante, invente une pensée prélogique qu’il attribue aux sociétés dites primitives. 1925-1950 : l’ingénieur Benjamin Lee Whorf, en marge de l’école culturaliste, invente une pensée de l’événement qu’il considère comme immanente à la langue des Hopi. 1950-1975 : le futur gourou Carlos Castaneda, en marge du constructivisme californien, invente une pensée psychédélique qu’il prête à un Yaqui imaginaire. 1975-2000 : l’ethnologue Eduardo Viveiros de Castro, en marge du structuralisme orthodoxe, invente une pensée multinaturaliste qu’il prétend dérivée des traditions amérindiennes.
Écrivain dont l’œuvre a atteint un des sommets de la littérature du XXe siècle, Philip K. Dick n’a cessé d’élaborer des dispositifs où non seulement un mode de pensée délirant se substituait à un mode de pensée ordinaire, mais où ces modes de pensée transitaient, par l’effet d’une commutation ou d’un escamotage, d’un personnage à un autre, d’une subjectivité à une autre, d’une réalité à une autre. Ses romans et nouvelles de science-fiction concernent au premier chef les anthropologues en quête de pensée autre, en particulier ceux qui ne furent pas très regardants quant à la réalité des sociétés qu’ils décrivirent. Philip K. Dick savait en effet très bien que la distinction entre réalités était facile à estomper en littérature et il fit de ce brouillage ontologique la principale cheville de son outillage créatif.
Ce procédé éclaire, on le constatera avec surprise, celui mis en œuvre par la lignée intellectuelle retracée dans les pages qui suivent. Ces anthropologues, à la recherche d’un « autre-mental » seraient au fond des écrivains de science-fiction, probablement davantage fascinés par la fiction que par la science. Ils ont projeté sur la réalité ethnographique de sociétés dites exotiques des formes de pensée dérivées pour l’essentiel de leur imaginaire spéculatif et de problèmes propres à leur milieu intellectuel d’origine. Comme les écrivains de science-fiction, ils ont rejeté les projets réalistes et naturalistes pour imaginer des mondes et des modes de pensée stupéfiants et vertibineux. À la différence des écrivains, ces anthropologues n’ont jamais vraiment assumé le caractère fictionnel de leurs travaux.
Ce livre s’empare donc des ressorts métaphysiques constitutifs de l’oeuvre de Philip K. Dick pour les faire résonner, au moyen d’un montage parallèle, avec les fabulations théoriques de Lucien Lévy-Bruhl, Benjamin Lee Whorf, Carlos Castaneda et Eduardo Viveiros de Castro. L’objectif de cet agencement croisé est triple : donner à voir clairement et simplement l’équivalence, au cœur d’une lignée intellectuelle propre au XXe siècle, entre anthropologie et science-fiction ; faire ressentir, par un réseau très dense d’associations et de correspondances alternées, la consistance de la sensibilité théorique constitutive de cette lignée ; retracer une trajectoire intellectuelle, autobiographie parfois cryptique qui s’élucide peu à peu au fil du texte et finit en s’affranchissant des impasses bâties par une école de pensée informelle qui a pratiqué l’anthropologie comme on écrit de la science-fiction.
En 2017 déjà, l’anthropologue Pierre Déléage, spécialiste au CNRS des langages chamaniques d’Amazonie et des fonctions secrètes ou heuristiques de l’écriture, nous avait intrigués puis abasourdis en se penchant sur une figure historique déjà « trop belle pour être vraie », celle du prêtre Émile Petitot, figure improbable et pourtant décisive à plus d’un titre du grand Nord canadien (« La folie Arctique »). Avec ce « L’autre-mental », joliment sous-titré « Figures de l’anthropologue en écrivain de science-fiction », publié à La Découverte en juin 2020, il nous offre une plongée plus profonde encore dans les coeurs respectifs de deux détours parmi les plus puissants qui soient, le détour anthropologique (explicité jadis notamment par Georges Balandier dans son ouvrage au titre particulièrement clair, « Le détour », en 1985 – et rappelé régulièrement par exemple par Philippe Descola, comme dans son « Une écologie des relations » de 2019) et le détour science-fictif (dont, par des angles différents, nous entretiennent si brillamment le Fredric Jameson de « Penser avec la science-fiction » et l’Ariel Kyrou de « Dans les imaginaires du futur »), en jouant avec une grande habileté et beaucoup de finesse à les entrechoquer, utilisant en guise de silex productifs et générateurs d’étincelles les quatre figures-limites, dévoyées, de l’anthropologie que furent tour à tour Lucien Lévy-Bruhl, Benjamin Lee Whorf, Carlos Castaneda et Eduardo Viveiros de Castro, d’une part, et le séminal Philip K. Dick, avec ses réalités déviantes et ses mises en fiction enchâssées par excellence, d’autre part. Et parvenir à conduire ainsi une véritable investigation tout en jouant d’un sens du vertige philosophique et de la mise en abîme technique que n’aurait certainement pas reniés le Pierre Bayard de, mettons, « Le Plagiat par anticipation », n’est pas le moindre des mérites de cet ouvrage particulièrement stimulant.
Ce bref inventaire des commutateurs dickiens, dispositifs dichotomiques rendant possible un passage rapide, simple et efficace d’une réalité à une autre, doit être complété par une prise en compte – nécessairement réflexive – des livres. Car tout autant que les dispositifs de production d’images (projetées ou hallucinées) et bien plus que les enregistreurs de paroles (la chambre de ralentissement est un exemple unique), ce sont les mots écrits qui permettent selon Dick de transiter d’une réalité à une autre, expérience somme toute ordinaire pour tout lecteur de fiction. Ainsi, dans Le Temps désarticulé (1959), le premier indice – peu cohérent – qui conduira Ragle Gumm à douter de la réalité de son monde quotidien est un bout de papier où est écrit le mot « buvette », bout de papier qui vient étrangement remplacer la buvette habituelle où se rend le héros. De même, pour tenter d’entrer en contact avec une autre réalité – celle des morts qui se croient vivants -, Glen Runciter, dans Ubik, rédige des messages sur des morceaux de papier, avec des caractères de céréales alphabétiques, ou sous forme de graffitis dans les toilettes et sur le décor des publicités de la télévision. Dans le premier cas, le réel se réduit soudain à sa représentation scripturale ; dans le second, l’écriture, seule médiation possible entre deux mondes scindés, apparaît telle une révélation transcendante dans un réel illusoire.
Mais c’est le livre intitulé Le Poids de la sauterelle, dans Le Maître du Haut-Château, qui pousse le plus loin le principe du livre comme commutateur, comme transition réflexive entre deux réalités alternatives. Le Maître du Haut-Château se déroule dans un monde uchronique où Japonais et Allemands ont gagné la Seconde guerre mondiale tandis que Le Poids de la sauterelle décrit un monde – subtilement uchronique lui aussi – où ce sont les Américains et les Chinois qui l’ont gagnée. Les personnages du roman ont ainsi accès à une réalité parallèle, à un autre continuum temporel, à travers un livre jouant le rôle de commutateur.
D’autres livres apparaissent dans les univers dickiens, mais ils s’éloignent du principe de la commutation en englobant la totalité des réalités parallèles. Ainsi, dans Mensonges & Cie, la dix-septième édition d’un livre intitulé La Véritable et Complète Histoire économique et politique de la Nouvelle-Colonie est réputée contenir tous les paramondes possibles, dans la multiplicité infinie de leurs variantes. Dans Nick et le Glimmung (1966), l’ouvrage Une journée d’été est décrit comme le « livre-du-monde », puis comme « le livre qui change à chaque fois qu’on le lit », à l’image, peut-être, du Yi-King que Dick considérait, en suivant Jung, comme une machine permettant de maîtriser et d’ordonner les synchronicités, les connexions acausales entre les événements. Enfin, dans Le Guérisseur de cathédrales (1968), il est sans cesse question d’un « livre étrange, à l’existence problématique, dans lequel la légende veut que trouve à s’inscrire tout ce qui a été, est et sera ». Autant d’anti-livres donc, recelant des cosmologies foisonnantes sous des titres ordinaires à l’infini. Ces livres, vecteurs de savoir absolu, remplaçaient ainsi drogues et machines pour combiner des multitudes de mondes immatériels, imaginaires ou non, qui venaient se substituer au référentiel unique de la réalité. Peut-être fallait-il voir en eux une encyclopédie grotesque et saugrenue dont l’objet était une noosphère décentrée et feuilletée, entreprise que Dick voulut recentrer et réordonner à la fin de sa vie, dans son Exégèse.
Hugues Charybde le 28/06/2021
Pierre Déléage - L'Autre-mental - Figures de l'anthropologue en écrivain de science-fiction - éditions de la Découverte
l’acheter ici