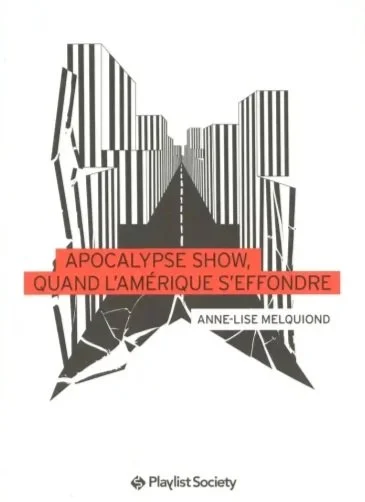Apocalypse Show, les séries avec leur dystopies négatives, un genre très actuel
Un magnifique passage en revue de l’imaginaire des séries américaines apocalyptiques contemporaines, et de ce qu’il pourrait signifier ou non.
Ça commence par un très gros plan sur un œil ouvert. Le zoom arrière permet d’identifier un, puis deux morts-vivants. Des grognements zombiesques accompagnent ce travelling optique. C’est le même mouvement de caméra que la fin de séquence de Psychose où le tourbillon de l’eau dans la bonde de douche raccordait avec l’œil de Marion. Dans le film d’Hitchcock, cet œil ouvert dévoilait le crime de Norman Bates ; dans la série d’AMC, ce gros plan montre un renversement métaphysique du point de vue : la mort est en vie. L’humanité se transforme désormais au contact des zombies qui peupleront indéfiniment ce monde. La jeune Enid l’exprimera simplement : « C’est leur monde. On ne fait qu’y vivre. » Ainsi débute la troisième saison de la série The Walking Dead.
La porte s’ouvre brutalement et les deux zombies se font tuer par Rick Grimes, ex-shérif et personnage principal de la série, son fils Carl et deux éclaireurs. Ils inspectent méticuleusement la maison à la recherche d’autres rôdeurs. L’endroit sécurisé, Carl part en quête de nourriture. Le reste du groupe s’installe en cercle à même le sol du salon. Chacun est exténué, abattu. De gros plans scrutent leurs visages fatigués, les regards baissés, silencieux. Le jeune Carl a trouvé des boîtes de nourriture pour chat. Alors qu’il en ouvre une, Rick, qui guettait à la fenêtre, s’approche, prend la conserve et la jette. Sans qu’une parole ne soit prononcée, il refuse que son fils, sa femme enceinte et toute sa bande d’amis mangent cette nourriture dégradante, signe d’une humanité en péril. Un membre du groupe qui monte la garde émet un léger sifflement en désignant la fenêtre : des zombies arrivent. Sans un mot, résigné, le groupe se lève. Chacun ramasse ses affaires et se dirige vers les voitures. Ils ont l’air de savoir ce qu’ils doivent faire, personne n’est pris au dépourvu. L’habitude. Le cortège démarre en trombe alors qu’une masse de zombies envahit la maison. Le générique commence alors, laissant le spectateur sidéré par l’âpreté de cette survie.
En mai 2019, Manouk Borzakian nous avait offert sa superbe « Géographie zombie », sous-titrée fort logiquement « Les ruines du capitalisme ». Chez le même éditeur, Playlist Society, Anne-Lise Melquiond nous propose en septembre 2021 une fascinante vulgarisation de sa thèse de doctorat, « Apocalypse et fin du monde dans les séries télévisées américaines », soutenue à l’Université Paris Nanterre en octobre 2019, sous le titre « Apocalypse show, quand l’Amérique s’effondre », pour tenter de rendre compte d’un phénomène englobant le premier, celui de la prolifération des séries télévisées mettant en scène, en tout ou en partie, des effondrements apocalyptiques et leurs différentes conséquences spéculées. Si l’autrice fait d’emblée la part belle, en effet, à l’emblématique « The Walking Dead » (2010-2021) de Frank Darabont et Robert Kirkman, elle élargit très vite son propos pour viser une revue d’ensemble qui intègre de façon très importante « The 100 » (Jason Rothenberg, 2014-2020), « The Leftovers » (Damon Lindelof et Tom Perrotta, 2014-2017)) et « Revolution » (Eric Kripke, 2012-2014), et de manière moins omniprésente plus d’une cinquantaine de séries parmi lesquelles se distinguent néanmoins « 12 Monkeys » (Terry Matalas et Travis Fickett, 2015-2018), « Jericho » (Stephen Chbosky et Jon Turteltaub, 2006-2008), ou encore « Battlestar Galactica » (Ronald D. Moore, 2003-2009), voire, de manière sans doute plus anecdotique, « Lost in Space » (Matt Sazama et Burk Sharpless, 2018-), « Snowpiercer »(Josh Friedman et Graeme Manson, 2020-), « Colony » (Ryan J. Condal et Carlton Cuse, 2016-2018) ou bien « Zoo » (André Nemec, Jeff Pinkner et Josh Appelbaum, 2015-2017). Fort rares sont les séries qui échappent à cet impressionnant travail de mise en corpus, travail indispensable et pourtant encore négligé par trop d’essayistes de pop culture : on signalera toutefois, uniquement pour mémoire, l’absence de quelques séries interrompues en cours de route comme « Terra Nova » (Kelly Marcel et Craig Silverstein, 2011) ou « The Lottery » (Timothy J. Sexton, 2014), dont l’absence demeure anecdotique.
Ce plan dans The 100 avec la statue de Lincoln recouverte de végétation convoque le final de La Planète des singes de Franklin Schaffner (1968), mais aussi la version de Tim Burton (2001), quand le héros retourne à son époque et découvre une statue simiesque du général Thade en lieu et place du Lincoln Memorial. Dans The 100, ce monument n’est pas seulement un indice géographique : il a pour fonction de nous montrer comment la nature a repris ses droits, quatre-vingt-dix-sept ans après les attaques nucléaires qu’a subies le Terre. Octavia ignore jusqu’à l’existence de cette statue, contrairement au capitaine George Taylor de La Planète des singes de 1968, qui, lui, comprend à travers la statue de la Liberté à moitié enfouie dans le sable où il est, et surtout quand il est. Ce qui émerge d’une plage est le seul vestige de la ville de New York, probablement disparue depuis longtemps, qui révèle à Taylor que le monde hostile peuplé de singes qu’il croyait avoir découvert avec ses compagnons n’est pas une autre planète, mais seulement la Terre, sa terre d’origine, bouleversée par un cataclysme passé. Dans le monument désormais déchu, personnage et spectateurs ne lisent pas seulement un lieu, mais un temps : autrefois.
Le voyage dans l’espace comme voyage dans le temps : voilà ce à quoi invitent les paysages apocalyptiques, lieux hors des lieux, lieux hors du temps, lieux après le temps.
Comme quasiment toujours pour les essais de vulgarisation (très) intelligente mais (parfaitement) accessible de l’éditeur Playlist Society, le travail d’Anne-Lise Melquiond proposé ici est remarquable, et captivant de bout en bout. Tout au plus regrettera-t-on, sur un mode réellement mineur, qu’il ne soit pas établi de distinction notable entre les séries originales, créées pour la télévision ou le streaming, et celles issues de romans ou de comics auxquels elles restent fidèles (ce en quoi la genèse de leur imaginaire pourrait être différente), et sur mode légèrement moins mineur, qu’il soit discrètement adressé un procès en millénarisme ou en complaisance apocalyptique aux idéologies révolutionnaires (voire post-marxistes) d’une part, et qu’il ne soit pas creusé davantage (au-delà de plusieurs mentions logiques) d’autre part (comme cela avait été clair, chez le même éditeur, dans le volume consacré à Paul Verhoeven, et donc notamment à son « Starship Troopers ») le contenu (à la fois évident mais demandant une véritable évaluation) de proto-fascisme et de fascisme tout court inhérent – avec ou sans pastiche ou parodie – aux fictions de survie et de guerre à outrance contre un « ennemi ». Deux remarques mineures qui n’enlèvent pas grand-chose à la belle qualité de ces 150 pages intenses et nécessaires.
De l’apocalypse naît la figure du combattant : le monde d’après l’apocalypse ne peut s’envisager sans violence ni guerre. Du droit naturel et ancestral de se préserver, les sociétés se sont ensuite construites entre deux modèles dont l’un, très anglo-saxon, fondateur pour les États-Unis d’Amérique, pense la défense de la nation comme une extension du droit naturel de chaque personne à se défendre.
« On se bat ou on mourra », dit Clarke à Bellamy dans The 100. Le monde post-apocalyptique est un retour à l’état de nature théorisé par Hobbes. Il faut combattre pour survivre. Parfois, comme dans Battlestar Galactica ou Falling Skies, le combat est réservé exclusivement aux militaires, les civils étant perçus comme des parasites. Les autres fictions poussent à ce que chacun prenne part à la guerre. La rupture apocalyptique rend vitale la maîtrise du maniement des armes. Se défendre, c’est également défendre sa terre.
Hugues Charybde le 20/12/2021
Anne-Lise Melquiond - Apocalypse show, quand l'Amérique s'effondre - éditions Playlist
l’acheter ici