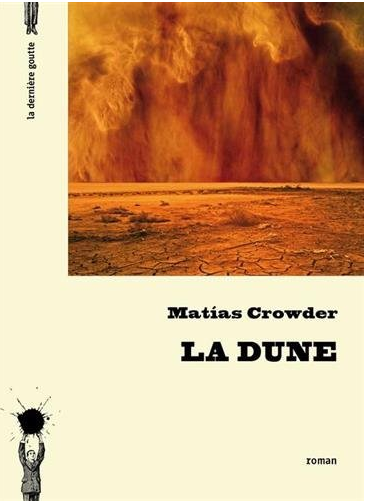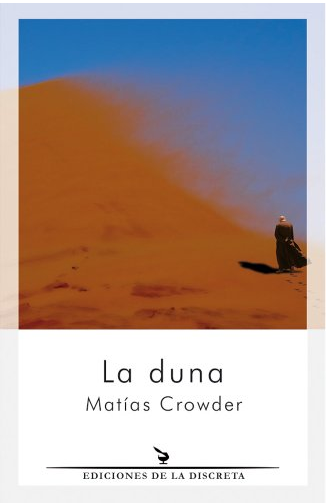Une fosse bonne nouvelle : “la Dune” de Matias Crowder
Une fable énigmatique, aux frontières du fantastique, pour extirper les racines d’une mythologie argentine de la Frontière, et son contenu génocidaire mal masqué.
Ceferino se remémore son rêve de la nuit dernière. Il voit son père, le cacique Namuncurá, à la tête de tout le village, cent capitaines, mille soldats et la foule derrière eux. Ils chevauchent au grand galop vers le butin qu’ils vont rafler et les cadavres qu’ils vont semer, lances dressées, poitrails dénudés, la gorge prête à pousser un cri. Lorsque Ceferino touche la terre, elle pulse comme un cœur qui s’emballe. Il assiste au massacre, voit les lances transpercer les hommes, les femmes et les enfants. Les montures des quelques cavaliers qui ont eu le temps de combattre agonisent le souffle court, étendues dans les champs. Il voit qu’on tranche la gorge à ceux qui capitulent sans lutter. Les capitaines se partagent les Blanches, ils leur entaillent la plante des pieds et les possèdent au cours des siestes brûlantes de janvier, au son de leurs cris et de leurs suppliques, tout comme son père, le cacique, possède sa mère, la prisonnière Evelinda Romero, et la féconde jusqu’à ce qu’elle engendre une douzaine d’enfants. Ceferino éprouve tant de compassion pour les morts et les assassins qu’il lui est impossible de respirer. Il a une seconde vision. Le regard enfiévré, leurs sabres au clair formant un lit de clous et brillant sous le ciel meurtrier de la pampa, les huincas, ces officiers qui faisaient des affaires avec son père, mettent à sac un campement de tentes indigènes. Les bergers aux ordres des propriétaires terriens poursuivent et attrapent les Indiens, les femmes et les enfants comme s’il s’agissait de veaux et, après les avoir jetés au sol, ils leur coupent les oreilles pour s’en faire des trophées, plusieurs paires décorant un même poignard…
Ce sont des histoires de son village. Elles datent d’avant que le Blanc ne remporte la guerre et ne s’empare de tout. Ceferino sent toute la souffrance du monde couler dans ses veines ; la culpabilité croît, guette en silence, gonflée, desséchée. Il voit la terre sur laquelle il a grandi se changer en cendre, devenir brûlure et destruction. Il voit une dune, sa montagne de sable errant dans les champs cultivés par la main de l’homme blanc. La dune brille sous un soleil incendiaire. On dirait un énorme coquillage vide et sans ombre, que l’on ne peut jamais voir que de face. Comme un oiseau, le regard de Ceferino prend son envol.
Jeune prêtre argentin, métis de mapuche et de blanche, Ceferino Namuncurá, alors qu’il se débat à Rome dans les affres finales de la tuberculose, fait un rêve étrange, qu’il confie in extremis à son supérieur, le cardinal Luigi Macheratti, avant de s’éteindre. De l’autre côté du monde, dans sa Patagonie natale, une gigantesque dune de sable y engloutissait, ferme après ferme, les terres agricoles de la petite ville de Trenque Lauquen, en chassant peu à peu les habitants, ainsi ruinés, et renvoyés, de leur condition chèrement gagnée de petits propriétaires, à celle d’employés salariés, taillables et corvéables presque à merci, dans cette Argentine de 1905. Lorsque, juste après le décès de l’Argentin, le cardinal romain exhume la lettre suppliante d’un prêtre de l’ordre des Carmes, à Trenque Lauquen précisément, qui racontait, quinze ans plus tôt, que – aussi incompréhensible que cela puisse être de prime abord – la dune rêvée était alors réellement en train d’engloutir les terres des petits propriétaires locaux, qui avaient tous été, il faut le signaler, d’efficaces soldats et supplétifs lors de la Conquête du Désert, conçue et menée entre 1870 et 1890 par les ex-colons espagnols, indépendants depuis 1816, pour arracher la Patagonie à ses occupants historiques, les indiens Mapuches… Fantasme, hystérie collective face à un phénomène naturel difficilement explicable, ou vengeance surnaturelle rencontrant un diffus sentiment de culpabilité ?
D’une surface d’un demi-kilomètre carré, la dune au linceul blanchâtre s’éveille au-dessus des champs des Ortiz Valleja, couverte de reflets verts dus au premier soleil matinal, une mer de ruines, d’exil et de faim. Quand Ricardo Ortiz Valleja sent ce vent sec et chargé de sable frapper son visage, et qu’il a dans la bouche un goût amer, saumâtre, il comprend que tout est perdu. Cette maudite dune a ruiné les Concilio Torres, les Herrera Martínez, les Jiménez et les Gómez Ultranza, progressant champ après champ comme un cancer et portée par le pampero. Il n’est rien qu’on puisse faire pour s’y opposer, seulement prier pour qu’elle passe au large.
– Maudite soit-elle ! s’exclame Ortiz Valleja. Nous sommes ruinés.
La dune brûle la terre sur laquelle elle se pose, elle empêche toute culture de se développer, même le fourrage qui sert à nourrir le bétail. Quand elle se retire enfin, aussi mystérieusement qu’elle est arrivée, s’évanouissant dans la pénombre tel un Indien dans la nuit, tout est réduit en cendre. Ricardo Ortiz Valleja en prend une poignée qu’il lance au vent, maudissant de nouveau le sort.
– Saleté de dune de merde !
La rumeur circule dans tout le village, et bientôt tous ne parlent plus que des vieilles légendes de la Campagne du Désert. Deux jours plus tard, le bourg de Trenque Lauquen assiste au départ du chariot des Valleja, quatre vaches faméliques, deux bœufs, quatre chiens et les sept fils de la famille, une procession funèbre qui avance vers le destin de déracinement, de faim et de rudes travaux promis à ceux qui seront dès lors des péones, non plus des propriétaires, après des années de lutte pour obtenir un peu de terre. D’abord la Campagne du Désert, dans laquelle ils ont jeté toutes leurs forces en échange d’une parcelle. Puis, à Buenos Aires, le combat contre les politiciens de la capitale et les caudillos de la Campagne, afin de récolter les fruits de la guerre, sous l’aile protectrice d’anciens officiers de l’armée, qu’ils soient d’un parti ou de l’autre. Et, pour finir, obtenir des hommes de Juárez Celman qu’ils leur attribuent ces lots aux confins du monde…
Les familles qui les regardent passer, les hirondelles qui jouent aux osselets sur le seuil de la pulpería, le soldat de garde à l’entrée du fort, les jeunes femmes qui lavent les vêtements dans les eaux de la lagune (ou de ce qu’il en reste), pieds nus et leurs jupes retroussées, les gauchos en fuite qui rentrent solitaires et à cheval de leurs champs, tous ont peur de ce qu’ils deviendront. La tragédie emplit l’air d’une tension qui pèse sur les foulards triangulaires que les hommes portent sur les épaules et sur les cols boutonnés des femmes.
C’est ma collègue et amie Marianne, avec sa superbe note de lecture sur ce même blog (ici), qui m’avait donné envie de lire ce roman de l’Argentin Matías Crowder, publié en 2013 et traduit en 2016 par Vincent Raynaud aux éditions La dernière goutte. Cette curieuse fable d’à peine 100 pages, conduite en une habile écriture d’époque, recourant joliment à un fantastique ne disant pas son nom, condense avec un extrême brio l’histoire sombre d’un épisode argentin des guerres indiennes et des génocides qui furent, ici aussi, la marque de fabrique de la colonisation occidentale. Les imaginaires sanglants qui hantent les textes d’Elsa Osorio, de Raúl Argemí ou même de Caryl Férey, amplifiés sous l’effroyable dictature militaire argentine des années 1976-1983, rencontrent ici leurs racines méticuleusement souterraines, l’espace d’un retour cruel et pourtant conduit sans emphase sur une série de crimes fondateurs – crimes orchestrés comme il se doit par de grands propriétaires excitant sans vergogne leur « petit peuple » à devenir à son tour propriétaire en spoliant des humains réputés « inférieurs », horizon d’échappée permettant comme toujours historiquement de mieux accepter le rapport de force existant -, retour effectué sous les traits vengeurs d’une création de silice qui résonnne nettement avec celle de la Claire Vaye Watkins de l’excellent « Les sables de l’Amargosa » (2015), métaphore à son tour engloutissante d’un autre genre de crime contre l’humanité.
Matias Crowder - La Dune - éditions La Dernière goutte
Hugues Charybde le 25/01/2021
l’acheter ici
Matias Crowder