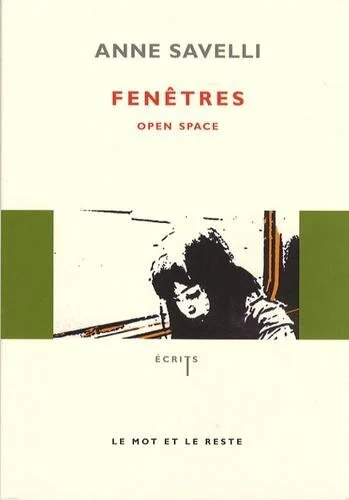Dérive aéro-métropolitaine avec Anne Savelli
Au long d’un parcours aérien entre cinq stations de métro parisiennes, la poésie intime et politique de ce qui se dévoile dans les espaces entrevus et imaginés derrière les vitres.
Le seul endroit où l’on était chez soi finalement, c’était là, dans le balancement, d’un côté du wagon ou de l’autre, entre Colonel Fabien et Courcelles. Le seul moment de la journée où l’on pouvait lire c’était sur la banquette, à côté de la vitre, durant les vingt minutes que durait le trajet. Alors, écrire… Décider de faire la part en se calant sur le métro lui-même, écrire tant qu’il est aérien, dans la descente ouvrir son livre.
Dix minutes que la saleté de la vitre et la clarté du ciel solidifient : tant mieux. S’y recroqueviller dans ces recoins où la rue n’a plus prise. On n’a plus devant soi ni genoux ni visages ; fenêtres, bow-window, open space, des noms viennent entre les deux langues, sans raison, qu’il faut laisser filer ; aux balcons s’entasse ce que les autres veulent montrer, ce qui gêne. Briques, vélos, une femme apparaît en maillot ; ailleurs on préfère les lignes de fuite, le miroitement, l’espace perdu.
Anne Savelli dispose d’un talent rare, celui de savoir s’emparer d’un lieu, fût-il à géographie mouvante. S’en emparer non pas pour l’épuiser, mais pour le définir – au sens mathématique et philosophique du terme, en compréhension et en extension, sens qui devient ainsi poétique et politique. Quadriller un espace en des déplacements où le hasard et la nécessité s’entrechoquent, où l’intention et la survenance se heurtent, où la conception et le détournement rivalisent ou s’associent, le cas échéant : c’était bien une part fondamentale du programme si brillamment mis en oeuvre dans « Décor Lafayette » (2013), « Décor Daguerre » (2017) ou « Saint-Germain-en-Laye » (2019), par exemple. À l’origine de cette dérive puissamment organisée et superbement récurrente, on trouve toutefois un tronçon de ligne de métro parisienne, la portion aérienne de la ligne 2, entre les stations Colonel-Fabien et Barbès-Rochechouart, parcourue dans les deux sens, très concrètement le plus souvent ou plus métaphoriquement parfois, durant trente-cinq semaines, pour donner lieu in fine à l’écriture et à la publication de « Fenêtres », sous-titré « Open space », chez Le mot et le reste en 2007.
TROISIÈME SEMAINE – DES ODEURS
Lundi – Une de ces fenêtres donnant sur les voies de la gare du Nord, là où les immeubles se serrent, se ressemblent et manquent de tomber brisés sur les rails. Leurs habitants, des plongeurs en apnée dans le tremblement, forcés d’aimer ou de haïr les trains dès la naissance. Quels rêves s’y fabriquent, où sont leurs chambres ?
Lundi bis – Fenêtre incrustée dans la pierre, rurale, de gagne, fenêtre de Monte Cristo donnant à son tour sur la gare face aux immeubles cloués plus haut.
Mardi – De la voiture, 8 mai oblige, mais le trajet est le même. Une femme de profil se penche pour boucler sa valise dans une pièce sombre du premier étage. Souvenirs assourdis de Béziers, rideaux, voilages, voitures faisant vibrer les vitres.
Mercredi – Un monde fou ce matin. Quelle fenêtre va apparaître au-delà des visages, des métros que l’on croise ? Une ligne pure, aquatique puis un panier d’osier, le reflet file et je ne retiens rien. Une voisine du haut de l’œil me scrute. Fesse à demi sur le siège, vite, la gare.
Jeudi – Trouver une fenêtre transversale alors que l’air sent le savon, le muguet. Un vitrail noir domine l’eau placide du canal, une église du 10e jamais vue sous cet angle.
Vendredi – Comme le narrateur de la Recherche, courir des deux côtés du train sans pouvoir choisir. C’est le premier très beau jour de l’année et les Orgues se volatilisent sous les arbres. Même les immeubles de Stalingrad ont des accents romains. Les gares se joignent dans un seul mouvement du rail.
Affiché au mur chez moi, un tirage grand format du fabuleux « Prestes Maia » de Julio Bittencourt, photographe brésilien dont le projet « In a Window » (2007) juxtaposait progressivement plusieurs centaines de clichés de fenêtres, ouvertes ou fermées, révélant ou masquant les intérieurs de quartiers populaires et de favelas à Rio de Janeiro, m’a accompagné, tous les jours ou presque, pendant environ dix ans. C’est donc avec une franche et intense curiosité que j’attendais la naissance des résonances au parcours de ces « Fenêtres »-là, au long des rails et des boulevards, égrenant les stations, souterraines le cas échéant, mais néanmoins toujours perchées, de Colonel-Fabien, de Jaurès, de Stalingrad, de La Chapelle et de Barbès-Rochechouart.
Mardi – Un ciel blanc de chaleur, déjà, des jointures que l’on serre. Dans le virage qui mène à Stalingrad un store enrouleur me fait de l’œil (c’est possible). Je prends ce vélo suspendu au balcon du cinquième et hop, à la mer. J’emporte la gare et les rails au cas où et cette cheminée de nickel. La superposition des façades opposées dans un reflet de vitre est encore balnéaire.
(…)
Lundi – Les petits voyageurs regardent là où les plus grands expirent. Leur œil furieux rétablit la netteté du monde et ignore la buée que la bouche fabrique. Jour d’été, de lessive.
(…)
Mardi – Les terrains vagues sont couverts de glycine, le rideau de photos, ou carrés de papiers, flotte toujours sur son fil et la rue de Tanger promène déjà – il doit être neuf heures – sa traîne de reine du crack. Quelle fenêtre possède encore la grâce ? Qui peut lutter contre un jardin ? Mon oeil est sec et mon oreille pleine à raz bord de marteaux-piqueurs, de couinements. Le corps gêne dans le métro, il a trop de coudes et d’orteils.
Observer, voir ce qui transparaît, et conter sans compter : exercice en apparence tout de patience et de réitération, qui devient peu à peu magique avec Anne Savelli. Les silhouettes entrevues fugitivement un jour pourraient être déjà embryons de récits, construits de spéculations et de suppositions. Les objets, devinés dans des pièces ou exposés sur des balcons : des témoignages improbables d’une archéologie du présent. La présence ou l’absence, la disparition ou la réapparition, la routine sous-jacente ou la surprise permanente : ce paysage urbain bien particulier qui défile en se défilant regorge de défis intellectuels et poétiques, nous rappelant ainsi à chaque avancée de la rame le constat de l’infra-ordinaire, banal qui ne saurait être banal. Comme la fenêtre sur cour hitchockienne qui vient se rappeler au souvenir de l’autrice à la page 31, chaque ouverture est celle d’un scénario – tandis que chaque fermeture est celle d’un indice à la Carlo Ginzburg, souvent social et déjà politique. Un flux incessant est à saisir derrière ces vitres, matérielles ou immatérielles, et c’est dans la traque des mots pour le saisir que s’affirme déjà alors la belle poésie d’Anne Savelli.
Samedi soir – Métro La Chapelle, sur le quai. Expérience inédite, je sors du cinéma et me retrouve de nuit sur ma ligne de jour. À travers la verrière, en attendant la rame qui ne vient pas, je surprends les pièces éclairées dont je ne distingue rien le matin. Salon chatoyant, jouets, rideau jaune. Tentures au mur, ficus, tableaux. À ma gauche, la pointe illuminée du Sacré-Cœur. Devant moi, les arbres aux dents jaunes flashés par les spots. Nous attendons toujours. Et que suis-je allée voir pour la quatrième fois, délaissant les films de la rentrée qui pourtant me tentaient ? Fenêtre sur cour, sans blague, c’est maintenant que le lien se fait.
Anne Savelli - Fenêtres- Open space - éditions Le mot et le reste
Hugues Charybde le 28/04/2020
l’acheter chez Charybde ici
Anne Savelli