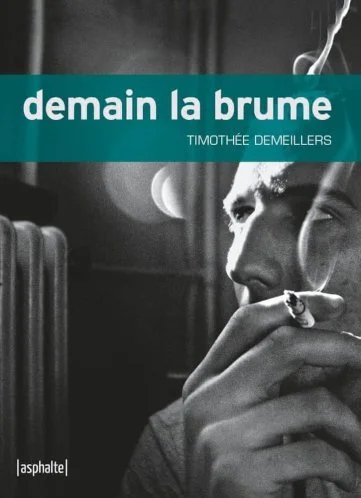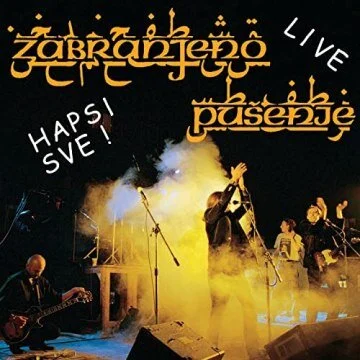Une pathologie nationaliste des 90's signée Timothée Demeillers
Entre Nevers et Paris, entre Vukovar et Zagreb, cinq jeunes figures pour saisir la forme mouvante d’une pathologie nationaliste et identitaire européenne, à l’orée des années 1990.
Les manifestants ont fini par se disperser et le brouillard par se lever. Une demi-lune d’une pâleur laiteuse éclairait la nuit tombée. Pierre-Yves est resté à nos côtés. Il nous a accompagnés dans l’un des rares cafés restés ouverts. L’endroit était bondé. Embrumé par la fumée de cigarette. Le brouhaha des conversations se brouillait dans un boucan indémêlable. Nos vêtements couverts d’autocollants colorés, nos drapeaux et banderoles à nos pieds, nous nous sommes installés à une table beaucoup trop petite pour nous tous. Nous hurlions pour nous faire entendre autour de bières et d’Orangina. Nous débattions sur les époques les plus fastes où nous aurions aimé vivre. Nous maudissions notre génération désenchantée, bien sûr, et nous idéalisions le San Francisco des années 1960, le Katmandou des années 1970, les squats londoniens des années 1980. Nous nous demandions où diable pouvait être l’épicentre frémissant de ce début des années 1990, mais nous avions beau sortir des plaisanteries à propos de Beyrouth sous les ruines, nous ne trouvions rien qui puisse être comparable aux époques passées. Nous avions l’impression que le monde avait été douché à l’eau de Javel du consumérisme et qu’il ne restait que des lieux aseptisés, vidés de toute substance, des salles d’attente rutilantes d’hôpitaux désinfectés ou, à défaut de mourir d’épidémies, l’on crevait d’ennui. Et l’on attendait de nous que l’on suive de force la marche du monde. Que l’on rentre dans les clous, que l’on fonde une famille et que l’on fasse une poignée de gosses que l’on pourrait nourrir à la même bouillie dont nous avions été gavés. Le capitalisme avait achevé ses ennemis. Le capitalisme était sorti seul vainqueur, fatigué, éreinté mais sans rivaux désormais.
C’est Pierre-Yves qui nous racontait tout ça. Toute la bande était pendue à ses lèvres. Et il nous haranguait, avec sa voix éraillée, comme s’il causait du haut de la tribune d’un syndicat ouvrier :
« La jeunesse de Nevers s’emmerde, elle attend une alternative, mais je suis sûr que notre génération va marquer l’histoire. »
1990. À Nevers, au bord de la Loire, une jeunesse française traîne son ennui, ses horizons bouchés, sa société de consommation sclérosée et ses rêves de grand départ vers un ailleurs – « encore plus loin, ailleurs ». Un ailleurs surchauffé qui pourrait prendre la forme des équipées généreuses et folles, entrant en résonance avec le « Soleil gasoil » ou le « Notre Est lointain » de Sébastien Ménard, par exemple, mais qui peut aussi rencontrer les sirènes troubles des quêtes identitaires éventuellement les plus fallacieuses – comme dans le son d’un improbable appel aux armes.
À Vukovar, à 1 500 kilomètres de là, au bord du Danube, une jeunesse qui n’est déjà plus tout à fait « yougoslave » voit son rock héroïque et contestataire être détourné au fil des mois pour servir dans le conflit qui s’annonce, conflit dans lequel le mot « séparatisme » prend un tout autre sens que celui, si frelaté, que certain gouvernement français voudrait nous refourguer en 2020. Les Croates redeviennent des Oustachis, les Serbes redeviennent des Tchetniks, les réservoirs d’atrocité se reconstituent à grande vitesse, après 45 ans d’oubli fédéraliste et socialiste, tandis que celles et ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans l’éclatement programmé se voient sommés, plutôt brutalement, de choisir leur camp.
Comment en sommes-nous arrivés là ? Quand est-ce que tout a commencé ? À quel moment de ma vie ai-je senti que les choses allaient changer ? Que les eaux saumâtres de la dissension allaient s’immiscer entre nous, comme un lac sombre et profond. Un lac sournois dans lequel nous nous sommes noyés. Comment nous, ceux qu’on nommait les Yougoslaves, ce peuple uni, fraternel a laissé notre pays se déchirer, au point où je ne le reconnais plus aujourd’hui, au point où plus rien ne ressemble à ce qui avait cours avant, avant cela, lorsqu’il y avait encore la musique, les films de partisans et Vukovar, la ville où j’ai grandi, là-bas sur le Danube. Il y avait Jimmy. Il y avait les vacances d’été et les lettres envoyées à Tito. Avant, il y avait aussi Nada, ma cousine.
Il y avait tout ça.
Et même si tout existe encore aujourd’hui, même si tout est d’une certaine manière encore là, même si ma ville natale figure encore sur les cartes, même si les films de ma jeunesse se louent toujours dans les vidéoclubs ouverts 24 heures sur 24, derrière les néons publicitaires qui clignotent dans les rues pleines de vitrines débordantes de produits colorés, même si nos cassettes reposent toujours sur les étagères de fans de la première heure et si notre tube est encore joué parfois sur quelques stations de radio nostalgiques, même si les îles de notre enfance attirent de nouveau les touristes du monde entier, à l’intérieur de nous, tout a été réduit en miettes, en brasier fumant. Tout. Absolument tout. Et je dois vivre avec ces souvenirs heureux de l’avant, qui me laissent aujourd’hui un sale goût en bouche, un goût rance et avarié, parce que je sais maintenant pour sûr que ce bonheur de l’époque, que ces souvenirs enfantins n’étaient pas la réalité, que la réalité c’est ce qui s’est produit ensuite, c’est ce à quoi tous ces souvenirs ont mené, et il n’y a plus qu’une seule vérité aujourd’hui, c’est ce cataclysme qui nous écrasés. Mon histoire est l’histoire d’une lente mais inéluctable descente aux enfers.
En ajustant adroitement ses mécaniques de la friction, puis en laissant se produire les entrechocs inévitables, Timothée Demeillers transforme ses cinq protagonistes, les deux Français, Katia et Pierre-Yves, comme les trois Yougoslaves, Damir, Jimmy et Nada, en véritables figures mythographiques contemporaines. Dans son « Jusqu’à la bête » de 2017, et son furieux voyage au bout de l’enfer individuel des abattoirs industriels, il avait saisi comme bien peu avant lui l’articulation entre une pathologie personnelle et une déliquescence environnementale collective, propre au capitalisme tardif. Avec ce « Demain la brume », publié, toujours chez Asphalte, en septembre 2020, il s’attaque à une autre pathologie dans laquelle la folie collective se traduit en dérives individuelles, éventuellement terminales. Ancrées dans plusieurs histoires vraies de l’éclatement sanglant de l’ex-Yougoslavie (et notamment dans celle du jeune volontaire français Jean-Michel Nicollier, parti combattre les Serbes en Croatie, tué lors du massacre de Vukovar ayant conclu les 87 jours de siège de la ville en 1991), les bribes de destinée des cinq protagonistes, entre les poussées d’adrénaline identitaire et nationaliste de Pierre-Yves, de Nada ou de Jimmy, et les tristes impuissances désabusées de Katia ou de Damir, tracent le portrait ambivalent d’une époque où les quêtes personnelles légitimes peuvent se fondre dans de bien troubles pulsions collectives, habilement orchestrées et tambourinées par des marchands martiaux d’armes et de rêves qui n’ont évidemment rien d’innocent, qu’ils utilisent ou non les couvertures commodes de la Nation, de la Religion, de la Race, ou autres fariboles si promptes à embraser et détruire. En approchant cette bête-là sans trembler, à hauteur de femme, d’homme et des premières victimes métaphoriques que sont l’amitié, l’amour et le rock, avant que ne le suivent des cadavres autrement concrets, Timothée Demeillers nous offre un nouvel éclat de littérature politique, charnelle et poignante, d’une belle intelligence.
Timothée Demeillers - Demain la brume - éditions Asphalte,
Hugues Charybde le 6/10/2020
l’acheter chez Charybde, ici
Timothée Demeillers