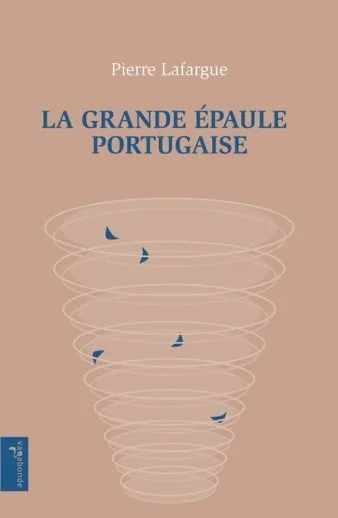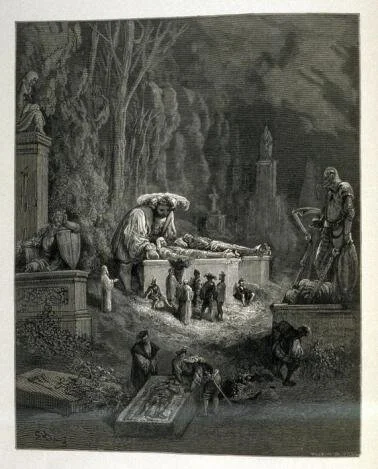Faire crépiter Atlas aujourd'hui avec Pierre Lafargue
À dos de titan et à grandes enjambées rageuses, le pas fourmillant de la littérature. Un foisonnement malicieux d’une rare beauté, ne craignant ni les machines à coudre ni les querelles picrocholines, bien au contraire – et déjà un réjouissant monument.
Ils ont été écartés. Ce n’étaient que des flûtistes. Des alarmistes. Des balnéo-botulistes. Des brouilleurs et des brouillonnistes. Des acousticistes. Des explicacitatistes. Des spécialistes. Des dentistes, il y en avait aussi. Des bruiteurs. Il n’y en a plus.
Maintenant, tout est tranquille dans la nuit. Maison sur la falaise, isolée. À part quelque insecte qui gratte le salpêtre dans ce coin de la pièce, le silence. Mais bientôt le vent va souffler en rafales sur la mer. C’est le moment de placer cette lampe-tempête devant la fenêtre. Quelqu’un, dehors, attend le signe.
Marie-Alberte arpente le monde. Géante quasiment authentique, en colère poétique et désinvolte, elle est obsédée par le château d’Ancy-le-Franc et occasionnellement par son frère aussi géant qu’elle, le beau Pharamond, dont l’existence même – le visage, surtout – lui rappelle parfois cruellement à quel point sa beauté à elle est, disons, spéciale. En compagnie de sa fidèle chouette, qui eût pu, sous d’autres cieux, être proprement athénienne – car Marie-Alberte est bien la fille de (l’une des inspirations de) son père, on y revient dans un instant -, elle multiplie les rencontres que l’on jurerait, de prime abord, saugrenues, accompagnée enjambée par enjambée d’un narrateur alerte, d’un auteur enthousiaste – mais tentant chaque fois que possible de rétablir l’équilibre, la justesse et la mesure que la foulée de la grande fille menace à chaque instant – et d’un éditeur qui tient incidemment à documenter minutieusement les tenants et les aboutissants possibles de ce prodigieux périple, spéculant à l’envi sur les explications de texte envisageables, au prix d’une étonnante accumulation de digressions apparentes et de notes de bas de page détonantes et curieusement essentielles, notes dans lesquelles on rencontrera par exemple le poète et chroniqueur Jean Lemaire de Belges, le photographe Robert Doisneau, le tennisman Rafael Nadal, l’historien de la littérature Jean Starobinski, le lac de Paladru (dont les chevaliers-paysans sont chers au cœur de l’Alain Resnais de « On connaît la chanson »), le compositeur Olivier Messiaen, l’écrivain roumain Mircea Cǎrtǎrescu, le céramiste Bernard Palissy, le fabricant de perfusions (et autre matériel clinique) Baxter, le chanteur et comédien Jean-Roger Caussimon, le militaire moyenâgeux Jean de Dunois (dit « le bâtard d’Orléans »), la gouvernante proustienne Céleste Albaret, l’assassin arétin Guido Franceschini, l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu, le mathématicien Cédric Villani, les Quarante-Cinq, combattants de la garde du roi de France Henri III, l’ingénieur royal Vauban, le jardinier collectionneur Albert Kahn, l’industriel tatoué et avide Carlos Ghosn, le maître cuisinier Guillaume Tirel (dit Taillevent), le jeu Candy Crush, le rugbyman Thierry Dusautoir, le roi Baudouin IV de Jérusalem, le discret Thomas Pynchon, l’éclectique Hans Magnus Enzensberger, l’aviateur homme politique Édouard Corniglion-Molinier, le ministre Raymond Barre, ou encore le général Edgard de Larminat. C’est que là-dessous, il faut le savoir, au bord de cette terre plate qu’arpente, aussi décidée que rêveuse, la fille Marie-Alberte, son père, titan mythologique affairé muté d’office en géant rabelaisien, redresse en permanence, d’un coup d’épaule bien ajusté, les bords du monde en perpétuel affaissement local : rude métier, s’il en est, qui explique sans doute largement les errances tapageuses et tendres d’une progéniture également hors du commun.
Titan
Déplorable fille, amenée par ses vices et par l’exagération de ses vertus à la dissolution la plus odieuse de sa personne. On l’avait crue promise à l’une de ces destinées extraordinaires que des étoiles semblent accompagner – ces astres brillent, dit-on, avec une intensité particulière quand les êtres auxquels on les associe atteignent quelque comble de réussite sociale ou de mérite personnel. Quelle erreur ! Avec sur l’épaule une chouette de concours qui dit des charades ; avec un esprit devant lequel les montagnes s’inclinent et fondent leurs glaciers ; avec un gros sac à dos bourré de pépites plus précieuses les unes que les autres, elle est pourtant l’une des plus démunies personnes de ce monde et incapable, chaque jour plus incapable de se hausser à une condition meilleure que ses talents nombreux devaient lui assurer, comment la qualifierai-je, sinon de malheureuse ? ô déplorable fille !
La pustule n’est pas rédhibitoire, dès lors qu’elle est convenablement placée. Ainsi, la déplorable fille, pourvu que ses malheurs ne lui mangent pas tout le visage, peut plaire. Elle peut même rendre fou : un beau visage de porcelaine que les malheurs ne mangent qu’à moitié, l’imagination le reconstitue sans peine, et le cœur romanesque du garçon qui passe, sensible aux peines qu’il ne peut soulager, conçoit pour celle qui les souffre un attachement dont il veut qu’on lui sache gré et qui se renforce chaque jour de l’indifférence qu’on lui montre. Ça se terminera mal, cette histoire. On le pense en levant le coude comme Pure Malt en personne.
Elle marche. Elle traîne un chien mort. Quand on s’en étonne, elle tchipe sans cracher et la chouette fait remarquer que c’est une compagnie comme une autre, et même supérieure à d’autres par son poids conséquent qui permet à la fille d’exercer ses muscles : ce n’est pas un petit chien, un danois. Un chat mort est cousu par la gueule à la gueule du chien, on le remarque à peine tant il est petit : ce n’est pas grand, un chat nouveau-né. Une puce ni morte ni vive est cousue par la bouche à la bouche du chat ; nous n’en tirerons pas de conclusion hâtive, comme ces minables qui n’ont rien de plus pressé que de trouver aux faits des interprétations qui les insultent. Même si la puce est aisément interprétable, comme une charte qui a conservé toutes ses lettres et tous ses sceaux. La fille traîne tout ça au bout d’une très belle laisse tressée à la vendéenne, nouée à sa taille, assez solide pour traîner mille autres salissures. Elle marcherait aussi vite sans avoir rien à traîner, alors autant traîner, se dit-on, mais il est douteux qu’elle se le dise. Elle arrive chez un homme, il perd toute retenue et annonce qu’il va donner libre cours à sa nature libidineuse. Il couvre le chien, le chat et la puce. L’homme s’adresse ensuite à la fille, tout en s’essuyant les pudenda : « Voulez-vous ? » Elle décline l’invitation en ne répondant pas. Ayant trimballé avec elle jusqu’au rivage sa compagnie qui s’est accru de l’homme, cousu par la bouche à la bouche de la puce, elle adresse à la mer ce discours : « Comment te permets-tu de croire que tu m’intéresses, petite babiole ? Ce que je traîne sans y penser me paraît moins insignifiant que toi. Jamais je n’avais assisté à un spectacle aussi plat, d’une insipidité de cul mongol ôté de la selle. Ne t’avise pas de prétendre m’avoir vue, toi que j’ai déjà oubliée, toi que ce promontoire domine pour rien et dans les creux duquel tu viens hululer de façon grotesque (disant cela, elle met deux doigts talqués de tact dans les oreilles de la chouette). Et puis, comme les dessous de bras des crabes, tu sens mauvais ! » Comment les adversaires de l’éloquence réagiront-ils à ce morceau que les anthologies, plus soucieuses de ne pas le manquer que de le reproduire exactement, esquintent chacune à sa manière, dans la précipitation, de sorte que les écoliers seront appelés à admirer des versions fautives et à s’extasier devant des sottises ? C’est une question que nous ne posons même pas, la vie est courte comme la paille et la situation évolue trop vite.
Vertiges de la liste que ne renierait pas Umberto Eco, séquelles probables d’un périple sans cachalot mais clignant de l’œil avec Pierre Senges, cavalcades aussi opiniâtres qu’endiablées ahanant et grognant avec Marcel Moreau, mots-valises manustuprés rivalisant à l’occasion avec ceux d’Andréas Becker, réécritures patientes de mythologies grecques (jusque dans les éclairs du vocabulaire : « la lassitude aux pieds de plomb ») avec les filtres colorés de Rabelais et de Lautréamont, occupation des interstices de la langue principale par les dérivations secondaires explorées ailleurs par P.N.A. Handschin, mélanges délicieux utilisant toutes les ressources secrètes des notes de bas de page, irrévérencieuses, contradictoires, pseudo-explicatives, explosives ou éclairantes, comme rarement utilisées même chez un Gilles Marchand, inventions conceptuelles maniant à la perfection les capacités bureaucratiques de l’ordo-libéralisme – des Moralistes diplômés par le gouvernement (DPLG) aux Résultats monumentaux d’une démence (RMD), en passant par une fabuleuse gestion comptable des enfers, dans laquelle les profondeurs horribles de la terre deviennent le terrain d’action d’un redoutable contrôle de gestion – : comme chez Léo Henry et luvan, ou peut-être plus encore Éric Chevillard, le mixage ultra-fin de l’érudition et du potentiel de mise en perspective hilarante produit ici des effets majeurs.
Cette « Grande épaule portugaise », publiée en septembre 2020 aux éditions Vagabonde, quinzième ouvrage de l’auteur, illustre en beauté, et avec encore beaucoup plus de puissance que, par exemple, « Pour détacher un homme de sa peau » (2004) ou « Ongle du verbe incarné » (2008), le parti pris permanent (et ô combien résolu) du crépitement de l’invention littéraire.
Soudain (oui, c’est le soir), entrant dans une ville qu’elle n’a pas eu besoin de sommer pour s’en faire ouvrir les portes, elle voit arriver vers elle à grandes enjambées un grand Balimbure, de ces Balimbures dont les chroniques sont pleines et qui ont désolé tant de provinces sous tous les régimes. Ce monstre, qui a la taille d’un immeuble de rapport, est vêtu à la façon de ceux qui travaillent à la Défense et à la City, et comme eux il est plein d’une belle assurance indexée sur une redoutable malignité. Car le Balimbure est tout sauf un imbécile, c’est ce qui le rend si dangereux, ceux qui ont eu affaire à lui et qui l’ont sous-estimé ne sont plus là pour s’en plaindre et regretter leur erreur. Bien sûr, c’est un animal sauvage, on sait qu’il ne fait pas de quartier, mais sa nullité dans la plupart des domaines, et le mépris dans lequel on tient ses goûts et ses manières, endorment la méfiance des mieux prévenus. Il pleut. Les enseignes de la rue commerçante clignotent d’une façon qu’elles voudraient primesautière mais qui ne fait qu’ajouter un caractère de fatalité à l’atmosphère sinistre qui règne ici. Ce grand Balimbure, écumant comme une écumoire, ou comme la bouche de Nicole Obry qu’il a dû baiser cent fois, se plante devant Marie-Alberte, qui recule un peu devant son rot. Sa figure a quelque chose du cratère Chicxulub. L’intérieur de sa bouche est vert, pourri par la diffamation, l’ignorance, la baliverne, la gématrie, la flatterie, la coterie, le larbinisme, l’enflure, l’imposture et les dartres mais les dents sont admirables ; des trois trous de son nez alla bigotta dépassent les quatre cent trente-trois millions et quarante-cinq gros vers noirs du fanatisme ; ses yeux verticaux laissent couler un pus qui s’enflamme au contact de l’air et ces flammes forment des lettres et ces lettres forment le manuel de la lâcheté médiatique et friendly ; sa main gauche a la forme du génocide et de sa répétition machinale et contente ; son sexe qui déboutonne lui-même sa braguette dresse dans la bise nocturne sa profusion d’écailles jaunes au bout de laquelle s’agite follement une langue bifide (on se demande ce que fiche là ce pauvre pangolin) ; de ses oreilles sort l’écran de fumée du bon sens économique derrière lequel se dissimulent l’abus de bien social et cette bonne grosse dondon, l’optimisation fiscale ; dans chaque trou de sa peau grêlée remue le point médian de l’écriture inclusive ; sa main droite est faite d’épluchures des mille crânes qu’elle a épluchés ; son ventre, que surmonte l’emplacement vide du cœur, est ouvert sur la puanteur du ventre ouvert des Indigènes de la République (on y trouve leur théorie politique : c’est une vieille pantoufle dans laquelle poussent d’assez jolies crottes de demoiselles) ; ses genoux sont faits de toute la poussière où la soumission les a jetés, pour le compte du crime ; bref, le Balimbure est un de ces égouts que n’obture aucune plaque de fonte et où il faut bien que l’on tombe quand la nuit est noire.
La belle chronique de Bertrand Leclair dans Le Monde des Livres est ici.
Pierre Lafargue - La Grande épaule portugaise - éditions Vagabonde,
Hugues Charybde le 27/10/2020
l’acheter ici
Pierre Lafargue