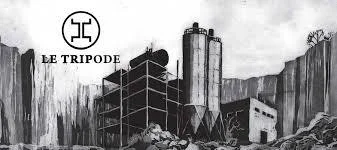Thierry Decottignies : “La Fiction Ouest”, en avant toute !
Entrez dans la fiction Ouest, à vos joyeux risques et périls, et découvrez en cahotant dans l’ellipse cet inimaginable bien particulier.
On se cravachait. Les choses sont un peu floues. On avait bu de la vodka après le travail, après le repas du soir, dans la chambre, et quelqu’un avait sorti une longue baguette de cuir, peut-être moi. On s’était mis à se fouetter, à se battre, à tour de rôle victime entre les lits en continuant à boire de la vodka en se passant la baguette. Je parle des garçons seulement, nous étions dans la chambre des garçons. Les cris devaient s’entendre dans tout le parc, réveiller les chats, les chevaux, les familles, tous les policiers, les camarades. Les filles étaient dans leur chambre et elles ne se cravachaient probablement pas, elles étaient au lit avec un livre, ou autour d’un feu quelque part à siroter une bière et parler de leur vie de chez elles, d’avant le parc. Ou alors déjà elles dormaient. Il ne devait pas être si tard que ça mais l’exercice nous tuait. Le matin très tôt nous partions tous ensemble à la gymnastique et puis au travail chacun dans ses corvées de cueillette ou de nettoyage, de maçonnerie, de cuisine, puis à l’exercice.
On dit parfois que certaines œuvres essentielles peuvent se repérer dès leur premier paragraphe – parfois dès leur première phrase -, pour peu que ce qui s’ensuit ne démente pas cruellement la fondation ainsi posée. D’emblée, « La fiction Ouest », premier roman de Thierry Decottignies, publié au Tripode en janvier 2019, se signale ainsi avec éclat à notre attention, puis conquiert très vite notre sidération indéfectible. Par la grâce quelque peu perverse d’un narrateur que tout une chacune ou un chacun trouverait déboussolé, mais qui ne semble pas l’être le moins du monde à ses propres yeux, promettant même régulièrement – pour l’oublier ensuite – de nous éclairer plus tard sur tel ou tel point nébuleux ou incongru, nous voici projetés dans le « parc » de la fiction Ouest, condensé à géométrie variable et franchement inquiétante de parc d’attractions 3.0 (et très vite, davantage qu’à George Saunders ou Cory Doctorow, on songera au glaçant « Le ParK » de Bruce Bégout), de bootcamp pour milice sécuritaire n’excluant pas une forme plus ou moins subtile de l’empification militaire chère au John Brunner de « Tous à Zanzibar », ou encore d’asile pour nécessiteux à retirer des rues (où certaines traces mutantes de la gouaille de « L’île aux troncs »de Michel Jullien pourraient être détectées).
J’ai parlé des gens un peu transparents et paumés que j’avais vus le premier matin en traversant le parc avec Percien, les hommes et femmes à l’air absent qui zonaient sans croiser les regards et rien faire de particulier, avec des chicots dans la bouche et maigres souvent, et lents dans les mouvements à cause d’être abîmés. C’était les flous du parc. On les appelait comme ça, mes camarades les appelaient comme ça. Ça venait je crois de l’impression qu’ils donnaient pareils à des spectres glissant sur l’opacité du monde. Les permanents les ignoraient la plupart du temps. En bas s’ils avaient des sales gueules ce n’était encore rien en comparaison des gueules qu’ils avaient en haut sur le plateau de l’exercice. Ils étaient pires là-haut, près des baraques qui étaient leurs maisons, avec des pieds qu’on aurait pu croire décollés du sol dans leur chétivité et alanguis souvent dans la craie et très gris avec la crasse. On ne s’en occupait pas, les camarades étaient habitués et je fis pareil. Je finis par ne plus trop les voir sauf quand ils gênaient dans l’exercice, s’étant couchés en plein milieu d’un trajet par exemple, et alors il fallait se lever et les pousser, les faire s’en aller. Quand ils ne réagissaient pas il fallait les porter, lourds comme des pierres, les éloigner et puis se recoucher pour ramper. Plus tard il me sembla que certains d’entre eux faisaient semblant dans l’épuisement mais je n’en eus jamais la certitude. Il y avait des degrés, des hommes et des femmes plus démolis que d’autres. De temps en temps des policiers d’en bas montaient et circulaient parmi ces égarés et ils en choisissaient une dizaine qu’ils emmenaient avec eux en les poussant doucement dans la pente. Je ne sus qu’un peu plus tard quel était leur destin, pourquoi on les enlevait ainsi à leur tranquillité de moribonds, pourquoi aussi ils prenaient les plus ingambes.
Dans cette fiction Ouest dont la nature exacte se dérobe à notre compréhension, une langue spécifique, épaisse, miracle d’équilibre joueur entre sa simplicité apparente et son opacité fondamentale, déploie ses pièges tortueux, nous aiguillant d’un côté pour mieux nous faire trébucher dans quelque fosse soudain dissimulée, nous guidant, aux côtés du narrateur, parmi ses compagnes et compagnons d’infortune, d’apprentissage, de retraitement (les déchets ou les eaux usées s’imposent éventuellement à l’esprit), de théâtre, de répression, ou de simple entretien des lieux : le choix des termes possibles demeure jusqu’au bout délicat. Dans leurs journées tissées des tâches ancillaires du cast d’un Center Parcs maudit et des exercices d’un parcours désormais absurde (peut-être) du combattant, sous le regard morne et infatigable de l’instructeur, Blesse, l’Employé, l’Évanouie, Vassili, Esse, Percien ou Ouespe (cette dernière provoquant, à elle seule ou presque, alliée à la présence lancinante d’insectes piqueurs et vrombissants, lors d’une mémorable séance de spéculation langagière, l’irruption de « La guêpe et les frelons », ce dont Mik Fondal ne se serait certainement pas remis), déroulent leur quotidien résolument post-exotique (les voies tortueuses du « Rituel du mépris » d’Antoine Volodine rôdent en effet à proximité), développant une dynamique de groupe fort curieuse (on songera alors peut-être à certaines nouvelles du « Chien a des choses à dire » de Jean-Marc Agrati), oblitérant l’absurde intrinsèque de ce vers quoi convergent leurs existences à la manière des protagonistes de l’incroyable nouvelle « Funnyway », qui créa Serge Brussolo en dix-sept pages dès 1978. Thierry Decottignies bâtit ici pour nous, lectrice ou lecteur, une parfaite déliquescence, une reductio ad absurdum qui dessinerait la ligne de fuite bouillonnante d’un monde enfermé dans la métaphore des initiations et bizutages militaristes (le « Croire et détruire » de Christian Ingrao n’est pas si loin qu’on pourrait l’imaginer), dans le fascisme ludique et terminal ayant intégré Pôle Emploi comme l’une de ses fonctionnalités naturelles, dans le stade ultime d’un camp (avec ses kapos plus ou moins discrets ou assumés), avec son issue logique une fois la force de travail véritablement épuisée. Maniant une langue construite au déroutant millimètre, jouant de ses effets de guingois tragique, nous forçant avec brio à nous poser, en foule, les questions à la place de ses personnages qui ne s’en posent guère – dont l’inexorabilité proprement kafkaïenne de la situation nous glace (et nous réjouit sombrement) ainsi davantage encore -, Thierry Decottignies nous offre 200 pages souveraines d’un formidable art de l’ellipse foutraque pour nous faire partager un inimaginable bien particulier.
On trouva Esse un jour pendu à sa ceinture dans la petite pièce qui nous servait de chiottes dans la baraque mais pas mort. Il s’était pendu ivre assis par terre accroché à un clou au-dessus de sa tête, et il s’était endormi ou évanoui comme ça. Il garda la marque pas mal de temps autour du cou à cause de l’invisibilité. Je veux dire qu’il s’était pendu à cause de l’habitude qu’il avait de croire que personne ne le voyait quand en réalité on le voyait parfaitement et ça le rendait mélancolique et silencieux. Pour tout dire je m’ennuyais sec avec lui dans le travail car il était mon collègue dans les maisons d’hôtes près des nids de frelons. Mais le parc lui fit du bien finalement dans un sens, et dans un sens seulement, dans le sens qu’il devint plus opaque malgré la transparence qui nous gagna tous peu à peu.
La fiction Ouest de Thierry Decottignies, éditions Le Tripode
Charybde2 le 30/01/19
l’acheter ici